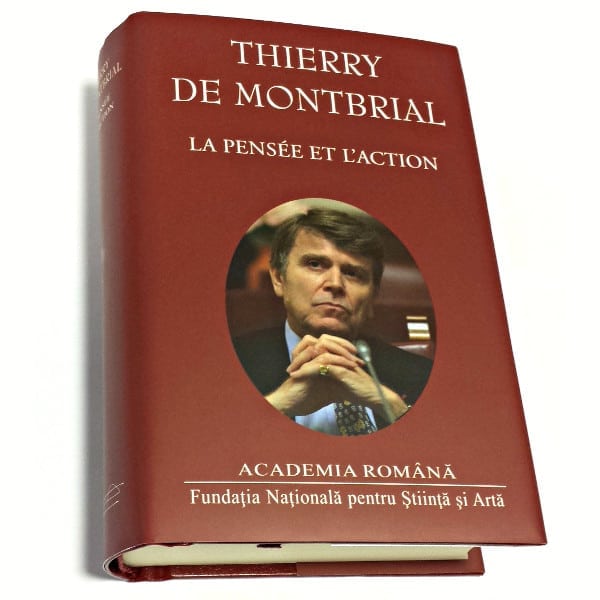L’enseignement doit-il être utile ?
Texte issu d’une conférence prononcée le 15 janvier 1994 devant l’Association des membres des Palmes académiques
Tout élève ou tout étudiant, tout professeur se trouve constamment confronté à cette question : telle connaissance enseignée est-elle utile ? J’aborderai le sujet à travers trois thèmes qui se chevauchent : les finalités de la connaissance ; le concept de culture ; les rapports entre l’abstrait et le concret.
Le thème de la connaissance est l’un des plus fondamentaux de la philosophie. Il me semble que, d’un point de vue pragmatique, on oscille constamment entre deux attitudes extrêmes : la connaissance comme fin en soi, ou en vue d’une action. La distinction n’est claire qu’au premier degré. Certes, pour un philosophe « pur », toute préoccupation utilitariste apparaît comme une pollution de l’activité intellectuelle, dont le noble but serait d’entrevoir, au moins par intermittence, l’infini ou l’absolu. À l’extrême inverse, un étudiant préoccupé par son entrée dans la vie active ne sera intéressé que par ce qui lui facilitera l’obtention d’un diplôme offrant les meilleures chances de trouver un premier emploi. En réalité, les choses ne sont pas aussi tranchées. On ne peut spéculer sur l’absolu qu’en se posant des problèmes, et pour les « résoudre » il faut maîtriser des outils conceptuels qui prennent de ce fait un caractère utilitaire. Quant à l’obtention d’un diplôme, elle est subordonnée à l’acquisition de connaissances qui ne sont évidemment pas toujours directement utiles dans l’exercice d’une profession.
Plus on y réfléchit, plus on se convainc de la futilité de la distinction entre connaissances pures et appliquées. Ce qui est gratuit pour les uns est utilitaire pour les autres, ou pour les mêmes dans d’autres circonstances. Il y a, certes, un « fonds de connaissances » de base qui sont utiles pour la plupart des gens dans beaucoup de circonstances de leur vie, comme la lecture, l’écriture, la logique et le calcul élémentaire (peut-on bien acheter et vendre en ignorant la règle de trois ?) et aussi quelques éléments de référence sur la nature ou sur les sociétés dans lesquelles on vit. L’acquisition de ce fonds de connaissances de base doit idéalement se réaliser par l’enseignement primaire et secondaire.
J’en viens maintenant à la culture, au sens classique du terme, et non pas au sens ethnologique plus récent, lequel recouvre l’ensemble des modes de comportement d’une collectivité. Ici encore, on oscille entre deux pôles extrêmes. L’un tient dans la gymnastique de l’esprit sur des thèmes universels (ceux de la philosophie : le vrai et le faux, le beau et le laid, le bien et le mal, etc.) ; l’autre consiste en l’accumulation de connaissances « factuelles » (en quelle année est mort Richelieu ? Qui a dit « tout ce qui est excessif est insignifiant » ?, etc. ). Mais, cette fois encore, la distinction est plus floue qu’il n’y paraît. On n’accède aux thèmes universels qu’en approfondissant des cas singuliers (d’où aussi et peut-être surtout la puissance de l’art en général, l’art du roman ou de la poésie en particulier) ; à l’inverse, les « faits purs » n’ont de sens que rattachés à une structure. Le propre de la culture est de permettre à l’homme d’exercer son sens critique sur les choses de la vie en apprenant à les extraire mentalement de la nébuleuse confuse qui les entoure de prime abord. L’homme cultivé sait se repérer. Il en tire une jouissance intérieure, mais aussi sa capacité d’adaptation extérieure. Celui qui sait se repérer a des chances de pouvoir se diriger. Dans la vie, nous avons constamment à résoudre des problèmes intellectuels ou pratiques, et pour cela nous devons acquérir des connaissances ou des « outils » ; Parce qu’elle nous aide à nous diriger, la culture augmente nos chances de réussite. En cela, elle est utile. La familiarité avec la littérature et avec l’histoire reste sûrement la voie royale pour la culture générale, et je pense qu’au lieu de se disperser dans une myriade d’auteurs que le tribunal du temps n’a pas encore jugés, notre enseignement secondaire devrait se concentrer, comme autrefois, sur les quelques géants des lettres françaises. Mais il n’y a pas de culture que générale. Dans chaque domaine, l’extrême spécialisation conduirait à la stérilité, si elle n’était pas éclairée par son environnement. On retrouve ainsi la question initiale. Au-delà de l’acquisition du socle de base, le but de l’enseignement secondaire est d’engager un processus de culture qui, idéalement, devra se poursuivre toute la vie. S’il est permis d’employer une métaphore économique, je dirais qu’outre la satisfaction immédiate qu’elle procure normalement aux êtres, la culture est un investissement, un multiplicateur d’utilité future. Elle est aussi, comme Dostoïevski le disait à propos de la monnaie, de la liberté frappée.
Troisième thème, l’abstrait et le concret, si souvent identifiés respectivement à l’inutile et à l’utile voire au mal et au bien. Là encore, les choses ne sont pas si simples. Langevin disait que « le concret, c’est de l’abstrait usagé » ; et, quand on demandait à Louis de Broglie ce qu’était un atome, il répondait « un paquet d’équations » au sens le plus littéral du terme. En fait, il n’y a pas de connaissance sans extraction de concepts à partir du chaos primitif et, par conséquent, sans abstraction. Ce qui est abstrait pour l’un est concret pour un autre. Qu’y a-t-il de plus abstrait que le théorème de Gödel, cette proposition de logique formelle selon laquelle, à partir de tout système fini d’axiomes, on peut construire des propositions indécidables, c’est-à-dire vraies mais indémontrables ? Et pourtant, cette extraordinaire affirmation de la métamathématique revêt le sens le plus concret pour l’informaticien, qui sait que, dans certains cas, un algorithme destiné à valider ou à infirmer une proposition donnée pourra ne jamais converger. On pourrait multiplier les exemples de brassage entre l’abstrait et le concret en mathématique bien sûr, mais aussi en physique (espaces de Hilbert et mécanique quantique, espaces de Riemann et relativité générale, théorie des distributions, etc.). Cela ne vaut pas que pour les sciences de la nature. En économie, la théorie des avantages comparés, citée par Paul Samuelson dans sa conférence Nobel , énonce que dans certains cas l’intérêt général implique que l’on délocalise des activités industrielles vers des pays où les coûts absolus sont pourtant plus élevés. Une telle affirmation heurte le prétendu « bon sens » et, pourtant, elle est pertinente. Autre exemple dans le domaine de la politique, cette fois : tous les pacifistes de la terre se refusent à admettre l’adage si vis pacem para bellum et manifestent une allergie instinctive à l’égard du concept de dissuasion nucléaire, dont l’essence est le maintien de la paix grâce à un équilibre entre des menaces terrifiantes et crédibles. Plus généralement, la logique de ce que l’on peut appeler le « calcul politique » blesse souvent le sens commun. De la même façon, le sieur débutant, du moins quand il est adulte, a du mal à admettre que pour ne pas tomber il faille se penser vers le vide.
Après l’acquisition du socle de base et l’exercice de la culture, la fréquentation de l’abstraction est indispensable pour l’éducation des hommes destinés, dans quelque domaine que ce soit, à ne pas rester de simples exécutants. L’enseignement supérieur a pour mission première de les familiariser avec l’abstraction.
L’enseignement doit-il être utile ? Oui, bien sûr, mais il s’agit de ne pas se méprendre sur le sens de l’adjectif. En définitive, le but de l’enseignement est bien d’aider les enfants, puis les adolescents et les adultes, à développer leur sens critique, à mieux vivre leur vie professionnelle mais aussi personnelle, à accroître leur ouverture sur les autres et sur le monde, à cultiver leur part de créativité et leur capacité d’adaptation. Mais, à notre époque, il n’est plus possible de mettre un terme à la durée de l’étude. Le « recyclage » doit être permanent. Et la clé de la réussite dans la durée, c’est la gratuité utile.