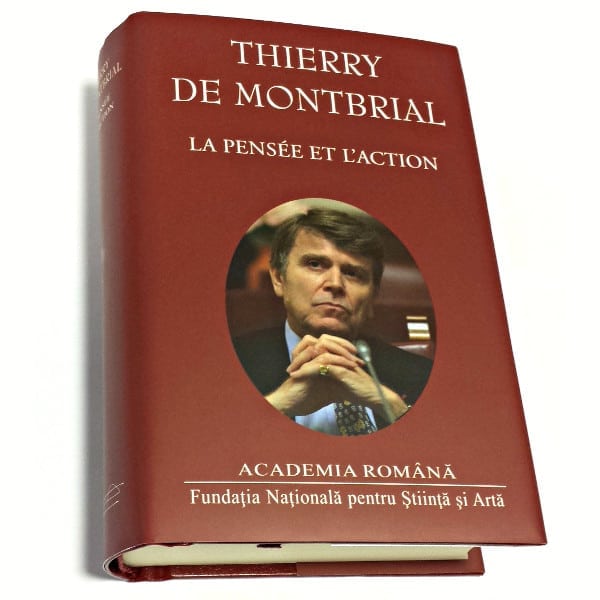La pensée et l‘action dans l’œuvre de Maurice Allais
Version développée d’un discours prononcé à l’occasion de la remise de son épée d’académicien des sciences morales et politiques à Maurice Allais, le 19 octobre 1993.
La communauté scientifique connaît surtout les contributions théoriques, considérables, de Maurice Allais. Ce sont évidemment elles que le jury Nobel a couronnées en 1988, plus particulièrement ses deux grands traités de 1943 (À la recherche d’une discipline économique ) et de 1947 (Économie et Intérêt ). Mais on réduirait singulièrement la dimension du personnage et de son œuvre si l’on n’en retenait que le versant théorique, aussi monumental soit-il. Toute sa vie, et à partir de 1945 en ce qui concerne ses publications (1945, Prolégomènes à la reconstruction économique du monde ; 1946, Abondance ou misère ), Maurice Allais a voulu s’impliquer intellectuellement dans les grands débats économiques de son temps, en particulier sur la reconstruction au lendemain de la guerre, la comparaison des systèmes économiques socialistes et libéraux, la construction européenne, le sous-développement et, depuis la chute du mur de Berlin, la transformation des pays de l’Est. Il a également consacré un livre profondément original à L’Impôt sur le capital et la réforme monétaire , ainsi que de nombreuses études sur la croissance, la politique monétaire, le système monétaire international et le calcul économique.
Pour lui, la connaissance pure doit déboucher sur l’action. L’économie fondamentale n’a aucun sens si elle ne féconde pas l’économie appliquée, celle-ci s’appuyant nécessairement sur celle-là. Sa philosophie est inséparable de la conception selon laquelle il n’y a de science que là où existent des régularités identifiables et chiffrables, permettant des prévisions. De fait, l’ensemble de son œuvre se caractérise par une extrême cohérence. Je suppose qu’il n’existe que très peu d’économistes dont les analyses de circonstances, au long d’un demi-siècle, se soient révélées aussi pertinentes et dont l’intérêt résiste aussi remarquablement à l’épreuve du temps. En définitive, la source originaire de la pensée de Maurice Allais est la conviction de la supériorité absolue du libéralisme, convenablement entendu. Je reviendrai sur ce point dans ma conclusion.
Le point de départ d’Allais est la théorie des avantages comparés, formulée par David Ricardo en 1817 dans ses Principes de l’économie politique et de l’impôt . Celle-ci énonce que, pour maximiser l’efficacité de l’économie mondiale, autrement dit pour assurer le meilleur emploi des ressources disponibles, chaque pays doit se spécialiser dans les activités pour lesquelles sa productivité relative – et non pas absolue – est la plus élevée. Cette construction intellectuelle est la plus simple qui rende compte de la division internationale du travail et de ses bienfaits. John Stuart Mill la compléta en 1848, en démontrant que les termes de l’échange c’est-à-dire le système de prix relatifs sur la base duquel les échanges internationaux s’effectuent, sont déterminés par les conditions d’équilibre des balances des paiements (balances de base, dans une terminologie plus précise) des différents pays. Toute cette élaboration conceptuelle apparaît d’ailleurs comme un cas particulier du modèle de l’équilibre général, auquel sont associés les noms de Walras, Pareto et Allais.
Maurice Allais remarque que les gains dégagés lors du passage de l’autarcie à l’échange sont l’équivalent d’un progrès technique, en ce sens que l’on obtient des productions plus grandes avec les mêmes ressources. La transition se heurte aux mêmes difficultés qu’avec le progrès technique lui-même ; car, dans l’un et l’autre cas, les bénéfices sont le plus souvent dilués dans le temps et dans l’espace, alors que les souffrances impliquées par la redistribution des activités sont immédiates et concentrées sur certains groupes. Allais observe également que les différences de salaires nominaux dans les différents pays n’entravent pas la mise en œuvre d’une dimension internationale du travail conforme au principe des avantages comparés, à condition de laisser le taux de change corriger les écarts de productivité absolue. Il en résulte une conclusion essentielle et cependant méconnue : la convertibilité des monnaies est toujours possible, pourvu que les taux de change soient adéquats. S’appuyant sur les intuitions fondamentales dont ces idées procèdent, Allais s’est efforcé de tirer un ensemble de conclusions opérationnelles, que l’on retrouve dans tous ses écrits, et notamment dans ses très remarquables ouvrages de 1959 et 1961, L’Europe unie¸ route de la prospérité et Le Tiers-Monde au carrefour .
Le but ultime de l’intégration européenne, sur le plan économique, est de permettre au principe des avantages comparés de jouer au maximum. Pour cela, il faut réaliser le grand marché, c’est-à-dire supprimer toutes les entraves à la circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. La pression concurrentielle résultant d’un grand marché incite en permanence les entreprises à réduire leurs coûts. Cette pression est en définitive plus importante que le jeu statique des avantages comparés, à productivités données.
La réalisation même approximative du grand marché est déjà un objectif extrêmement ambitieux. En pratique, il a fallu compléter le traité de Rome par l’Acte unique, et peut-être celui-ci ne suffira-t-il pas. Les débats postérieurs aux accords de Schengen ont mis en lumière les difficultés de la libéralisation complète des mouvements de personnes. Et pourtant, la condition nécessaire de l’ouverture des frontières n’est pas suffisante pour assurer l’efficacité économique. Il faut encore mettre en place une monnaie unique, afin de supprimer les pertes économiques résultant des incertitudes de change (notamment celles engendrées par les mouvements spéculatifs des capitaux à court terme) et des coûts de transaction. Mais, déjà dans son ouvrage de 1959, Allais observe que la voie vers la monnaie unique est extrêmement exigeante. Elle implique que chaque partie renonce à l’un des attributs essentiels de la souveraineté. Aucun État européen ne pourrait plus financer ses déficits budgétaires par la création monétaire. Il devrait procéder par l’impôt ou emprunter sur le marché des capitaux comme n’importe quel opérateur. Mais, surtout, la monnaie unique ne pourrait fonctionner que si les salaires réels s’ajustaient dans les différents pays en fonction des productivités absolues, puisque la possibilité de masquer les différences en faisant glisser les échelles de prix grâce aux taux de change n’existerait plus par hypothèse. Dès lors, un chômage massif apparaîtrait inéluctablement là où les salaires réels seraient trop élevés. Cette question de la disparité des salaires réels, essentielle, explique en grande partie le chômage structurel que l’on observe dans les régions arriérées de certains pays .
Dans sa critique du traité de Maastricht , Allais reste sur la ligne de ses analyses de 1959 en jugeant irréaliste le passage à la monnaie unique selon des étapes et un calendrier déterminés. Non sans malice, il se demande comment on pourrait aboutir à une banque centrale indépendante quand les États membres ne se montrent pas disposés à accorder préalablement l’indépendance à leur propre institut d’émission. Mieux vaut donc, selon lui, un système monétaire fondé sur des parités stables, mais ajustables, afin d’adapter de temps à autre les taux de change aux conditions de structure. Incidemment, l’idée de l’harmonisation préalable de certaines de ces structures, comme la fiscalité, paraît dépourvue de sens à notre prix Nobel. Mieux vaut laisser jouer la concurrence, pour elles aussi, et recourir aux taux de change pour opérer les ajustements.
Ces analyses permettent de renvoyer dos à dos deux points de vue actuellement répandus. Pour les architectes du traité de Maastricht, la monnaie unique est la limite mathématique du système monétaire européen (SME) lorsque la marge de fluctuation autorisée tend vers zéro. En réalité, quelle que soit cette marge, le point essentiel est la possibilité de réviser les taux de change. On peut soutenir que, si les conditions de structure ne sont pas réalisées, le système est en fait d’autant plus instable que les marges sont plus faibles. C’est ce que l’on a constaté en septembre 1992 et en juillet 1993. Le deuxième point de vue a été exprimé par des observateurs soucieux de sauver l’esprit du traité. Selon eux, il faudrait renoncer à la politique des petits pas et franchir directement le saut de la monnaie unique. On serait donc face à un choix binaire. Les analyses de Maurice Allais suggèrent qu’un tel saut serait extraordinairement risqué, voire irresponsable. Aucun gouvernement ne l’a d’ailleurs recommandé.
Revenons à la théorie des avantages comparés et à la spécialisation qu’elle implique. En principe, chaque pays est conduit à abandonner entièrement des activités pour lesquelles il peut disposer, le cas échéant, d’un avantage absolu de productivité. Au cours des décennies, Maurice Allais n’a cessé d’attirer l’attention sur trois conditions préalables au bon fonctionnement de ce mécanisme. Premièrement, les avantages comparés doivent résulter de causes permanentes et structurelles, et non pas de facteurs transitoires. Sinon, la ruine de certaines industries potentiellement compétitives est anti-économique. En deuxième lieu, dans le cas où les avantages comparés sont permanents, une spécialisation complète n’est souhaitable que si elle ne peut pas être remise en cause ultérieurement pour des raisons politiques. Enfin, une division internationale du travail conforme à la règle de Ricardo suppose un système monétaire international permettant la détermination des taux de change selon le principe que j’ai indiqué précédemment.
Ce dernier point exige un développement particulier. Depuis la dislocation des accords de Bretton Woods, le système monétaire international n’a cessé de se dégrader, en grande partie du fait des États-Unis. En laissant se développer anarchiquement des pyramides de dettes fondées sur de faux droits, les États-Unis ont créé une situation potentiellement instable. Les conditions d’obtention du crédit, la dérégulation outrancière des années 1980, la libéralisation totale des mouvements de capitaux à court terme ont permis à la spéculation privée de se développer dans des proportions sans précédent. Les énormes fluctuations des taux de change qui en résultent compliquent singulièrement le calcul économique à moyen terme. Lorsqu’elle est possible, la couverture du risque de change grève les coûts des opérations dans les cas où recettes et dépenses ne sont pas définies dans les mêmes monnaies. En outre, la pyramide des dettes menace à chaque instant de s’effondrer, comme en 1929. « Il est pratiquement impossible, note Maurice Allais dans L’Europe face à son avenir , de prévoir à quel moment précis une telle instabilité potentielle peut conduire à des situations explosives si un concours de circonstances défavorables amène le public à craindre une insolvabilité des banques. Peut-être l’image la plus parlante est-elle celle des agriculteurs qui vivent sur les pentes de l’Etna. Ils peuvent vivre tranquillement des années durant, mais une nouvelle éruption peut se déclencher à tout moment. » Dans Erreurs et impasses de la construction européenne, déjà cité, Allais observe que l’instabilité actuelle repose sur deux volcans, un endettement démesuré et un chômage excessif. Celui-ci résulte largement, dans son esprit, de la pratique des salaires minimaux.
Ce qui vaut pour le système monétaire international dans son ensemble vaut pour le système monétaire européen, quoiqu’à un moindre degré du fait de la sagesse allemande. Mais Allais a mis en évidence, bien avant les crises de septembre 1992 et de juillet 1993, évoquées ci-dessus, la vulnérabilité du SME. Cette instabilité potentielle subsistera tant que les mécanismes du crédit et les règles du Fonds monétaire international (FMI) n’auront pas été profondément réformés. C’est dire qu’elle subsistera longtemps.
En France, le grand public a découvert Maurice Allais en 1988, c’est-à-dire après qu’il eut reçu le prix Nobel de sciences économiques, et a accédé à ses idées à travers des publications postérieures, principalement ses grands articles donnés au Figaro. J’ai malheureusement pu constater que beaucoup de lecteurs le considéraient comme un champion du protectionnisme. Quiconque connaît l’ensemble de son œuvre ne peut que déplorer ce jugement profondément inexact. En réalité, Maurice Allais reste cohérent avec lui-même. Dès lors que les trois conditions que je viens d’exposer ne sont pas remplies vis-à-vis de l’extérieur, l’Union européenne doit assurer sa sécurité économique, non pas en s’établissant comme forteresse – comme les Américains affectaient de le croire dans les débats de 1985 autour de l’Acte unique –, mais en s’entourant d’un niveau de protectionnisme raisonnable. « Dans un monde dominé par une grande instabilité potentielle, politique et économique, écrit Allais dans L’Europe face à son avenir (p. 97), les avantages des échanges résultant de structures différentes de coûts et de prix ne peuvent être considérés comme l’emportant totalement sur les dangers résultant de cette instabilité. » Dans les années 1930, la France a relativement peu souffert de la Grande Dépression partie des États-Unis parce qu’elle était mieux protégée que ses voisins.
L’Union européenne doit donc se protéger raisonnablement. Elle doit aussi renforcer ses structures politiques internes pour ne pas s’exposer elle-même à un risque de morcellement découlant des mêmes causes. Dans ses ouvrages de 1991 et 1992, Allais s’insurge contre « la dérive technocratique, dirigiste, centralisatrice, unitaire et jacobine de la Communauté européenne » (L’Europe face à son avenir, p. 56). Il dénonce le mélange hybride d’un « Cartel d’États », avec le Conseil des ministres, et d’un « Super-État », avec la Commission. Il bâtit des schémas de réforme institutionnelle très ambitieux pour la mise en place d’une structure démocratique et efficace. Faisant sienne la fameuse formule prêtée à Jean Monnet « Si c’était à refaire, je commencerais par la culture », il propose un vaste programme visant à diffuser les cultures européennes au sein de l’Union tout en assurant que les particularités de chacune seront préservées. On ne comprend rien à l’attitude de Maurice Allais par rapport au protectionnisme si on ne la situe pas dans un contexte d’ensemble. Rien n’est plus affligeant que de voir politiciens et commentateurs s’emparer de telle ou telle bribe de la pensée d’un grand savant pour appuyer telle ou telle thèse partisane en réalité totalement incompatible avec la Weltanschauung du maître.
Dans Le Tiers-Monde au carrefour, Maurice Allais relève (note 171, p. 131) son désaccord avec Milton Friedman qui propose, en ce qui concerne les États-Unis, de supprimer toute barrière douanière vis-à-vis de l’extérieur. Ces deux grands penseurs libéraux qui ont tant d’affinités, tous deux couronnés par le prix Nobel , se séparent aussi à propos des changes flottants, que Milton Friedman approuve et même recommande. Je pense que ces divergences résultent essentiellement de la différence entre leurs lieux d’observation, entre la masse énorme des États-Unis et celle d’une puissance moyenne comme la France. Ce n’est pas par hasard qu’il existe une pensée spécifiquement française sur le système monétaire international, à laquelle on peut attacher, dans les dernières décennies, le nom de Maurice Allais, mais aussi celui de Jacques Rueff. On objectera avec raison que l’Allemagne et le Royaume-Uni, comparables à la France par leur taille, demeurent allergiques aux « idées françaises ». Sans doute faut-il y voir les traces de la culture et des données de la politique du dernier demi-siècle. De toute façon, les faits finissent toujours par s’imposer.
Alors que Friedman est partisan d’un libre-échange mondial favorable à la puissance dominante (la supériorité économique américaine était encore plus marquée à l’époque des grands écrits de cet auteur), Allais développe l’idée fondamentale – totalement étrangère à la pensée de son collègue de Chicago – que toute libéralisation à grande échelle ne peut être, au moins dans l’avenir prévisible, que régionale et non mondiale. « La progression du monde vers un avenir meilleur ne saurait résulter de l’instauration d’un libre-échange mondial. Elle ne peut résulter que d’un processus progressif fondé tout d’abord sur la réalisation d’Associations régionales et d’Accords spécifiques entre les différentes Associations régionales. » (L’Europe face à son avenir, p. 102-103) Cette idée, largement contraire à la philosophie de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade ), rejoint d’ailleurs des réflexions plus générales et très actuelles sur la sécurité collective. Je pense à l’articulation entre l’Organisation des Nations unies (ONU), à vocation mondiale, et les organisations régionales. Mais il faut bien reconnaître que, dans le domaine de l’économie comme dans les affaires politico-militaires, la structuration régionale de la planète n’en est qu’à ses balbutiements. En fait, seule l’Europe a jusqu’à présent réussi à dépasser un stade primitif d’organisation. Ce fait, sans aucun précédent historique, doit être souligné avec force, quelles que soient les critiques que l’on puisse adresser aux institutions de Bruxelles.
J’en viens à un aspect synthétique de la pensée de Maurice Allais, qui ressort de tout ce qui précède. Je le cite : « Certes, je pense, je suis même convaincu, qu’il existe une science économique totalement indépendante de toute considération politique. Mais je ne suis pas moins convaincu que, dès lors qu’il s’agit d’appliquer cette science à la réalité concrète et de rendre notre action plus efficace, les considérations politiques sont essentielles, et que toute économie appliquée doit être une économie politique au sens où l’entendaient les fondateurs de la science économique. » (L’Europe face à son avenir, p. 12) Depuis près de cinquante ans, il n’a cessé de développer l’idée que l’union politique devait précéder l’union économique ou tout au moins se développer en parallèle. Le libéralisme économique ne peut être que proportionnel, si l’on ose dire, à l’organisation politique. Une fois encore, Maurice Allais reste cohérent avec lui-même lorsqu’il ne joint pas sa voix au concert de ceux qui ont critiqué la réunification monétaire allemande, en 1990, au taux de change de 1 pour 1, ce qui eût été absurde en dehors du cadre politique où elle s’est inscrite. Dans son précieux ouvrage sur La Libéralisation des relations économiques internationales , Allais observe ceci : « Lorsque de grands ensembles politiques se désintègrent, chaque partie tend naturellement à adopter une politique protectionniste » et « lorsqu’au contraire de larges entités politiques se constituent, la libéralisation économique fait des progrès rapides en leur sein » (p. 105-106). Ces énoncés ne souffrent aucune exception. La désintégration de l’URSS en a apporté une nouvelle confirmation. Dans un premier temps, les fragments de l’ancien empire ont tendu à s’entourer de frontières et à établir leur propre monnaie, dans l’espoir que chacun pourrait faire évoluer ses structures et ses relations extérieures en fonction de ses aptitudes propres. Le Fonds monétaire international les y a d’ailleurs encouragés. Il faudra recomposer tout ou partie de ces fragments dans de nouvelles structures de coopération. Selon les mêmes lois, il est illusoire de prétendre élargir l’Union européenne à des pays avec qui une union politique est de toute évidence exclue dans l’avenir prévisible.
Je disais en commençant que la source originaire de la pensée de Maurice Allais est la conviction de la supériorité absolue du libéralisme. Dans l’avertissement qui ouvre L’Europe unie, route de la prospérité, on lit : « Il ne peut y avoir de démocratie politique véritable et de société libre si l’organisation sociale n’est pas fondée sur une économie de marché et pour la plus grande part sur le régime de la propriété privée. » (p. 10) La réciproque est fausse. Dans Le Tiers-Monde au carrefour, Maurice Allais remarque : « Il est probable que dans les pays sous-développés et pour longtemps encore la seule forme de gouvernement possible, conforme à l’idéologie libérale, soit un régime à la fois autoritaire et libéral, et l’opposition de ces deux objectifs en souligne la difficulté. Le régime doit être libéral, mais le libéralisme est une fleur fragile qui ne pourra survivre que si le gouvernement a suffisamment d’autorité pour en défendre les principes et l’application, tout en maintenant son action dans les limites qu’impliquent ces mêmes principes libéraux. » (p. 104) Ainsi, l’intermède d’un régime à la fois autoritaire et libéral, correspondant à un équilibre fort délicat, serait une condition nécessaire pour passer du sous-développement à la démocratie. L’histoire récente, notamment en Amérique latine et en Asie de l’Est, semble confirmer ce jugement.
En se fondant sur ses convictions libérales, étayées par des études statistiques approfondies, Maurice Allais a porté des jugements sur l’URSS qui, après plus de trois décennies, semblent prophétiques. Je citerai simplement trois phrases extraites de L’Europe unie, route de la prospérité, publié, je le rappelle, en 1959 : « La véritable lutte entre l’Ouest démocratique et l’Est totalitaire se livrera sur le plan économique, social et idéologique » (p. 13) ; « Si une communauté véritable des nations libres de l’Atlantique pouvait se constituer économiquement et politiquement, elle constituerait un puissant pôle d’attraction capable, par sa seule présence et compte tenu de l’extraordinaire prospérité qui serait la sienne, et plus encore de l’immense espérance qui en résulterait pour la communauté des hommes, de désagréger peu à peu le monde totalitaire de l’Est » (p. 160) ; « La Russie soviétique est en fait dans l’impossibilité de faire face de front, avec succès, à l’augmentation de ses niveaux de vie, à la course Est-Ouest aux armements et enfin à la compétition dans l’aide aux pays sous-développés » (p. 228-229). Dans sa lutte contre le marxisme, Maurice Allais a mené le même combat que Raymond Aron, avec des armes différentes.
Rares étaient en France les vrais libéraux à l’époque où il écrivait ces lignes. La pensée keynésienne, qui repose en définitive sur le postulat de la rigidité des prix, dominait les esprits. Dirigistes et marxistes proliféraient ; et l’URSS, forte de la conquête spatiale, s’affirmait comme une superpuissance. Aujourd’hui encore, alors que l’establishment s’est apparemment converti au libéralisme, bien peu nombreux sont ceux qui, comme Allais ou Rueff, ont le courage de croire vraiment à la vérité des prix et d’en assumer les implications. Je pense particulièrement au problème des salaires, c’est-à-dire à la contrainte du salaire minimal et à son effet négatif sur l’emploi, ou encore au taux d’intérêt qui est, lui aussi, un prix dont le gouvernement ne dispose pas à sa guise. Nombreux également restent ceux qui ne se sont pas complètement résignés à reconnaître dans la propriété privée un pilier du libéralisme politique.
Mais, pour Maurice Allais comme pour tous les grands penseurs libéraux, le libéralisme n’est pas le laisser-faire, lequel « peut se comparer à un régime routier qui laisserait les autos circuler à leur guise sans code de la route : les encombrements, les embarras de circulation, les accidents seraient innombrables, à moins que les grosses voitures n’exigent que les plus petites leur cédassent la route, ce qui serait la loi de la jungle » (L’Europe unie, route de la prospérité, p. 281). Allais fait sienne cette pensée de Lionel Robbins (1936) : « Le choix n’est pas entre un plan ou une absence de plan, mais entre différents types de plan. » Ainsi la notion de planification concurrentielle ou de planification des structures institutionnelles, qui s’oppose au dirigisme et à la planification centralisée, est-elle une des idées maîtresses du Tiers-Monde au carrefour, idée que les apprentis libéraux de Moscou, depuis la victoire d’Eltsine, auraient bien fait de méditer. Le libéralisme repose sur un ordre exigeant mais cet ordre doit être, comme le dit Allais, consenti, c’est-à-dire légitime. Là est peut-être la plus grande des difficultés.
Au bout du compte, la pensée de Maurice Allais est humaniste. « La fin essentielle de toute société libre est la personne humaine », écrit-il dans L’Europe unie, route de la prospérité (p. 130). Jamais il ne perd de vue cet objectif, ainsi que le démontre l’ensemble de ses propositions de réformes que je ne peux malheureusement pas exposer ici. L’économie de marchés (au pluriel) est tout à fait compatible avec les préoccupations sociales. « Le développement de l’économie occidentale n’a pas eu comme condition nécessaire l’absence de toute législation sociale », affirme-t-il dans Le Tiers-Monde au carrefour (p. 58), mais il ajoute justement : « La législation sociale ne peut et ne doit pas, au début, prendre modèle sur les législations avancées des pays développés, législations dont l’application serait trop coûteuse, compte tenu du bas niveau actuel de productivité et dont le seul effet serait de ralentir le développement. » (p. 109)
Tout au long de son œuvre, Maurice Allais, convaincu comme Jean Bodin (au xVIe siècle) « qu’il n’y a de richesses que d’hommes », plaide pour l’amélioration de la formation et des systèmes éducatifs. S’agissant du Tiers Monde et, à présent, des anciens pays communistes, il considère que ce domaine de la formation est celui où doit se concentrer toute l’aide occidentale.
Bien d’autres aspects de la pensée de Maurice Allais nécessiteraient d’être présentés, et chacun pourra se reporter aux textes originaux. Toute sa vie, Maurice Allais n’a cessé de penser par lui-même. Il n’a fait aucune concession à l’esprit du temps. Sa carrière en a souffert, et sa reconnaissance a été tardive. Il a payé cher son honnêteté scrupuleuse qui force l’admiration. Il faut rendre hommage à la dimension morale de ce grand savant et de cet humaniste.