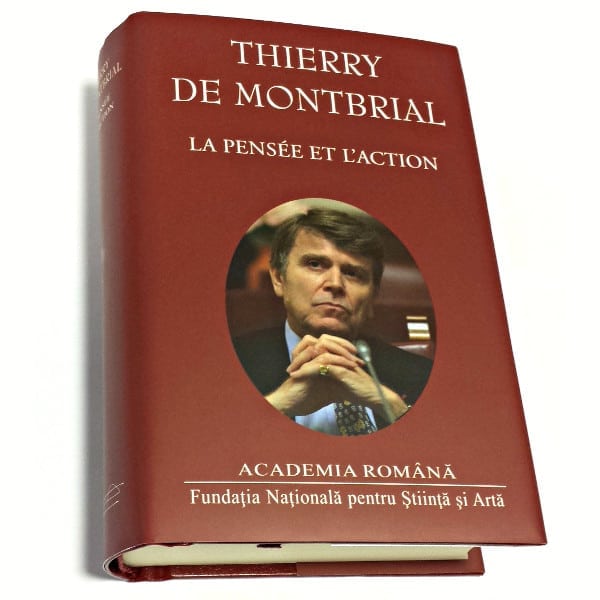Vers l’Europe, « nation extraordinaire » ?
Publié dans Le Courage de réformer, sous la direction de Claude Bébéar, Paris, Odile Jacob, 2002
En 1867, Victor Hugo, visionnaire comme peuvent l’être les poètes, prédisait l’avènement d’une « nation extraordinaire ». « Cette nation, écrivait-il, aura pour capitale Paris et ne s’appellera point la France : elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera l’Europe au XXe siècle, et aux siècles suivants, plus transfigurée encore, elle s’appellera l’Humanité. »
C’est au lendemain de la Grande Guerre et dans le sillage de l’idéalisme wilsonien qu’a émergé le projet d’une Union européenne distincte du rêve impérial, celui de Charlemagne ou de Napoléon. L’idée était d’établir, sur la base d’un véritable contrat, une association entre les États du continent dont les limites restaient à définir. Ce projet a même fait l’objet d’un mémorandum d’Aristide Briand, alors ministre des Affaires étrangères, rédigé par le diplomate Alexis Leger – plus connu sous le nom de Saint-John Perse. Celui-ci fixa en partie le vocabulaire de la future Communauté, évoquant les « États-Unis d’Europe ». Il s’agissait, en juillet 1929, de tenter de créer « une sorte d’union fédérale » entre les États européens membres de la Société des Nations (SDN).
On pourrait faire tout un ouvrage avec les références anciennes plus ou moins clairvoyantes à une « Union européenne ». Mais, pour que ce rêve plausible pût commencer à prendre corps, il a fallu le « suicide », la mort, avant la résurrection. Le second grand conflit mondial de 1939 à 1945 et ses conséquences ont servi d’électrochoc aux élites européennes. Nous ne reprendrons pas ici l’histoire bien connue des débuts de l’unification européenne effective et de la « géniale fuite en avant » (l’expression est de Robert Toulemon) engagée avec le plan Monnet . Toutefois, gageons qu’une étape fondamentale a été franchie, le 1er janvier 2002, avec la mise en circulation d’une monnaie commune, l’euro, dans douze pays de l’Union européenne.
La densité croissante des liens tissés, la multiplication des signes tangibles, comme le drapeau, le passeport et les billets de banque, rendent concevable, un jour, la cristallisation d’un sentiment communautaire qui donnerait enfin consistance au vieux rêve européen.
Une telle perspective, qui s’inscrit dans le long terme, ne doit pas conduire à sous-estimer les obstacles qu’il reste à franchir. Les forces centrifuges sont nombreuses et, à l’heure actuelle, elles ne trouvent guère de contrepoids dans un désir d’Europe, unanime et enthousiaste. Ainsi est-il essentiel, pour poursuivre cette aventure unique dans l’histoire de l’humanité et rendre l’Europe aux Européens, de sortir de la simple « logique de l’engrenage », utile mais non suffisante, en proposant un vrai projet politique aux contours clairs.
L’Union européenne est une association d’États instaurant une forte solidarité entre ses membres, lesquels acquièrent des droits, en particulier dans l’ordre des transferts économiques, mais doivent aussi avoir des obligations. Encore faut-il que les règles soient clairement formulées, particulièrement vis-à-vis des nations pressées de rejoindre le club. C’était tout l’enjeu du Conseil européen qui s’est tenu à Nice en décembre 2000 sous la présidence française. La repondération des voix, l’élargissement du vote à la majorité qualifiée, la recomposition de la Commission et l’extension des coopérations renforcées avaient pour but de permettre à l’Union de s’élargir en évitant la paralysie.
Les résultats du sommet de Nice, au vrai peu enthousiasmants, ont suscité – notamment en France – des réactions d’autant plus négatives qu’il s’agissait de garantir l’avenir en assurant les conditions institutionnelles propres au bon fonctionnement d’une Union à vingt-sept membres. Il est effectivement permis de douter que le résultat ait été atteint. En particulier, les commentateurs ont eu raison de critiquer le byzantinisme des procédures de décision prévues dans le traité de Nice, qui risque d’aggraver un « déficit démocratique » justement dénoncé comme excessif. Il est vraisemblable, cependant, que ce texte, imparfait, sera ratifié par les Quinze, malgré le résultat négatif du référendum irlandais du 8 juin 2001, dont on s’attend généralement à ce qu’il soit inversé ultérieurement. Quoi qu’il en soit, Nice n’est pas un point d’aboutissement, et il faudra sans doute encore beaucoup de temps pour que l’Union stabilise son cadre institutionnel. Si la ratification est souhaitable, c’est que Nice a au moins l’avantage de fournir un point de référence, non pas absolument fixe, mais assez ferme, à la fois pour les membres actuels et pour ceux qui les rejoindront prochainement. Un tel point de référence est nécessaire pour éviter de s’égarer.
Cela dit, il faut renoncer à l’ambition manifestement illusoire d’une résolution satisfaisante et durable des problèmes institutionnels préalablement à l’élargissement. L’une des hypothèses actuelles est même celle d’un « big bang », c’est-à-dire d’une intégration rapide des douze pays candidats (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Chypre, Malte, Roumanie et Bulgarie).
Pour accomplir son destin, l’Union européenne semble condamnée, encore une fois, à mettre la charrue devant les bœufs. Elle l’a fait, brillamment, avec la mise en place de l’euro, et il s’agit de faire désormais en sorte que cette monnaie devienne viable sur le long terme. Ce pari n’est pas encore gagné, mais on sait que le coût d’un échec serait tellement élevé pour chacun des participants à la zone euro que l’incitation à la réussite collective est considérable. Il en sera de même pour l’élargissement. Puisque l’on ne peut ni repousser indéfiniment les échéances ni trouver assez rapidement de bonnes solutions institutionnelles, il n’y a d’autre choix que d’aller de l’avant avec un système très imparfait, mais que l’on s’obligera ensuite à améliorer, sous peine d’une catastrophe collective. C’est ce que les théoriciens des jeux appellent une stratégie du « bord du gouffre ». Mais en existe-t-il une qui soit à la fois meilleure et réalisable ?
En fait, aucun aménagement ne peut suppléer l’absence d’une vision partagée de notre avenir en tant qu’Union. Tel est le vrai problème. Or chacun des États membres semble plus soucieux de s’agripper à des intérêts étroitement conçus qu’à un grand projet commun. À cet égard, les marchandages auxquels se sont livrés les Quinze réunis à Laeken, le 15 décembre 2001, à propos de l’attribution des sièges des nouvelles agences européennes, notamment pour la sécurité alimentaire et maritime, ne contribuent guère à situer le débat au bon niveau.
Derrière cette énième péripétie, à laquelle il ne faut pas accorder trop d’importance, même si elle traduit la vitalité des égoïsmes nationaux, il est des réalités plus inquiétantes comme le manque de vision commune et la permanence de lignes de failles, prêtes à rejouer à tout moment, entre ceux qui adhèrent pleinement à la construction européenne et les opportunistes pragmatiques, parmi lesquels on rangera, sans mystère, la Grande-Bretagne.
Dès l’origine, l’Union européenne a été marquée du sceau du libéralisme, mais deux conceptions n’ont en fait cessé de s’affronter : une conception « française », favorable (jusqu’à un certain point) à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux à l’intérieur de l’Union ainsi qu’à un certain degré de protectionnisme vis-à-vis de l’extérieur (typiquement dans le domaine agricole), plus ou moins justifié par des considérations sécuritaires ou identitaires ; une conception « britannique », favorable au libre-échange sans restrictions géographiques et donc à une Europe ouverte sur l’extérieur. En termes politiques, on retrouve la querelle entre l’Europe « européenne » et l’Europe « atlantique », fondement de l’opposition du général de Gaulle à l’adhésion de la Grande-Bretagne, opposition levée par son successeur, Georges Pompidou (premier élargissement des Communautés européennes à la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark en 1972).
Très rapidement, le succès du traité de Rome posa la question de la coordination des politiques économiques et monétaires. Rappelons-en rapidement les principales étapes : plan Barre de 1969 ; création du « serpent monétaire » en 1972, sitôt après l’éclatement du système de Bretton Woods ; mise en place du système monétaire européen en 1979. Dans le contexte de la révolution des technologies de l’information, et de ses conséquences notamment sur les services, l’Acte unique de 1986 fut conçu comme un coup d’arrêt à ce que l’on appelait alors I’« eurosclérose » et permit l’approfondissement du marché intérieur. Beaucoup plus audacieux, le traité de Maastricht de 1992 aboutit, le 1er janvier 1999, à la mise en place d’une monnaie unique. Le traité d’Amsterdam, de juin 1997, vint couronner cet édifice.
L’euro a donné une autre ampleur à la construction européenne. Un des enjeux essentiels pour le début du XXIe siècle est de stimuler la concurrence structurelle afin que la zone euro devienne – ce qu’elle n’est pas encore – une zone monétaire optimale, au sens précis du terme, c’est-à-dire une zone où coexistent un bon équilibre interne (en référence à l’inflation et au chômage) et un bon équilibre externe (par rapport à la balance des paiements). Cette réalisation conditionne à terme la viabilité de l’euro et, au-delà, celle de la construction européenne.
Celle-ci reste également et durablement fragilisée par l’ambiguïté d’une relation transatlantique dont la dimension culturelle ne cesse d’ailleurs de se renforcer. À Varsovie, le 15 juin 2001, George W. Bush ne s’est pas embarrassé de précautions oratoires. Fort de toute l’histoire du XXe siècle et, en particulier, de la dernière décennie, et insensible comme la plupart des Américains à la distinction entre l’Union européenne et l’Alliance atlantique – toutes deux considérées comme des organisations internationales, la première subordonnée à la seconde –, le nouveau président des États-Unis n’a pas hésité à déclarer que l’Union européenne doit s’étendre à tous les pays du continent eurasiatique « de la Baltique à la mer Noire ». L’OTAN doit, selon lui, assurer pleinement la sécurité de ce vaste ensemble. L’hôte de la Maison-Blanche n’envisage l’organisation européenne que strictement encadrée par l’Alliance sous direction américaine. Il ne conçoit pas la possibilité d’appréciations, ni a fortiori d’intérêts divergents. La gestion de la riposte aux attentats du 11 septembre 2001 en est une nouvelle illustration, même si les Américains ont multiplié les consultations. Pour George W. Bush, il va de soi que ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour l’Europe, et même pour le monde. Il l’affiche sans états d’âme.
Face à cette affirmation de puissance virtuelle, les Européens – par opportunité ou par conviction – courbent l’échine. L’Espagne avec Aznar, l’Italie avec Berlusconi penchent idéologiquement vers l’Amérique libérale et sont disposées de bonne grâce à lui faire allégeance. Ce n’est évidemment pas un hasard si Madrid fut la seule grande capitale européenne retenue comme étape du voyage présidentiel. En outre, les raisons qui, après la défaite de 1945, ont poussé l’Allemagne et les États-Unis l’une vers l’autre n’ont pas fondamentalement disparu. Berlin, aujourd’hui, est à peine davantage disposé que Bonn, hier, à faire le choix d’une « Europe européenne », dont Washington ne veut pas.
Quant à la Grande-Bretagne, elle se considère toujours comme le partenaire privilégié de l’Amérique. Son rôle dans les opérations menées en Afghanistan, aux côtés des États-Unis, après les attaques terroristes, le démontre encore. Même si son réalisme lui a commandé, depuis 1998, un effort de rapprochement avec la France (accord de Saint-Malo), le discours prononcé par Tony Blair, à la fin du mois de novembre 2001, témoigne de l’ambiguïté persistante de la position britannique. Or son influence est loin d’être négligeable en Europe centrale et orientale. L’un de ses vecteurs privilégiés est la langue, qui a largement supplanté le français, longtemps favorisé au sein des élites hongroises, bulgares ou roumaines, mais qui ne subsiste plus guère aujourd’hui que sous la forme de buttes témoins.
Les conceptions britanniques peuvent avoir un impact d’autant plus puissant que les anciens pays satellites de l’URSS aspirent à jouir pleinement de leur souveraineté fraîchement retrouvée. Soucieux de se voir ouvrir les portes du grand marché européen, ils n’entendent pas pour autant abdiquer une indépendance chèrement acquise, après des années de luttes et de frustrations. Ces États, même s’ils ont une longue histoire, doivent être considérés comme de jeunes unités politiques, jalouses de la conduite de leurs affaires. Elles voient bien souvent dans la souveraineté « partagée », conséquence inéluctable de l’adhésion à l’Union européenne, une souveraineté « limitée ».
En outre, ces pays, pour la plupart traumatisés par la période soviétique et par les conditions qui l’ont rendue possible dans l’entre-deux-guerres, ne font encore vraiment confiance qu’aux États-Unis en matière de sécurité, même si l’on peut relever leur intérêt croissant pour l’« identité européenne de sécurité et de défense ».
Les collaborateurs de George W. Bush étaient évidemment conscients de ce qu’ils faisaient en choisissant Varsovie pour le grand discours du président des États-Unis. En fin de compte, le projet européen reste encore largement mêlé à l’euro-atlantisme. Toute tentative de distinguer clairement l’Union européenne de l’Alliance se heurte aussitôt à la réprobation des atlantistes, dont les rangs ont encore grossi depuis la chute de l’URSS. Les Américains considèrent toujours avec méfiance les Français, constamment prêts, selon eux, par nostalgie d’un passé révolu, à leur créer des difficultés. Cette image perdure alors que nous sommes devenus très discrets, aussi bien dans l’affirmation du projet d’une « Europe européenne » que dans la recherche d’une organisation du monde plus respectueuse de la diversité des peuples et de leurs cultures. Au lendemain du discours du président Bush à Varsovie, il est remarquable que la seule personnalité politique européenne à s’être fortement exprimée pour rappeler que les États-Unis n’étaient tout de même pas membres de l’Union européenne et ne pouvaient par conséquent prétendre parler en son nom ait été le conservateur britannique Chris Patten, le dernier gouverneur de Hongkong.
Néanmoins, la position américaine, dont on discerne aisément les tenants et les aboutissants, souligne bien les incertitudes qui pèsent sur l’Europe, tant dans la définition de limites géographiques précises – source d’inépuisables débats – que dans celle de critères d’appartenance. Après tout, si l’on a enfin reconnu à la Turquie le droit d’être candidate à l’intégration, est-il légitime d’en exclure la Russie ?
Si l’on ajoute à ces éléments de fragilité les tentations de « renationalisation » illustrées par la vigueur des propos souverainistes, y compris dans les États les plus motivés et les plus anciens de l’Union, on comprend tout l’enjeu d’un discours cohérent sur l’Europe. Tel doit être l’objectif de la Convention sur l’avenir de l’Europe, constituée au sommet de Laeken en décembre 2001.
« Il nous faut réfléchir à ce que doit devenir l’Europe du XXIe siècle, une Europe simple, accessible et capable de faire rêver ; une Europe qui représente dans le monde une zone de paix, de tolérance, de prospérité et de sécurité. » C’est en ces termes que Valéry Giscard d’Estaing, tout juste nommé président de la Convention sur l’avenir de l’Europe, définit sa mission.
Pour inventer l’Europe de nos rêves, il me paraît indispensable de revenir à la nation. Question européenne et question nationale sont en effet inextricablement liées et elles manifestent deux expressions de la même interrogation géopolitique. Pour la penser correctement, peut-on faire mieux que de suivre la démarche d’Ernest Renan dans sa célèbre conférence du 11 mars 1882 à la Sorbonne ? Si, à sa question « Qu’est-ce que la nation ? », on substitue « Qu’est-ce que l’Europe ? », on peut dessiner les contours d’une unité politique nouvelle. Comme la nation, l’Europe est la résultante d’une tension entre un présent, un vouloir-vivre ensemble à inventer, à créer, et un passé qui fonctionne comme un gisement de souvenirs communs à interpréter ou à réinterpréter constamment. Notons à ce propos que Renan n’hésite pas à faire l’éloge de l’oubli. « L’oubli, dit-il, et je dirai même l’erreur historique sont un facteur essentiel de la formation de la nation. » Là encore, on peut substituer « Europe » à « nation ». Pareil discours n’est pas « politiquement correct » à une époque où l’on ne parle que de « devoir de mémoire » ou de « repentance », mais il est bon de le méditer. Il ne s’agit certes pas d’édifier sur le mensonge, mais, de fait, l’Europe se construit sur des territoires imbibés du sang des nations. Il ne s’agit pas de mentir, mais d’interpréter pour transposer, pour produire l’inversion du livre de Job, pour changer le Mal en Bien.
Son originalité est aussi grande qu’a pu l’être autrefois l’État-nation dans sa forme naissante. Mais il faudra du temps et aussi des circonstances favorables pour transformer une association de raison en une véritable communauté, pour fabriquer une unité politique au sens plein du terme. On imagine encore difficilement l’Europe en tant que telle, vainqueur de la Coupe du monde de football et suscitant, d’un bout à l’autre de son étendue, les passions collectives vécues en France après sa victoire contre le Brésil le 12 juillet 1998.
Pour entretenir la dynamique européenne, toujours susceptible d’être enrayée, a fortiori dans le contexte actuel d’un élargissement rapide, l’élaboration d’une Constitution est un enjeu essentiel. Ce n’est pas un hasard si l’intérêt pour le thème constitutionnel a brusquement augmenté depuis 1999.
Les faibles taux de participation aux dernières élections du Parlement européen ont contribué à mettre en valeur le manque de légitimité du système politique de l’Union européenne dans l’ensemble des pays membres. L’adoption de la monnaie commune renforce encore le sentiment d’un décalage entre une intégration économique et monétaire croissante et un cadre politique inadapté à la « révolution » européenne en marche.
C’est le ministre des Affaires étrangères allemand Joschka Fisher qui a lancé, en mai 2000, le débat sur une loi fondamentale européenne en préconisant la mise en place d’une fédération fondée sur une Constitution. Le président Jacques Chirac a rebondi en proposant devant le Bundestag à Berlin une vision plus pragmatique mais également exigeante.
Le moment est apparemment venu de parler sérieusement d’une question naguère jugée purement spéculative, parce que la conjugaison de l’affaire autrichienne et de la pression de l’élargissement a fait prendre conscience de l’urgence. Il est vrai que, si l’Union européenne avait été pourvue d’une loi fondamentale spécifiant clairement les valeurs essentielles sur lesquelles repose l’édifice en construction, le président Klestil n’aurait pas eu à rédiger lui-même hâtivement un texte pour le soumettre à la signature de Jörg Haider et de Wolfgang Schüssel, avant de nommer celui-ci chancelier fédéral. L’épisode contestable des sanctions n’aurait pas été considéré comme nécessaire pour aboutir à l’idée de la mise sous surveillance du gouvernement autrichien afin de vérifier la conformité de ses actes aux principes de l’UE. Plus on élargit l’Europe, et plus la probabilité d’occurrences de situations délicates augmente à cause des réminiscences possibles d’un passé non digéré. Il faut donc se doter d’un cadre légal, c’est-à-dire constitutionnel, prévoyant notamment les conséquences auxquelles les contrevenants s’exposeraient.
Mais on ne doit pas se laisser piéger par l’affirmation simpliste selon laquelle une telle Constitution supposerait le choix d’une Europe fédérale. Cette affirmation est erronée. Ceux qui en doutent se reporteront utilement au projet de Constitution pour l’Europe publié par l’hebdomadaire britannique The Economist, le 28 octobre 2000. Ce texte est d’autant plus intéressant qu’il est précisément aux antipodes du fédéralisme. D’autres schémas ont émergé, ici ou là, notamment en France sous la houlette d’Alain Juppé et de Jacques Toubon. La Belgique réclame un débat sur l’« impôt européen », L’Allemagne voudrait une Europe fédérale sans budget fédéral. Il est bon que tout ce foisonnement ait lieu. Il est bon que le débat tende à se structurer. Ainsi ai-je eu plusieurs fois dans un passé récent l’occasion de constater que les agriculteurs des pays membres, mais aussi des pays candidats, parlaient le même langage et discutaient autour du même agenda. Cette mise au diapason est l’un des signes les plus encourageants d’une véritable communauté en voie de formation. De ce point de vue, le pessimisme dominant de la plupart des discours actuels sur l’Europe est largement injustifié. Il est également dangereux, comme toutes les self-fulfilling prophecies.
Pour en revenir à l’« après-Nice », en particulier au débat sur la Constitution européenne, l’important à ce stade n’est pas de se prononcer sur tel ou tel projet : c’est de reconnaître la nécessité d’une sorte de loi fondamentale dont le rôle est d’améliorer la légitimité démocratique des décisions prises à l’échelon européen, et de garantir l’aptitude des appareils, législatif et exécutif européens à agir efficacement à une nouvelle échelle.
Il s’agit d’expliciter les buts de la construction européenne et les valeurs sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les principes généraux de l’organisation des procédures de décision, pour les rendre intelligibles au plus grand nombre.
Il s’agit aussi d’identifier le noyau dur des politiques communes en rapport, typiquement, avec la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou avec l’« identité de sécurité et de défense » – comme dans l’ordre commercial et monétaire –, sans lesquelles l’Union resterait une coquille vide. En la matière, la gestion de l’affaire yougoslave n’a pas été brillante, mais elle aurait pu être bien pire. S’agissant plus particulièrement de la défense, l’Eurocorps exerce désormais la responsabilité majeure au Kosovo en matière de sécurité. La décision a été prise de constituer pour 2003 une capacité de projection de 60 000 hommes utilisable sur les théâtres européens ou dans leur voisinage. Dans ce domaine essentiel de la défense et de la sécurité, la difficulté n’est pas seulement la nature de la relation avec Washington, qui touche effectivement au cœur de l’identité européenne, mais aussi l’insuffisance des moyens budgétaires que les Européens lui consacrent. C’est également l’écart financier avec les États-Unis qui explique l’augmentation du technological gap, auquel nulle fatalité ne nous condamne.
À la fin du siècle, l’Europe, déresponsabilisée et culpabilisée, éprouve globalement une certaine jouissance à s’en remettre à l’Amérique pour les décisions graves. C’est aussi pourquoi la rédaction d’une Constitution, si difficile soit-elle à mettre en œuvre à quinze et plus, est devenue indispensable. Un tel texte devrait être bref, suffisamment clair pour que chaque citoyen européen éduqué puisse en comprendre l’inspiration, et suffisamment souple pour que le système puisse s’adapter sans impliquer de fréquentes révisions de la loi fondamentale.
Sur tous ces plans, la Constitution américaine de 1787 est un chef-d’œuvre qui peut nous servir, non pas de modèle, mais de référence. Non de modèle, car les citoyens européens continueront d’appartenir à des peuples différents. Cette diversité même fait la richesse de leur union. Diversité en fait croissante, en raison de l’élargissement à des pays longtemps séparés – depuis presque mille ans s’agissant du grand schisme orthodoxe. Mais référence, car il s’agit, au-delà de cette diversité, d’exprimer les raisons et les modalités essentielles d’un « vouloir-vivre ensemble », de sorte que les unités membres ne soient pas abolies en tant qu’États-nations, mais coopèrent en vue d’une finalité supérieure aux intérêts nationaux tels que l’on a pu les formuler au cours des deux siècles écoulés, et que soient rassemblés aussi bien les citoyens des six États fondateurs que les Roumains d’lliescu ou les Bulgares de Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha.
Une Constitution européenne ne sera jamais qu’un texte. Mais le langage et l’écriture sont des attributions majeures de l’intelligence humaine, ainsi qu’elle s’exprime en particulier dans les œuvres politiques. Il est vrai que les lois écrites ne valent qu’intériorisées, incarnées, vécues. Aussi, l’un des problèmes majeurs est que la culture de l’Union européenne actuelle et potentielle (à vingt-sept membres ou plus) au sens d’un ensemble stable de pratiques, de références et de croyances communes reste incertaine. Il ne faut pas, en effet, confondre la culture ainsi entendue avec le cosmopolitisme traditionnel des élites européennes d’Érasme à Stefan Zweig, ni même avec le brassage temporaire des populations, conséquence des nouveaux moyens de communication et d’échanges.
Ceux-ci, comme l’euro et la liberté de circulation, favorisée par les accords de Schengen, facilitent et faciliteront l’émergence d’une culture commune, mais, en tant que tels, ils ne la créent pas. Pour cela, il faut que prolifèrent des unités actives plurinationales dévouées à cette cause, et que ces unités actives fassent pousser des racines. Or les unités actives qui, au tournant du siècle, sont efficaces en Europe se rattachent clairement plus au monde des affaires qu’à celui de la culture. L’Organisation européenne ne s’est pas suffisamment préoccupée d’encourager l’émergence, en ce sens, d’une société civile commune. C’est ainsi, sans doute, qu’il convient d’interpréter le mot de Jean Monnet, souvent cité : « Si c’était à refaire, je commencerais par la culture. » En amont de ces constatations, on peut dire que l’aventure européenne, près d’un demi-siècle après son démarrage effectif, souffre plus d’un affaiblissement idéologique que d’un déficit démocratique. Les peuples sont unis par des liens de type plus sociétaire que communautaire, d’où l’impression que la construction d’ensemble est excessivement « technocratique ».
La formalisation d’une Constitution est un préalable qui facilitera l’identification du citoyen à l’Europe en renforçant la légitimité des institutions. Encore faudra-t-il bien réfléchir à la composition d’une assemblée constituante où devraient figurer toutes les personnes ayant œuvré pour la cause européenne. Elles serviront de caution aux yeux de l’opinion publique. L’un des grands défis que les constituants auront à relever est l’enfantement d’une unité politique inédite, capable de concilier unité et diversité. Cette conciliation, gage de longévité et de sécurité, ne peut se faire qu’au prix d’une réflexion sur la démocratie et le problème des minorités.
La chute des empires, le redécoupage des cartes auquel on a beaucoup procédé dans ce siècle, ont été accompagnés de déplacements massifs de populations. Un gigantesque échange eut lieu au lendemain de la guerre gréco-turque de 1921-1922, dont les Grecs se souviennent comme de la « grande catastrophe ». Une partie de la population grecque d’Asie mineure avait déjà fui lors de la prise de Smyrne par les Turcs. Aux 125 000 Turcs ayant quitté la Grèce de 1912 à 1923 s’en ajoutèrent 350 000 autres, et au 1,1 million de Grecs qui avaient quitté l’Asie mineure s’en ajoutèrent 190 000. Après 1945, les Allemands dispersés dans l’Europe balkanique, ceux de Tchécoslovaquie (les Sudètes) et des territoires désormais attribués à la Pologne et à l’URSS (Prusse-Orientale, Poméranie, Silésie) furent en majorité expulsés en direction de l’Allemagne. Cette migration forcée a affecté plus de dix millions de personnes. Par ailleurs, deux millions de Polonais furent chassés de l’ancienne Pologne orientale, et des centaines de milliers de Finlandais quittèrent leur pays plutôt que de se voir rattachés à l’Union soviétique.
Malgré tous ces bouleversements, l’Europe de la seconde moitié du XXe siècle conservait encore de nombreuses minorités, surtout à l’Est : Hongrois en Roumanie, Hongrois et Albanais en Yougoslavie par exemple. Mais la guerre froide a permis de geler les conflits ethniques ou de les masquer, comme les déplacements forcés à l’intérieur de l’URSS des années 1930, restés inconnus ou tout au moins ignorés des Occidentaux. Le principe des nationalités et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont des idéologies simplistes parce qu’unilatérales : la coexistence pacifique de peuples différents suppose la reconnaissance mutuelle de droits et de devoirs, donc un contrat entre eux et la mise en œuvre d’une organisation politique conforme au principe de la bonne gouvernance. Ces idéologies, issues du siècle précédent, ont pourtant inspiré bien des politiques au XXe siècle, à commencer par les quatorze points du président Wilson. Le retour à la paix a démontré, s’il en était besoin, la difficulté de concilier démocratie et respect des minorités, particulièrement sur des territoires où les populations se sont imbriquées au cours des mouvements longs de l’histoire.
La tâche la plus fondamentale et peut-être la plus difficile pour l’accomplissement de la construction européenne, alors que nous nous apprêtons à l’élargir massivement vers l’Est, est la solution d’un problème qui s’apparente à la quadrature du cercle : celui de la coexistence démocratique, sur un même territoire, de peuples différents. De ce point de vue, la guerre de 1999 n’a évidemment rien réglé au Kosovo. On notera, incidemment, qu’il y a une certaine hypocrisie à exiger de la Turquie qu’elle remplisse les « critères de Copenhague » avant de pouvoir adhérer à l’Union. Dans l’état actuel des choses, on voit mal ce pays résoudre rapidement la question kurde, au demeurant attisée de l’extérieur, et les Européens seraient probablement bien embarrassés de devoir « internaliser » cette affaire.
Plus nous élargirons vers l’Est et, de façon générale, plus nous tendrons à former une grande Europe, plus nous accroîtrons son potentiel de dissociation . La France jacobine, qui peine tant à « résoudre » le problème de la Corse, une île peuplée seulement de 260 000 habitants, est particulièrement mal placée face à ce genre de sujets. Les conseils que nous pouvons donner aux Turcs pour les Kurdes ou aux Russes pour les Tchétchènes ne les éclairent sans doute que d’une très faible lueur. Quand le temps sera venu de rédiger effectivement une Constitution européenne, chacun devra faire bénéficier l’ensemble de sa propre expérience. Ainsi, s’agissant des minorités, peut-être l’Autriche aura-t-elle à apprendre aux autres.
La diversité, richesse de l’Europe, doit être préservée, mais elle doit aussi être maîtrisée pour ne pas devenir un obstacle à la naissance de cette véritable « communauté » européenne que nous appelons de nos vœux.
Pour relever avec succès tous ces défis, il faut à l’Europe un moteur. Par son histoire exemplaire, le couple que constituent la France et l’Allemagne, ennemies d’hier, reste le plus apte à donner un second souffle à l’Union. Ces deux nations, avec leurs différences et, précisément, à cause d’elles, peuvent ensemble mais sans exclusive donner les impulsions décisives à une véritable synthèse européenne qui ne soit pas synonyme d’appauvrissement.
De fait, alors que nous sommes embarqués dans une aventure qui devrait enthousiasmer nos peuples, les débats sur les questions européennes sont généralement entourés d’un sentiment de lassitude, et l’on voit bien en France que les plus beaux parleurs sont du côté des « souverainistes ». L’Europe manque de hérauts, de prophètes. Ce n’est pas parce que les citoyens européens voyagent facilement dans le cadre des accords de Schengen et maintenant plus encore qu’ils disposent d’euros en billets – toutes choses considérées à tort comme allant de soi – qu’ils ont le sentiment d’appartenir à une véritable communauté. Il suffit de constater l’ignorance abyssale, chez chacun de nos peuples, de l’histoire des autres. La légitimité de la construction européenne exige d’abord une clarification des procédures de décision, de façon à ce que chacun puisse comprendre qui décide quoi et comment, et en vertu de quel mandat.
La première priorité est donc la rédaction d’une Constitution. Elle doit se faire parallèlement à un élargissement rapide – deuxième priorité –, aboutissant, avec des périodes de transition appropriées, à une Europe à vingt-sept.
Troisième priorité : la réactivation du moteur franco-allemand. Lui seul permettra de mener à bien l’intégration européenne en limitant les risques d’implosion ou de dilution. En faisant leurs ces trois priorités, les responsables politiques de notre pays pourront faire de l’Europe l’avenir de la France.