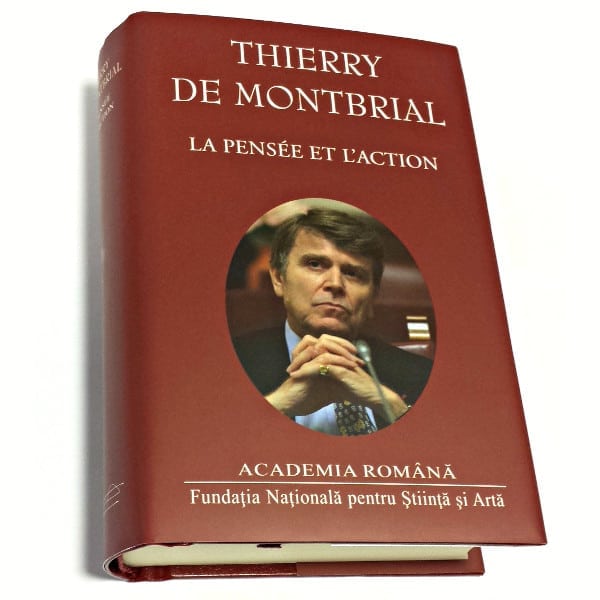Qu’est-ce qu’une puissance au XXIe siècle ?
Communication à l’Académie des Sciences Morales et Politiques, le 7 janvier 2013
Avant de tenter d’éclairer cette question, il convient de s’entendre sur les concepts. Celui de puissance, qui s’applique à toute unité active et en particulier à toute unité politique, est l’un des plus discutés dans la littérature. Il prête à beaucoup de confusion. Je commencerai donc par préciser ma propre interprétation. Il importe de distinguer entre pouvoir et puissance.
J’appelle pouvoir d’une unité active la capacité de mobiliser ses ressources dans des directions déterminées, et potentiel l’ensemble des objectifs virtuellement atteignables par cette mobilisation. La notion de puissance concerne le passage du virtuel au réel, c’est-à-dire le passage à l’acte, à la fois discontinuité et choix. Toute unité active dispose de ressources. Dans la littérature américaine actuelle, on parle souvent des resources of power, sans d’ailleurs distinguer, s’agissant du mot power, entre pouvoir, potentiel et puissance . L’Organisation qui dirige l’unité active exerce, par définition, le pouvoir collectif. Typiquement, le Gouvernement pour un État. Cette Organisation peut elle-même s’analyser comme une unité active et ainsi de suite, comme des poupées gigognes. L’identification du potentiel est un travail qualitatif auréolé d’incertitude qui repose sur une analyse de l’environnement et sur une réflexion concernant le croisement des stratégies, celles de l’unité active en question, et celles de ses partenaires comme de ses opposants.
Sans ressources, il n’y a ni pouvoir ni potentiel. Une unité active peut disposer de ressources sans être capable de les mobiliser dans une direction voulue. Dans les deux cas, le problème de la puissance ne se pose pas. Naturellement, ces deux situations extrêmes n’existent pas dans la réalité. Toute unité active dispose d’un minimum de ressources et d’un minimum de capacité d’en faire usage. Mais on ne doit pas négliger le troisième cas, où l’impuissance provient non pas de l’absence de ressources ou de direction, mais du blocage dans une conjoncture particulière, face au passage à l’acte. Répétons que le passage à l’acte, c’est-à-dire la transition du virtuel au réel, est toujours une discontinuité. J’ajouterai, sans insister ici, l’importance de la notion de temps en arrière-plan des considérations qui précèdent : celle de la durée créatrice bergsonienne, capitale dans la mise en œuvre de toute stratégie ; celle du kairos, de l’art du bon moment pour tout passage à l’acte. Et lorsqu’une action est engagée, elle entraîne un flux de décisions subsidiaires qui ont chacune leur micro-kairos, comme notre confrère Evanghelos Moutsopoulos le montre lumineusement dans ses travaux.
Les ressources, humaines et matérielles, sont donc à la base de la puissance. Par ressources humaines, j’entends le capital humain dans l’acception pleine du terme, avec ses dimensions démographiques au sens large, mais aussi les forces morales, typiquement dérivées de la culture, de l’idéologie, de la religion ou des émotions. Un aspect essentiel de l’idéologie concerne les territoires, et constitue l’essence de la géopolitique. Observons, ici encore, l’importance de la durée. Ces facteurs opèrent en effet à des échelles de temps fort différentes. Le temps des émotions est évidemment le plus court et en ce sens le moins marquant.
Ainsi entendues, les ressources humaines incluent le travail au sens économique, mais aussi les facteurs déterminants du soft power. Cette expression, forgée par le professeur Joseph Nye dans le contexte de ses travaux sur l’avenir de la puissance américaine, se réfère à la capacité d’obtenir des autres ce que l’on veut qu’ils fassent, sous le seul effet de la conviction. Le rayonnement des cultures et le mouvement naturel des idées en sont des manifestations particulières. Le soft power est donc d’ordre psychologique et sociologique. Par contraste, le hard power concerne la mobilisation de ressources tangibles, lesquelles recouvrent évidemment une gamme très large de biens souvent complémentaires qu’il s’agisse par exemple de faire de la propagande, de diffuser une culture, de menacer de faire la guerre ou de la faire effectivement. Je ne donne pas ces exemples au hasard, mais pour montrer qu’en pratique le soft power est presque toujours associé à une dose de hard power. Toujours inspiré pour forger de nouvelles expressions, Joseph Nye parle aussi de smart power pour qualifier ce type de couplage, où le hard power intervient en somme en soutien au soft power. Il fut un temps où l’Union soviétique excella dans ce domaine et, de nos jours, les exemples abondent. Je pense par exemple à la Chine et aux Jeux olympiques de 2008. Les unités actives, en particulier les unités politiques, sont inégalement habiles face à l’exercice du smart power. En particulier, quand il s’agit de travailler sur leur image et leur réputation.
Après cette digression, venons-en aux ressources matérielles. Celles-ci comprennent la terre et le capital des économistes dits classiques, mais il convient d’élargir ces concepts. Du point de vue économique, la « terre » se réfère aux ressources du sol, du sous-sol et de l’espace, éventuellement à l’attrait des paysages (en liaison avec le tourisme). Pour un État, l’espace a des qualités propres de même que la population ne se réduit pas à la force de travail. Ainsi l’étendue de son territoire fut-elle pour la Russie un avantage face aux visées de Napoléon ou de Hitler, mais elle est peut-être aujourd’hui un désavantage face à la Chine, même si les deux pays ont réglé leurs différends territoriaux. Autre exemple classique : le caractère montagneux de la Suisse est historiquement son atout principal face aux velléités de conquête. Pour la même raison, aucune puissance extérieure n’a réussi jusqu’ici à s’implanter durablement en Afghanistan. Étrangement, les Américains n’ont pas appris cette leçon de leurs prédécesseurs anglais ou russes, et leurs stratégistes ou stratèges n’ont sans doute pas suffisamment médité Clausewitz, dans l’illusion où ils étaient peut-être en 2001, et plus encore en 2003 vis-à-vis de l’Irak, de l’impact de leur soft power. Quant au capital, il recouvre les biens que la science économique désigne sous ce vocable, mais aussi, par exemple, les éléments tangibles sous-jacents au soft power. Songeons, par exemple, au pouvoir d’aimantation qu’exerce une ville comme Paris dans le monde entier.
Cette typologie des ressources, donc des éléments de la puissance, est très générale et son intérêt tient à cette généralité. Mais en pratique, face aux nécessités de l’action, toute unité active, en particulier toute unité politique, doit identifier et évaluer les ressources concrètes pertinentes de son point de vue. S’agissant de l’évaluation, il faut attirer l’attention sur l’erreur commune consistant à définir le potentiel d’une unité active comme la valeur de ses ressources. Je ne parle pas de la difficulté évidente consistant à fixer le prix de chacune, mais de la confusion entre les ressources et leur finalité, c’est-à-dire les objectifs auxquels elles peuvent servir. En économie cela reviendrait à identifier les facteurs de production et le produit. J’insiste sur le fait qu’en général les objectifs, et donc le potentiel, ne sont pas quantifiables.
J’ai défini le pouvoir comme la capacité de mobiliser des ressources dans une direction déterminée. Cette mobilisation et cette direction sont décidées par une Organisation qui elle-même doit souvent être analysée comme une unité active avec sa propre Organisation et ainsi de suite. Ceci conduit à l’idée, essentielle dans les sociétés contemporaines – et certainement de plus en plus dans les prochaines décennies –, de ce que j’ai appelé les « usines de production des décisions ». Un aspect important de cette question est la tendance à l’organisation du pouvoir par ressource, et donc à une forme de séparation des pouvoirs, évidemment différente de celle de Montesquieu. Ainsi parle-t-on couramment de la puissance économique, de la puissance militaire ou du pouvoir culturel. Chacun est associé à une catégorie de ressources, mais aussi à une catégorie d’objectifs pensés comme susceptibles d’être atteints par leur mobilisation, à la limite indépendamment des autres ressources. La tendance au fractionnement, qui est liée à la technicité croissante de chaque domaine, ne s’arrête évidemment pas là. En économie, on distinguera par exemple la puissance industrielle et la puissance financière ; dans les armées, entre la puissance terrestre, navale ou aérienne.
Arrêtons-nous brièvement sur l’exemple militaire, ne serait-ce que traditionnellement, parce que lorsqu’on parlait des États comme des puissances, on pensait d’abord à la guerre. L’attention plus grande que l’on porte aujourd’hui aux autres éléments de la puissance ne doit pas nous faire oublier qu’en fin de compte, dans l’avenir comme par le passé, la sécurité doit rester la préoccupation fondamentale de toute unité politique. Du point de vue militaire, jusqu’à la Première Guerre mondiale, les grandes puissances étaient caractérisées par leur arme dominante. Ainsi l’Angleterre était-elle une « puissance maritime » et la France napoléonienne une « puissance terrestre ». Une puissance maritime pouvait atteindre des objectifs inaccessibles à une puissance terrestre et réciproquement. Du moins le pensait-on souvent, malgré l’épisode du blocus continental. Il semblait en tous cas nécessaire de choisir entre les deux, ne fût-ce que pour des raisons économiques. On notera, au passage, que dans Vom Kriege le grand Clausewitz ne s’intéressa qu’à la puissance terrestre. Des stratégistes postérieurs ont choisi de n’étudier que la puissance maritime. Au XXe siècle est apparue une troisième forme de puissance militaire, la puissance aérienne, à cheval si l’on peut dire avec les deux précédentes. Puis une quatrième, la puissance nucléaire, d’abord considérée comme une extension de la puissance aérienne. Avec cette complexification, le besoin d’envisager méthodiquement des combinaisons pour élargir le potentiel, c’est-à-dire, je le rappelle, l’ensemble des objectifs atteignables, s’est traduit par de nouveaux modes d’organisation ou, pour rester fidèle à mon langage, par une complexification des « usines de production des décisions ».
L’imperfection de telles « usines » est reconnue, au moins depuis la thèse célèbre de Graham Allison sur la crise des missiles de Cuba . Par imperfection, j’entends les inefficacités mais, plus gravement, le risque de produire des décisions aberrantes ou catastrophiques. Je crois que cette question de la coordination des pouvoirs, qui touche à la fois au fonctionnement interne des États et aux différents modes de la coopération internationale, donc à la gouvernance mondiale à tous les niveaux, est l’une des plus importantes qui nous soit posée au XXIe siècle. L’enjeu a considérablement augmenté avec l’apparition du cyber-pouvoir, celui-là non spécifiquement militaire. Il s’agit de la capacité, pour toute sorte d’unités actives, d’agir sur le « cyber-espace », c’est-à-dire sur les systèmes de toute nature qui sont connectés directement ou indirectement via Internet. L’affaire Wikileaks a révélé la fragilité du secret diplomatique. Américains et Israéliens ont apparemment démontré leur capacité à intervenir sur les installations nucléaires iraniennes, ce dont beaucoup peuvent se réjouir, mais on parle moins de cyber-attaques quotidiennes dans le monde, qui font froid dans le dos. Des scénarios cauchemardesques sont devenus concevables sinon probables, comme un accident majeur provoqué sur une centrale nucléaire, la neutralisation de tous les systèmes informatiques d’une banque ou d’un système de communication aérien, ou même l’assassinat à distance de patients porteurs d’équipements thérapeutiques digitalisés. La difficulté est que l’Internet s’est développé de façon épigénétique, de sorte qu’aucun plan n’a inclus les préoccupations de sécurité à son origine. Aujourd’hui, le système est massivement asymétrique, en faveur de l’attaque. Je crains que l’on ne se trompe guère en prédisant l’occurrence d’une catastrophe majeure, tôt ou tard. Il est plus difficile d’en prévoir les conséquences, mais l’une d’entre elles pourrait être une tendance à la nationalisation du Web, ce qui est techniquement possible. Cette perspective n’est d’ailleurs pas la seule dans le sens d’un ralentissement de la mondialisation et d’un retour partiel aux formes plus classiques de la puissance.
La nécessité de coordonner les ressources en vue d’atteindre les objectifs fixés par une stratégie n’est pas propre au domaine militaire, même s’il apparaît là de la manière la plus explicite. D’une manière très générale, la vie des unités actives peut s’interpréter comme un réaménagement continu de son « portefeuille de ressources », résultant, comme disent les statisticiens, des états de la nature, ainsi que des interactions entre les actions menées à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité active. Les échanges avec l’extérieur ne sont pas seulement économiques. Par exemple, une guerre conduit aussi à des « échanges » qui se traduisent par des diminutions ou accroissements de ressources. Aucun état stationnaire n’est possible, ne serait-ce qu’en raison de l’usure naturelle ainsi que de l’obsolescence technologique qui frappe certaines d’entre elles. En d’autres termes, la plupart des ressources, pas seulement économiques, doivent être « amorties ». Le réaménagement des ressources est donc partiellement subi et particulièrement voulu et s’opère, comme je le disais au début, à différentes échelles de temps.
Les ressources ne sont pas des variétés d’un même bien, que l’on pourrait instantanément et sans frais transformer entre elles. Selon l’échelle de temps, elles peuvent être complémentaires ou substituables par rapport à un objectif. Les actions de maintien de la paix supposent à la fois des moyens économiques et militaires. Pour contraindre un adversaire, on pourra choisir entre un régime de sanctions ou une intervention. Face à un risque précis d’approvisionnement en pétrole ou en gaz, on peut intervenir militairement ou mettre en place une politique de diversification, etc.
Au moins une complémentarité à long terme a un caractère fondamental. On ne conçoit pas durablement la puissance militaire sans la réussite économique. La fin de l’URSS illustre cette proposition, qui ne signifie nullement qu’un pays en mauvais état économique ne puisse pas disposer, pendant un certain temps, de capacités militaires suffisantes pour infliger des dommages plus ou moins sérieux à ses adversaires. À l’extrême, ce pourrait être le cas de la Corée du Nord. À cela s’ajoutent les asymétries propres à certaines formes de pouvoir, comme l’ont illustré les événements du 11 septembre 2001. J’ai également parlé de la cyber-puissance. Souvent, mais pas toujours, la réussite économique s’accompagne d’une montée en puissance militaire. Tel a été le cas au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, malgré la Constitution de Mac Arthur. Tel est le cas actuellement en Chine. D’autres pays qui bénéficient depuis longtemps d’un environnement géopolitique plus paisible, comme le Brésil, se montrent moins pressés à cet égard. La complémentarité entre les éléments de la puissance ne s’arrête pas là. Ainsi le soft power d’un pays est-il généralement activé par le succès économique. La remontée en puissance du Japon, dans les années 1970 et 1980, s’est accompagnée d’un rayonnement accru de sa culture. Le même phénomène se produit pour la Chine. Dans les deux cas, il est vrai, mieux vaut parler d’effets du smart power exercé par Tokyo ou par Beijing. À l’inverse, il n’est pas de pays ayant connu un long déclin économique dont le soft power ne se soit évaporé.
Ceci me conduit à reprendre la question du « portefeuille de ressources » d’un État sous l’angle du succès économique, envisagé comme une pré-condition pour toutes les autres formes d’ambition. Y compris, d’ailleurs, dans le domaine social ou environnemental. Car c’est une vieille illusion de croire que le plein-emploi, une meilleure vie pour tous ou la « croissance verte » puissent être compatibles d’une croissance globale zéro. Ce thème était à la mode dans les années 1970 et témoignait en fait d’un étrange mépris pour le Tiers Monde, comme on en disait alors selon l’expression forgée par Alfred Sauvy. Il constituait une mauvaise réponse (« Halte à la croissance ») à la bonne question que s’était posée le Club de Rome, le premier à mettre en lumière l’avènement de contraintes planétaires réellement globales. Tel était le contexte de la première communication que j’eus l’honneur de faire à cette place, en 1976, à la demande de Raymond Aron qui présidait cette année-là notre compagnie, sous le titre « La science économique face à la crise ». De nos jours, plus personne – du moins je l’espère – n’oserait affirmer que l’avenir du monde passe par l’insuccès du Tiers Monde. Sauver la planète, ce n’est pas abolir la croissance, mais l’orienter pour qu’avec l’éradication de la misère et la promotion de la dignité humaine se construisent aussi ce que, par abus de langage, on appelle les « biens publics mondiaux ». Abus de langage, car les biens collectifs ou publics sont a priori indissociables des unités actives ou politiques au sein desquelles ils sont définis de façon opératoire. Or il n’existe pas d’unité politique monde, et l’émergence d’une telle unité paraît hautement improbable à l’horizon du XXIe siècle, si l’on en juge par le rythme de la progression de la construction européenne. Dans ces conditions, l’élan pour la production des biens publics mondiaux devra provenir non pas d’un sommet qui n’existe pas, mais de la base, c’est-à-dire d’une sorte de société civile mondiale peut-être en voie d’émergence.
Tout cela suppose donc le succès économique. Et malgré la mondialisation et la dissolution supposée des États à laquelle on l’associe, c’est au sein des États que se manifeste le succès ou l’insuccès. Deux auteurs américains, Daron Acemoglu et James Robinson – le premier professeur d’économie au MIT, le second professeur de gouvernement à Harvard – ont publié récemment un livre monumental sur ce thème. Ce livre est intitulé Why Nations Fail , tant il est vrai qu’il est souvent plus facile de répondre à une question en s’interrogeant sur son contraire. Avec la routine du raisonnement par l’absurde, les mathématiciens le savent mieux que quiconque. C’est une question de logique. Ainsi est-il peut-être plus facile de comprendre la notion de puissance en partant de son contraire, c’est-à-dire l’impuissance. S’agissant de ce livre, je note l’usage du mot Nation au lieu de State. Mais la différence est plus sensible pour un Français que pour un Américain.
Je ne saurais prétendre résumer en quelques mots un ouvrage fort documenté de près de cinq cents pages, fruit de quinze années de recherche par deux universitaires éminents. Pourtant, leur conclusion est simple, et repose sur la distinction entre « institutions exclusives » et « institutions inclusives ». Des institutions exclusives asservissent un État au profit d’une classe ou d’un groupe. Des institutions inclusives créent les conditions pour que s’épanouissent durablement tous les talents, et d’abord la faculté d’entreprendre. Pour les auteurs, ce sont les révolutions politiques en Angleterre et en France qui ont permis la révolution industrielle, laquelle a cessé de se diffuser là où les régimes politiques sont parvenus à préserver leurs institutions exclusives. En Asie, la transition a été marquée par la restauration Meiji en 1868. Pour l’essentiel, la carte du développement n’a pas changé entre le XIXe siècle et l’ère ouverte dans le dernier tiers du XXe siècle par la révolution des technologies de l’information et de la communication. S’il fallait retenir une date pour marquer la nouvelle transition, je proposerais l’avènement de Deng Xiaoping en Chine, en 1978. Naturellement, à chaque fois que dans un pays les conditions politiques permettent la mise en place d’institutions inclusives, les décisions correspondantes sont moins le produit d’une « grande stratégie » que la conséquence d’une sorte de lutte de classes. Marx était meilleur analyste que précepteur ou prophète. J’ajouterai que, dans la phase du décollage (le take off dont parlait autrefois Walt Rostow, curieusement non cité par Acemoglu et Robinson), la démocratie n’est pas une condition nécessaire. Tout dépend des circonstances. La Corée du Sud a décollé sous le régime autoritaire de Park Chung-hee, le père de la présidente élue en décembre 2012. En Chine, Deng a gouverné avec une main de fer. Sans doute n’aurait-il pas réussi autrement. L’épisode de la place Tiananmen, en juin 1989, doit être considéré sous cet angle. En Afrique, les États les plus sinistrés souffrent davantage de leur faiblesse que de leur force. Souvent, la démocratie est la conséquence et non la cause de la montée d’une classe moyenne et donc du succès économique. Tel fut le cas de la Corée du Sud, en attendant la Chine ou la Russie. Le risque est toujours, ici ou là, le repli sur des institutions exclusives, pour sauver un régime, une classe ou une caste.
Ce bref développement sur le succès économique, envisagé comme une amélioration pacifique et soutenue dans le temps du « portefeuille de ressources » d’un État, m’a paru nécessaire pour trois raisons, outre le rappel de l’importance intrinsèque de l’économie. D’abord, pour souligner qu’au XXIe siècle les États continuent d’être les acteurs principaux du système international en dépit de la mondialisation mais aussi de la fragilité de certains d’entre eux. Ensuite, et c’est un point essentiel, les puissances actuellement montantes sont extérieures au système euro-atlantique auquel s’était rattaché le Japon après la défaite de 1945. Enfin, l’histoire du succès économique met au premier plan l’importance des institutions dites inclusives. Ce sont ses institutions qui font la force des États-Unis d’Amérique. Cette idée nous renvoie aussi en Europe à celles de Jean Monnet. Elle est en fait à la racine de la pensée libérale. Pour une grande part, le destin de la mondialisation reposera sur la capacité de faire émerger, en l’absence d’une impossible unité politique monde, les institutions « globales » nécessaires à sa survie. Je ne fais là que reformuler, en d’autres termes, ma remarque antérieure sur les biens publics mondiaux.
Je vais maintenant compléter l’analyse de la puissance à partir de quelques observations sur le système international tel qu’on le voit se dessiner sous nos yeux. Je le qualifie par trois adjectifs – multipolaire, hétérogène, complexe – qu’il convient de commenter.
La multipolarité s’oppose à la bipolarité de la guerre froide et à l’illusion du « moment unipolaire » consécutif à la chute de l’Union soviétique, celui du mythe de la fin de l’Histoire selon Francis Fukuyama ou de l’hégémonie bienveillante des États-Unis, considéré comme le peuple élu pour apporter au monde, à travers la propagation de ses valeurs, les bénéfices de la démocratie et de l’économie de marché. Certains, comme le président du Council on Foreign Relations américain, Richard Haas, ou l’historien anglais Timothy Garton Ash, préfèrent parler de no polarity, mettant ainsi l’accent sur l’absence de structures stables et donc clairement identifiables dans la société internationale contemporaine.
En temps que concept, la multipolarité soulève au moins trois difficultés complémentaires. Les examiner est en même temps montrer l’intérêt du concept. Si l’on appelle pôle un État dont le pouvoir a une portée potentiellement planétaire et dont la capacité de passage à l’acte est crédible, un État qui mérite donc pleinement l’appellation de « puissance », est-il possible d’en établir objectivement la liste ? Disons tout de suite que la réponse est négative. Pour employer une métaphore mathématique, je dirai qu’il faut penser en termes d’ensemble flou. Dans cette perspective, on ne dit plus qu’un objet appartient ou n’appartient pas à un ensemble. On ne peut plus parler que d’un degré d’appartenance. S’agissant de notre problème, la notion de portée planétaire est sujette à interprétation et le passage à l’acte est par nature à la fois intermittent et, dans une certaine mesure, aléatoire. Par ailleurs, le jugement que l’on porte sur la puissance d’un État inclut toujours un effet d’escompte – au sens de la notion mathématique d’actualisation – et cet effet est largement subjectif. Ainsi tend-on à magnifier la puissance de la Chine, en escomptant la poursuite indéfinie de sa croissance, ou hésite-t-on à qualifier celle de la Russie, considérée contradictoirement comme un État déclinant et comme une puissance (ré)émergente. A fortiori est-il fort délicat de situer l’Union européenne, ou même ses trois principaux membres (l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne – je les cite par ordre alphabétique !) sur une échelle de puissance.
La deuxième difficulté tient au fait qu’il n’est plus possible de se satisfaire d’une approximation unidimensionnelle de la puissance. Par exemple, le Brésil est devenu un acteur incontournable dans les négociations commerciales multilatérales, et en ce sens mérite le qualificatif de « pôle » du système international ; mais nul ne songerait à considérer ainsi cet État du point de vue militaire. Pour donner un exemple peut-être encore plus frappant, la capacité diplomatique d’un État est un important élément de la puissance, qui est toujours le fruit de son histoire. C’est ainsi que la France, à certains égards, peut encore jouer dans la cour des grands. Jean-David Levitte nous le démontrera le 28 janvier. De même la Grande-Bretagne continue-t-elle de bénéficier de la tradition du Foreign Office. Personnellement, j’ai beaucoup admiré, dans les années 1990 où tout partait a volo en Russie, la manière dont la diplomatie moscovite est alors parvenue à limiter les dégâts. Naturellement, tout héritage doit être entretenu sinon fructifié pour durer. Cela vaut aussi, typiquement, pour les armées, dont la puissance ne se réduit jamais à une somme de moyens. La tradition militaire est aussi un facteur de puissance, que l’on doit également veiller à entretenir. Là encore, je pense à notre pays. Pour revenir à la diplomatie on peut dire, a contrario, que la construction du Service européen pour l’action extérieure, actuellement entre les mains expertes de notre compatriote Pierre Vimont, prendra beaucoup de temps. Je pourrais également reparler ici de soft ou de smart power, étroitement liés, d’ailleurs, à la notion de diplomatie.
La troisième difficulté n’est pas la moindre. Comme dans toutes les situations de compétition, les pôles entretiennent des relations simultanément coopératives et conflictuelles, dans des proportions sujettes à fluctuations à toutes les échelles temporelles. Je prendrai un seul exemple. Si l’on se projette dans les deux ou trois prochaines décennies, on peut arriver, avec Joseph Nye et d’autres, à penser que le seul concurrent sérieux des États-Unis pour la primauté est la Chine. Rien n’assure d’ailleurs qu’elle puisse y parvenir aussi rapidement. Je n’entrerai pas ici dans l’examen des arguments en faveur de cette thèse. Faut-il alors en déduire que l’on va nécessairement vers un affrontement majeur entre les deux futures superpuissances, susceptible par exemple de conduire à un nouveau système bipolaire ? Rien n’est moins sûr. Le contexte idéologique actuel et à venir n’a rien de commun avec celui de la guerre froide. L’interdépendance économique des deux pays est une réalité durable. En même temps, sur le plan géopolitique, les principales rivalités de la Chine sont régionales, et l’on voit déjà se dessiner, dans la pure tradition de la balance of power, des rééquilibrages avec les États-Unis, sinon autour d’eux. En ce début de l’année 2013, l’attention doit ainsi se porter sur les conséquences du retour en force du Parti libéral démocrate au Japon, sous la houlette du leader nationaliste Shinzo Abe. Le point essentiel est que l’on peut postuler qu’à l’horizon prévisible l’ensemble des pôles partagent un double objectif avec une face positive, maintenir un monde raisonnablement ouvert, et une négative, empêcher l’éclatement de conflits les éclaboussant tous.
En définitive, l’image d’un système multipolaire est doublement floue. Au flou de l’appartenance se superpose celui des dimensions à la fois coopératives et confrontationnelles à différents niveaux (par exemple économique et politique), d’où résulte la métaphore de la « géométrie variable » couramment employée en Europe, par analogie avec la gouvernance de l’Union. Il ressort de cet examen de la multipolarité que la forme la plus vraisemblable de la « gouvernance mondiale » dans l’avenir prévisible est la diplomatie de réseaux pour laquelle, comme je l’ai déjà laissé entendre, les États dotés d’une forte tradition diplomatique ont un avantage comparatif. Le G20, par exemple, peut être considéré comme l’un de ces réseaux, se donnant principalement pour mission de guider la gouvernance économique mondiale. En anglais, on parlerait de steering committee.
J’en viens à la notion d’hétérogénéité, dont à ma connaissance la formulation remonte à Raymond Aron dans son grand traité de 1962, Paix et guerre entre les nations. Lui-même l’avait empruntée à un auteur grec, Panayis Papaligouras. Cette notion, qui se réfère aux différences culturelles et idéologiques entre les États, parfois simplement liées à un régime politique, et souvent plus profondes, me paraît également l’une des clés pour comprendre le monde du XXIe siècle. Elle s’oppose aux deux formes contraires d’ethnocentrisme formulées, au début des années 1990, l’une comme « la fin de l’Histoire » (Fukuyama), l’autre comme « le choc des civilisations » (Huntington). Dans chaque cas, un grand prêtre occidental annonçait l’abolition de l’identité de l’Autre, le premier par la conversion, le second par la guerre. On est aujourd’hui revenu de ces narratifs ou de ces idéologies, du moins sous leurs formes caricaturales. Mais les Occidentaux les plus marqués par l’idéologie des Lumières, à commencer par les Français et les Américains toujours enclins à se prendre pour les phares de l’Univers, restent tentés par une forme d’hypocrisie qu’Hubert Védrine a saisie sous l’appellation de « droit de l’hommisme », tandis qu’en arrière-plan le « choc des civilisations » reste l’une des grandes peurs de notre époque. À l’opposé, les grandes puissances issues du communisme restent farouchement attachées au principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres États. En juin 1989, nombre d’Américains se sont lourdement trompés à propos de la Chine en surestimant la signification du geste des étudiants qui agitaient des petites statues de la Liberté sur la place Tiananmen. Quiconque visite régulièrement la Chine et a la chance de pouvoir s’adresser à une palette diversifiée de Chinois peut réaliser, s’il en doutait, que les Chinois sont chinois et fiers de l’être. Pour autant, l’empire du Milieu les occupe suffisamment et ils n’ont nulle prétention à siniser le reste du monde, mais seulement à y promouvoir leurs intérêts, typiquement l’accès aux matières premières. Effectivement peu intéressés à s’immiscer dans les affaires intérieures d’autrui, ils entendent que les autres ne se mêlent pas des leurs et surtout ne prétendent pas leur donner des leçons.
Les notions de puissance, de pôles, etc., que j’ai discutées jusqu’ici sur un plan global, peuvent évidemment se décliner régionalement. Ainsi la France est-elle une puissance majeure vue du Maghreb ou des pays issus de son ancien empire africain. De même, l’Algérie est une grande puissance vue du Mali. Sans doute aucun État islamique ne peut-il aujourd’hui faire partie sur le plan global des pôles dont j’ai parlé, mais ce peut être le cas dans le cadre de découpages régionaux plus fins. Un micro-État comme le Qatar est ainsi devenu, au moins pour un temps, un acteur notable du système international. Pour les pays non musulmans présents de manière significative dans l’aire islamiste, la question de l’hétérogénéité revêt un caractère essentiel. Elle soulève en particulier celle des limites de la « responsabilité de protéger » introduit dans le droit international en 2005 et mis en œuvre, dans des conditions contestées, dans les opérations qui ont conduit au renversement du colonel Kadhafi. Le bourbier dans lequel s’enfonce actuellement la Syrie traduit de façon dramatique l’incapacité de ce que l’on appelle vaguement la « communauté internationale » de dégager une solution coopérative dans un contexte dominé à ce point par l’hétérogénéité. Les deux couches de pôles impliqués – une couche globale et une régionale – divergent en effet pour des raisons fondamentales qu’il n’est pas approprié de creuser ici. Je dirai seulement que ces raisons dépassent largement les intérêts nationaux étroits des États concernés, mais touchent à leur vision de l’intérêt collectif du système international dans son ensemble. En cela, la situation diffère me semble-t-il nettement de celle de l’Europe avant la Première Guerre mondiale. C’est cette incapacité qui est ici en cause, et non une quelconque fatalité du choc des civilisations. À mon sens, du point de vue classique des rapports entre les puissances, le plus grand danger qui guette le système international au XXIe siècle est le risque de réaction en chaîne à partir de mauvaises gestions de l’hétérogénéité en raison de la multipolarité floue dont j’ai parlé précédemment, et donc en l’absence d’un cadre institutionnel – certains invoqueront le droit international – suffisamment robuste. Nous assistons actuellement au Moyen-Orient à l’échec des clubs et des coalitions ad hoc. On tremble à la perspective d’une conjonction d’un affrontement armé en Iran et d’un chaos s’installant en Syrie et la débordant. Le point important, s’agissant de la spéculation sur la puissance au XXIe siècle, est que le maintien d’un monde ouvert implique l’apprentissage d’un vouloir-vivre ensemble dans le système multipolaire. Cet apprentissage n’a rien d’évident.
Multipolaire, hétérogène, le système international contemporain est également complexe. En théorie des systèmes, la complexité se définit par la non-linéarité des relations entre ses éléments, c’est-à-dire la non-proportionnalité des causes et des effets. Dans un système non linéaire, une perturbation infime peut conduire à une forme très particulière de hasard que l’on appelle chaos. Ce phénomène, mis en lumière au début du XXe siècle par Henri Poincaré et illustré par le problème des trois corps (l’instabilité du système formé par le Soleil, la Terre et la Lune), a été popularisé en météorologie dans les années 1960 sous le nom d’effet papillon. De nombreux exemples illustrent la complexité du système international contemporain. J’en citerai rapidement deux : la crise financière et économique provoquée par les marchés du subprime en 2008 ; le « printemps arabe », dont la cause immédiate fut le suicide de Mohamed Bouazizi au centre de la Tunisie le 17 décembre 2010. Ce que j’ai dit précédemment au sujet de la combinaison de la multipolarité et de l’hétérogénéité permet également de comprendre comment l’absence d’institutions appropriées, c’est-à-dire l’inadéquation des « usines de production des décisions », dans un monde sans puissance hégémonique, peut conduire à des désastres, alors même que tous les pôles s’accorderaient a priori sur l’essentiel, c’est-à-dire la stabilité structurelle. Je note à ce propos que le concept de stabilité structurelle ne s’oppose pas à l’idée de changement, mais à celle de violence.
Je ne développe pas davantage ces considérations, car il faut maintenant aborder une autre dimension de la complexité dont je n’ai pas encore parlé. Il s’agit non plus des phénomènes, somme toute classiques dans l’Histoire, de la redistribution de la puissance entre les États, le déclin des uns et la montée des autres, mais de la multiplication des unités actives transnationales et surtout de la diffusion sans précédent de la puissance vers des acteurs non étatiques de petite dimension. Sur le phénomène bien connu des entreprises multinationales ou transnationales, je me limiterai à trois remarques. La première est que ces entreprises n’opèrent pas dans le vide, mais sur des territoires et donc dans des États. En tant qu’unités politiques majeures, ces derniers ne sont pas de même nature. La deuxième remarque est que les entreprises ont une culture façonnée par leur histoire et marquée par leur pays d’origine. De ce point de vue, par exemple, nul ne peut douter qu’IBM soit une entreprise américaine ou Total une entreprise française. En revanche, il est vrai que le rapport entre les grandes entreprises et les États est devenu un rapport de puissance. Un aspect déterminant de la redistribution en cours de la puissance entre les nations est les transferts de technologie, qui condamnent les exportateurs des pays mûrs à se vider de leur substance au profit de leurs concurrents d’aujourd’hui et plus encore de demain. Ils n’ont ainsi d’autre choix pour survivre que de se battre pour reconstituer en permanence une avance technologique. Ce qui me conduit à la troisième remarque, à savoir l’intensification de la concurrence de structures entre les États, au cœur des débats sur la compétitivité. Cela nous ramène évidemment à la notion d’institutions inclusives, précédemment évoquée.
Le point le plus nouveau sur lequel par conséquent il faut le plus mettre l’accent est qu’avec l’effondrement du coût de l’accès aux technologies de l’information et de la communication, des micro-unités actives, nationales ou multinationales, ont aujourd’hui accès à des formes de pouvoir qui n’étaient naguère encore accessibles qu’aux États. Pouvoir mais aussi puissance, puisque ces unités sont souvent moins inhibées face au passage à l’acte. L’attention portée à la prolifération des armes nucléaires n’est certes pas nouvelle, et un pays comme la France a attendu 1976 pour affronter sérieusement ce problème. Pour la raison que je viens d’indiquer, cette préoccupation n’a cessé de croître. Un grand débat s’est d’ailleurs engagé sur l’abolition complète de ces armes. Il n’est guère surprenant que les États-Unis soient en flèche dans ce domaine, puisqu’ils ont et garderont longtemps une supériorité absolue dans toutes les autres formes de la puissance militaire. Pour les autres États actuellement détenteurs de la bombe atomique et des vecteurs nécessaires à sa projection, à commencer par les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la question est beaucoup plus délicate. Je ne doute pas que la plupart d’entre eux ne se laisseront pas facilement dépouiller de ce facteur de puissance. À côté et en plus de cette dimension classique de la prolifération se situe désormais la cyber-puissance, dont j’ai déjà parlé. Déjà entrée dans la réalité, elle contraint les pôles du système international, dans la mesure où ils sont effectivement attachés à préserver la stabilité structurelle de ce système, à consacrer de nouvelles ressources au renseignement, mais aussi à la prévention et, le cas échéant, à la riposte dans des domaines fondamentalement nouveaux où, de surcroît, l’évolution reste extraordinairement rapide. D’une manière plus générale, le renseignement est appelé à jouer un rôle croissant comme facteur de puissance au XXIe siècle. La langue anglaise utilise le mot intelligence, de plus en plus d’ailleurs repris en français. Ainsi parle-t-on d’intelligence économique. Intelligence, c’est le mot juste. Le facteur premier de la réussite dans l’action n’est-il pas en effet l’intelligence des situations ? En matière de renseignement ou d’intelligence, les capacités d’un État sont largement fonction de son histoire et de ses traditions, comme pour d’autres formes de puissance que j’ai déjà mentionnées, la diplomatie ou les forces armées. Mais, dans ce domaine comme dans les autres, des capacités non entretenues ou modernisées ne peuvent que se déliter au fil du temps.
Je conclurai ces brèves remarques sur la diffusion de la puissance en disant que, malgré tout, l’avantage reste potentiellement aux États. Pour autant, ceux-ci ne parviendront pas à empêcher toutes les catastrophes, comme le 11 septembre 2001 nous le rappelle. Et le jour où un groupe terroriste parviendra à faire exploser une bombe atomique dans une ville, à provoquer à distance un accident majeur dans une centrale nucléaire ou à torpiller un système bancaire, marquera le début d’une ère nouvelle en fonction de la manière dont réagira alors la « communauté internationale ». Il n’y a pas que dans cette perspective que des tendances à la renationalisation sont actuellement perceptibles. Préserver un monde ouvert n’implique certainement pas le « laisser-faire-laisser-passer » intégral à l’échelle internationale.
Je voudrais encore attirer l’attention sur deux aspects de la diffusion de la puissance. D’abord, elle accroît la complexité des « usines de production des décisions » puisque dans bien de domaines les États, tout en gardant leur primauté, doivent travailler avec d’autres unités actives pour engager les ressources collectives dans les bonnes directions. Ensuite, l’émergence d’une forme de société civile mondiale influe désormais non seulement sur les élites internationales, mais directement sur les opinions publiques. Le bouleversement du secteur des médias, en particulier sous l’effet du développement des réseaux et des médias sociaux ne peut que renforcer cette tendance, qui va bien au-delà du « mouvement des idées », de tous temps considéré comme une force majeure dans la marche de l’Histoire. Les grandes conférences internationales, comme la World Policy Conference, également. Toute cette effervescence conduit à s’interroger sur l’avenir de la démocratie, non pas du point de vue de ses fondements philosophiques, mais de celui de sa mise en œuvre concrète. Ceci est une autre histoire.
Derrière la question posée pour cette communication s’en cachait une autre : la France peut-elle rester une puissance au XXIe siècle ? Nous mettons rituellement en avant notre rang en termes de PNB et nos performances technologique dans certains domaines ; notre appartenance au club des membres permanents du Conseil de sécurité, lequel coïncide avec le noyau des puissances nucléaires et celui des champions des industries d’armement ; la qualité de notre appareil diplomatique ou encore la vigueur de notre tradition militaire. Nous invoquons notre soft power culturel et politique, les deux étant incontestablement liés. Le soft power retentit d’ailleurs sur l’économie comme l’illustrent nos succès dans le tourisme ou dans le luxe.
Pour autant, nombre de nos compatriotes et d’observateurs étrangers voient planer sur notre pays l’ombre du déclin. Certes, déclin n’est pas décadence et nous en avons vu d’autres dans notre histoire. Je crois que le problème est politique, dans le sens le plus fondamental du terme. Dans cette communication, j’ai voulu citer le livre d’Acemoglu et Robinson, Why Nations Fail, pour rappeler que le monde n’est pas une collection de personnes physiques, mais d’États, et que dans chacun d’eux la politique précède l’économie. Plus que d’autres, la France éprouve de grandes difficultés à se reformer, c’est-à-dire à se mettre en ordre de marche pour réussir dans la concurrence de structures. Tel est l’enjeu de la bataille pour la compétitivité. Nous la perdrons si nous continuons à l’aborder de façon idéologique. Et derrière l’affrontement idéologique – qu’il serait caricatural de résumer en termes de gauche et de droite – se cache une lutte entre les éléments actifs de deux classes, celle de ce qu’il faut bien appeler les conservateurs, c’est-à-dire des rentiers attachés à l’irréversibilité des « avantages acquis » ; et celle des entrepreneurs dans l’acception large du terme. Comme le maintien d’un monde ouvert interdit l’arbitraire le plus total en matière macroéconomique, et qu’il faut bien maintenir un équilibre budgétaire, le risque est de l’atteindre par des mesures qui, année après année, affaiblissent tous les éléments de notre puissance y compris dans l’ordre diplomatique ou militaire.
Ayant dit cela, il me paraît clair que la France est encore une puissance, et qu’elle reste reconnue comme telle, même si son image vacille. Le restera-t-elle au long du XXIe siècle ? Je le souhaite ardemment pour nos descendants car la puissance d’un pays bénéficie à ses citoyens, mais aussi pour le monde car je suis convaincu que nous avons beaucoup à donner. J’aimerais terminer avec des paroles lénifiantes. Dans la réalité, tout dépendra de l’issue d’un vrai et grand combat politique. Ce combat est engagé.