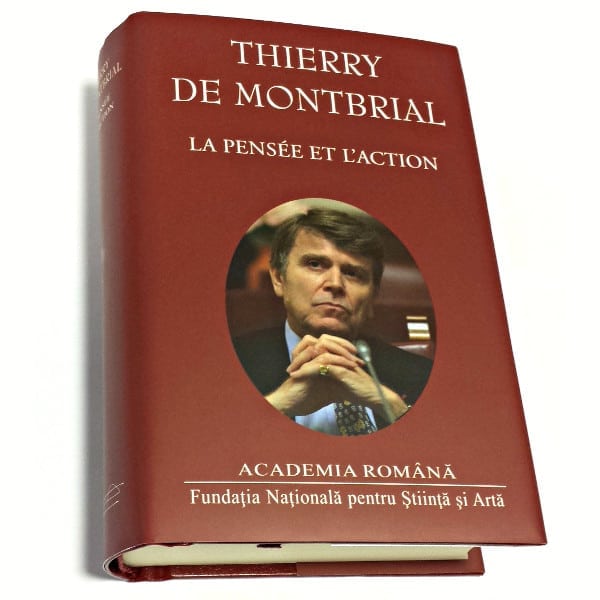Qu’est-ce qu’un think tank ?
Version révisée d’une communication à l’Académie des sciences morales et politiques, le 28 février 2011
Lorsque, dans les années 1978 et 1979, je jetais les fondations de l’Institut français des relations internationales (Ifri), seuls quelques initiés connaissaient en France le vocable think tank et avaient une idée au moins approximative de ce qu’il recouvrait.
Ce vocable est devenu à la mode mais ne fait encore l’objet d’aucune définition consensuelle. On le traduit généralement en français par laboratoire d’idées.
Or, aucune étude sérieuse n’est possible sur la base d’une acception trop vague. Dans cette communication, j’ai choisi de retourner à la source du phénomène et de distinguer clairement entre think tank et club de réflexion.
Conformément à la racine du phénomène sous-jacent, j’appelle think tank, toute organisation ouverte construite autour d’un socle permanent de chercheurs, se donnant pour mission d’élaborer, sur des bases objectives, des idées relatives à la conduite de politiques et de stratégies privées ou publiques s’inscrivant dans une perspective d’intérêt général. Il s’agit là, évidemment, d’une définition radicale et donc idéale, mais qui permet de situer les institutions réelles que l’on considère ou qui se considèrent comme des think tanks.
Le critère d’ouverture vers le public distingue de façon essentielle les think tanks contemporains des conseils attachés aux dirigeants d’États non démocratiques, d’autrefois comme le cabinet secret de Louis XV, ou d’aujourd’hui. Qui dit ouverture dit débat avec l’extérieur. Naturellement, l’ouverture peut être plus ou moins grande.
En tant qu’organisation, un think tank peut être public ou privé et avoir ou non une personnalité morale, typiquement avec un statut de type association ou fondation.
Une administration n’a a priori pas la même latitude d’expression qu’une institution privée, mais pour autant certains think tanks publics peuvent bénéficier d’une réelle marge d’indépendance et d’ouverture. À l’inverse, il ne suffit pas d’être de droit privé pour être indépendant et ouvert. Les conditions statutaires (gouvernance interne) et la diversification des financements, éprouvées dans la durée, sont des déterminants essentiels à cet égard. Aussi important est la culture de l’organisation, telle qu’elle se forge elle aussi au fil des décennies, et la réputation comme l’intégrité de ses dirigeants. Ici comme ailleurs, le facteur temps est crucial pour la réputation.
Toute institution doit être située dans son contexte. Ainsi l’Union soviétique, en partie inspirée par l’exemple américain, avait-elle mis en place, dans la mouvance de l’Académie des sciences, d’importants think tanks comme l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales (IMEMO), l’Institut des États-Unis et du Canada, ou encore de nombreux centres spécialisés, organisés typiquement par grandes régions. Leurs missions en partie contradictoires étaient d’élaborer objectivement des analyses et des prévisions sur le monde extérieur, de développer des relations avec leurs homologues étrangers, d’informer et de conseiller les instances du Parti, mais aussi de diffuser diverses formes d’analyse et/ou de propagande.
C’est à travers ces institutions que j’ai fait mes premiers pas en URSS dans les années 1970 et 1980. J’ai alors été frappé par la qualité et la compétence de beaucoup de mes interlocuteurs, de plus en plus soumis au fil du temps aux affres du grand écart entre la réalité et l’idéologie. Des centaines de chercheurs issus des grands think tanks soviétiques ont contribué à la transformation de la Russie dans les années qui ont suivi la chute du système, précisément parce qu’ils avaient une véritable ouverture sur le monde.
Quoiqu’également dotée de think tanks, la Chine de Mao était moins propice à l’interaction avec l’extérieur que l’URSS de Brejnev et de ses éphémères successeurs. Les choses ont changé avec Deng Xiaoping. Je m’en tiendrai au seul exemple du CICIR qui, en septembre 2010, a célébré en grande pompe son trentième anniversaire. CICIR est l’acronyme de China Institutes for Contemporary International Relations. Institutes, avec un s. Il s’agit en effet d’un ensemble interdépendant d’institutions, chacune spécialisée dans un aspect des relations internationales.
Le CICIR, ainsi que d’autres think tanks basés à Pékin ou à Shanghai, jouent des rôles comparables à leurs homologues soviétiques d’autrefois mais évidemment dans un contexte sensiblement différent et fondamentalement moins tendu. Leur importance est d’autant plus grande que la Chine se trouve, pour la première fois dans son histoire, face à la nécessité d’élaborer une vraie politique étrangère, d’envergure mondiale.
Revenons à la définition du think tank, comme une organisation construite autour de chercheurs. Il s’agit là d’un point capital, qui différencie le think tank des autres formes de sociétés d’idées, comme la Fabian Society (créée à Londres en 1884 pour promouvoir des réformes sociales), ou les salons et les clubs politiques ou économiques plus ou moins structurés hérités du XVIIIe siècle.
Ces chercheurs ne le sont pas nécessairement à vie. Dans le système américain, une même personne peut alterner entre une activité de chercheur dans un think tank et des responsabilités au sein d’une administration présidentielle. Ce va-et-vient confère une expérience inestimable, et cela contribue à distinguer le think tank des institutions de tradition purement universitaire. Mais, en tant que chercheur, chacun doit manifester une aptitude à traiter les sujets de sa compétence avec des méthodes éprouvées, empruntées aux sciences humaines et sociales, parfois aux sciences exactes. Ainsi seulement peut-on asseoir des idées ou des propositions d’action (en anglais, on dit advocacy) sur des bases raisonnablement objectives et se différencier de la pure idéologie ou de la propagande.
J’insiste aussi sur le fait qu’au sens originel, un vrai think tank doit reposer sur un socle permanent de chercheurs. J’entends par là des chercheurs dont le travail au sein de l’organisation constitue l’activité principale, et qui peuvent ainsi concevoir et réaliser des projets substantiels avec la collaboration éventuelle de chercheurs associés, c’est-à-dire extérieurs. Pour beaucoup, la réputation internationale d’un think tank repose sur sa capacité à entretenir un tel socle permanent, qualitativement solide.
J’ai souligné au passage l’importance de la méthode dans toute activité de recherche. Les think tanks sont par nature tournés vers l’avenir. Leur activité se situe donc du côté de la prospective et de la stratégie. En anglais, on dit qu’ils sont policy oriented. Une difficulté inhérente à leur métier est que leurs analyses et recommandations doivent s’appuyer sur une compréhension profonde du présent et donc du passé, faute de quoi ils courent le risque de commettre d’énormes erreurs de jugement ; en même temps, leur esprit doit être suffisamment ouvert et éclairé, libre de tout dogmatisme ou d’enfermement systémique, pour leur permettre d’identifier les signes avant-coureurs du changement, sous peine de succomber à la facilité de l’extrapolation et de manquer les tournants.
Les deux aspects sont d’ailleurs complémentaires. Dans les années 1970, les théories du développement économique fondées sur la notion de transfert technologique ignoraient la dimension culturelle de la maîtrise des technologies et conduisirent donc à des impasses. De façon similaire, les admirateurs du Shah n’avaient pas bien analysé l’état de la société iranienne et n’avaient pas correctement interprété les « signaux faibles », annonciateurs d’une révolution possible.
En 2010-2011, la crise de l’euro, ou encore la chute des régimes de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte, étaient-elles prévisibles ou plus précisément datables ? Comment faut-il aborder la réflexion sur l’avenir des autres régimes autoritaires au Moyen-Orient ou en Asie (Corée du Nord) ?
On pourrait aisément multiplier les exemples, l’important étant de voir que la réponse à toute interrogation de ce genre dépend d’un arrière-plan contextuel plus ou moins explicite, propre au think tank, sur lequel s’exercent des influences plus ou moins subtiles, en deçà ou au-delà des dépendances basiques dont j’ai parlé précédemment.
Un aspect particulièrement intéressant de cette question est l’interaction possible entre la prévision d’un événement et sa réalisation, interaction qui est fonction de la personnalité et de la position (au sens géopolitique de la locution allemande die Lage) de l’institution qui prévoit. Pour céder à la facilité de l’analogie, je dirais qu’il y a là comme une sorte de relation d’incertitude à la Heisenberg. Ces observations nous ramènent à l’importance de la diversité et donc du pluralisme des think tanks, ce en quoi on peut voir aussi une exigence démocratique.
Encore un commentaire sur la définition. Les think tanks s’intéressent à des politiques et des stratégies privées (typiquement d’entreprises) ou publiques (typiquement d’États ou d’organisations internationales), mais ils ont vocation à toujours se situer dans une perspective d’intérêt général. Quelle que soit sa formulation (par essence multivoque), l’intérêt général ne se laisse jamais réduire à une alliance d’intérêts particuliers. En cela, les think tanks se différencient d’institutions comme les cabinets de consultants, les sociétés de communication ou les groupes de pression, dont le métier est de promouvoir et de défendre des intérêts particuliers. La distinction est en principe radicale. En pratique, elle peut être plus subtile. Les lobbyistes affirment souvent travailler pour l’intérêt général, comme on disait autrefois que ce qui était bon pour General Motors était bon pour les États Unis. Leur perspective première n’en est pas moins celle de leurs clients. De leur côté, les think tanks sont parfois conduits à récuser certains partenaires potentiels, pour des raisons d’incompatibilité avec leur vision de l’intérêt général. Dans tous les cas, il faut parler de vision de l’intérêt général. Le postulat implicite est que l’intérêt général n’est pas univoquement déterminé. Dans un système démocratique, les think tanks ont donc à participer à sa définition. À ce niveau, il y a nécessité absolue de débats proprement idéologiques et de pluralisme.
Avec la mondialisation, la gouvernance globale s’est progressivement imposée comme un thème central pour les grands think tanks planétaires. En raison de la transformation qualitative de l’interdépendance sous l’effet de la révolution des technologies de l’information et de la communication, un choc ou une perturbation dans un segment particulier du système international – fonctionnel ou régional – peut déstabiliser le système dans son ensemble (phénomène de la non-linéarité, connu familièrement sous l’appellation « effet papillon »), de même que dans le corps humain un accident affectant une fonction critique peut conduire à la mort.
D’où la nécessité d’adapter constamment les modes de régulation à tous les niveaux et d’assurer la coordination d’ensemble. Ainsi peut-on formuler de façon synthétique le problème de la gouvernance globale. Ce problème est plus ardu que celui de l’organisation et de la gouvernance des entreprises auquel il ressemble de prime abord, parce que le monde n’existe pas en tant qu’unité politique. Aucun leader, aucune institution n’existe pour définir les objectifs et les stratégies du « monde ». Pour la plupart des sujets concrets de la gouvernance globale – comme l’énergie, le climat, l’alimentation, l’eau, la santé ou encore bien sûr la sécurité, la macroéconomie et la finance –, les partenaires principaux sont à des degrés divers une combinaison d’États et d’entreprises.
Certains think tanks sont ouvertement impliqués dans les confrontations idéologiques. Je citerai la Heritage Foundation, fondée en 1973, et la Hoover Institution, établie en 1919 mais profondément remodelée entre 1960 et 1989. Ces deux institutions sont pénétrées de l’idée de la suprématie absolue du modèle américain, sous sa forme conservatrice, et de la nécessité de le protéger contre les dérives libérales.
Cependant, la plupart des think tanks américains ont des objectifs plus opérationnels, même s’ils ne sont pas exempts d’un arrière-plan idéologique (par exemple monétariste ou keynésien, dans le domaine de l’économie). Ils posent des problèmes – comme la non-prolifération et l’élimination des armes nucléaires, la coexistence ethnique, le changement climatique, l’énergie, l’eau, les révolutions agricoles, etc. –, les analysent et préconisent diverses options pour les résoudre. En cela, ils sont fidèles à la tradition nationale, dans sa version tocquevillienne.
À titre d’exemple, je citerai trois institutions d’époques différentes. Le National Bureau of Economic Research (NBER), a été créé en 1920 pour rapprocher l’univers alors fermé des économistes universitaires de celui du gouvernement et de la politique économique. C’est dans le cadre du NBER que Simon Kuznets (prix Nobel en 1971) effectua ses travaux pionniers sur la comptabilité nationale, et Milton Friedman (prix Nobel en 1976) ses recherches sur la demande de monnaie.
Deuxième exemple : la Brookings Institution, qui est le plus vieux think tank washingtonien. Bien qu’il ne soit pas le plus grand, il est aujourd’hui considéré comme le numéro un aux États-Unis et donc dans le monde. Fondée autour de la Première Guerre mondiale par Robert S. Brookings, un homme d’affaires de Saint-Louis alors âgé de 70 ans, l’institution fut construite sur l’idée que, pour être efficaces, les politiques publiques devaient reposer sur de solides bases de données, lesquelles faisaient alors totalement défaut. Aujourd’hui, la Brookings, comme on dit familièrement, repose sur trois piliers (il s’agit toujours de politiques publiques) : l’économie et les problèmes intérieurs, la sécurité nationale et internationale, et les relations internationales.
Troisième exemple, en 1981, à l’orée du phénomène que nous appelons maintenant la mondialisation, Fred Bergsten mit en place son Institute for International Economics – rebaptisé par la suite Peterson Institute du nom de son principal donateur – considéré aujourd’hui comme le premier think tank mondial voué aux politiques publiques dans le domaine économique.
De telles institutions se veulent pratiques et objectives dans leurs travaux, ce qui – comme je l’ai déjà dit – n’implique nullement qu’elles soient exemptes de tout arrière-plan idéologique conscient ou inconscient. Je suis de ceux qui pensent que ce que Max Weber appelait la Wertfreiheit – on dit en français indépendance axiologique – est un idéal dont on ne peut au mieux que s’approcher dans les sciences sociales et humaines, fondamentales ou appliquées. Tout est une question de degré et sans doute de rapport personnel à la vérité. Approfondir ce point me conduirait trop loin du sujet.
Arrêtons-nous sur l’origine du vocable think tank. Selon l’Oxford English Dictionary, think tank désignait familièrement le cerveau au tournant du siècle dernier. Le jargon militaire s’en empara, peut-être dès la Première Guerre mondiale et surtout pendant la Seconde, pour signifier un lieu sûr où discuter des plans et des stratégies. Dans les années 1950 on l’utilisait couramment au sujet des organisations de recherche sous contrat avec l’appareil militaire, la plus importante étant la Rand Corporation.
L’usage du mot s’élargit au début des années 1960, quand l’attention publique se focalisa sur les whiz kids (« enfants prodiges ») du Pentagone, c’est-à-dire les experts dont s’était entouré Robert McNamara, le secrétaire à la Défense nommé par John Kennedy. Beaucoup de ces experts provenaient de la Rand. L’augmentation ultérieure du nombre des organisations de recherche plus ou moins comparables se traduisit progressivement par l’extension de l’usage du vocable, d’abord aux États-Unis puis en dehors, avec la mondialisation.
Si l’on veut absolument traduire think tank en français, je proposerais de coller au plus près à l’intention originelle et de dire familièrement boîte à matière grise ou, en s’éloignant davantage de l’anglais, source d’idées, plutôt que laboratoire d’idées. À vrai dire, les think tanks tels que je les connais n’ont rien de commun avec des laboratoires…
Dans l’histoire des think tanks, la Rand Corporation occupe une place considérable. Fondée en 1948 par l’US Air Force, essentiellement pour ses besoins, cette institution – dont l’acronyme signifie Research ANd Development – fait aujourd’hui encore figure de mastodonte avec un millier de collaborateurs près de son site d’origine à Santa Monica, en Californie, et environ cinq cents à Washington DC.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l’emploi de la toute nouvelle arme atomique à Hiroshima et Nagasaki, il pouvait sembler que l’aviation au sens large (c’est-à-dire aéronefs et missiles) allait devenir l’arme décisive des guerres futures. Forte de ce postulat, la Rand se constitua autour de mathématiciens, de physiciens et d’ingénieurs pour qui la politique devrait être une activité rationnelle décomposable en problèmes analysables et solubles par la méthode scientifique. On peut dire sans exagérer que ce paradigme exerça un pouvoir majeur sinon dominant sur le gouvernement américain jusqu’au fiasco de la guerre du Vietnam.
C’est la Rand Corporation qui fut le cerveau de la stratégie nucléaire dans les années 1950 et 1960, et s’il est une institution qui mérite effectivement le label de think tank, c’est bien elle. Elle fut encore très active au début des années 1980, avec le lancement de l’Initiative de défense stratégique (IDS) du président Reagan, communément appelée « guerre des étoiles ». Bien que ce projet n’ait pas abouti sous sa forme initiale, on s’accorde généralement à penser qu’en entraînant l’Union soviétique dans une course qualitative aux armements qu’elle n’était pas capable de suivre, il a contribué à sa chute.
Avec la montée des risques associés à la prolifération nucléaire, et la polarisation de l’attention sur l’Iran et sur la Corée du Nord, les think tanks américains et leurs émules ont relancé l’intérêt pour le développement et le déploiement de systèmes antimissiles, au cœur de la problématique de l’IDS. George W. Bush en a fait un cheval de bataille pendant ses huit années de présidence, et sur ce plan son empreinte a été suffisamment puissante pour atteindre le cœur du nouveau concept de l’Alliance atlantique, adopté à Lisbonne en novembre 2010. Entrer dans des détails conduirait à retracer l’histoire de l’Alliance depuis la chute de l’URSS.
L’exemple de la Rand illustre le rôle majeur de la défense dans l’émergence de ce que l’on appelle aujourd’hui les think tanks de la deuxième génération, au temps de la guerre froide. Plus généralement, la volonté américaine, constante depuis la Seconde Guerre mondiale, de creuser son avantage quantitatif et qualitatif dans le domaine des systèmes d’armes, n’a cessé d’agir comme un catalyseur d’innovations technologiques qui ont irrigué l’économie dans son ensemble.
Ce rôle s’est manifesté dans beaucoup sinon dans toutes les industries, en particulier dans celle du traitement de l’information. La science des ordinateurs (computer science) des années 1950 et 1960 est progressivement devenue celle des technologies de l’information (information technologies), le glissement lexical traduisant le déplacement progressif du centre de gravité de la discipline du matériel (hardware) vers le logiciel (software). Ajoutons que la Rand a également joué un rôle dans la naissance de l’Arpanet, et par conséquent de l’Internet.
En définitive, aucun think tank n’a été et probablement ne sera aussi influent que la Rand Corporation pendant la période de la guerre froide.
Il n’y a pas que dans les think tanks et dans la technologie que la démarche militaire a laissé sa marque. Secrétaire d’État entre 1947 et 1949, le général Marshall introduisit la culture de la planification au Département d’État avec la création d’un service baptisé Policy Planning Staff (PPS), chargé de mettre en cohérence et en perspective les différents aspects de la politique étrangère américaine. Il en confia la direction à George Kennan, sans doute le penseur le plus profond parmi les diplomates de sa génération. C’est là que naquirent le plan Marshall et le traité de l’Alliance nord. L’un des rôles naturels du PPS est de rédiger les discours du secrétaire d’État ou prononcés en son nom.
Autre institution de l’après-guerre, le National Security Council (NSC), placé directement auprès du président, coordonne l’ensemble des actions de l’exécutif ayant une importance significative dans le domaine de la sécurité nationale. D’abord relativement modeste, le NSC a progressivement pris de l’ampleur. Le plus illustre des conseillers à la sécurité nationale (National Security Adviser), nommé en 1968, fut Henry Kissinger, qui éclipsa ses rivaux au sein du gouvernement. Richard Nixon le nomma secrétaire d’État en 1973.
C’est l’année où Michel Jobert, devenu ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou, voulut doter le Quai d’Orsay d’une cellule de réflexion. Son but, assez modeste, était de répandre un peu de « poil à gratter » sur le corps diplomatique… Forts de notre expérience américaine à la Rand Corporation et à l’Université de Californie à Berkeley respectivement, Jean-Louis Gergorin et moi lui proposâmes de mettre en place un service inspiré du Policy Planning Staff. Nous lui donnâmes le nom moins ambitieux – et donc moins provocant pour la vieille maison du Quai d’Orsay – de Centre d’analyse et de prévision (CAP). Le CAP a été rebaptisé Direction de la prospective en 2010.
Entre 1973 et 1979, comme premier directeur du CAP, je me suis attaché à construire un véritable think tank au bénéfice du ministre des Affaires étrangères, mais aussi du secrétariat général de la présidence de la République, avec lequel nous maintenions un lien direct, et à développer ce que j’ai appelé une « diplomatie intellectuelle ».
Sur le premier point, Michel Jobert et ses successeurs (Jean Sauvagnargues et Louis de Guiringaud) nous avaient laissé une réelle liberté de pensée, avec l’accord de l’Élysée. Nous avions une grande latitude pour publier des articles et intervenir publiquement, et donc un degré substantiel d’indépendance et d’ouverture.
Avec quelques exceptions bien sûr. Ainsi avions-nous initialement interdiction de réfléchir (!) sur la Politique agricole commune. Dans le domaine politico-militaire, nos travaux sur la notion de dissuasion élargie et nos contacts – notamment avec les collaborateurs de Lord Carrington, secrétaire britannique à la Défense – étaient astreints à une totale confidentialité. Leur aboutissement fut cependant visible dès la loi sur la programmation militaire de 1976.
Autre exemple : invité officiel à visiter Israël en 1978, on m’avait interdit de me rendre sur les hauteurs du Golan. En l’occurrence, je pris le risque de la transgression, et m’en suis félicité, car rien ne vaut autant que les visites sur le terrain pour comprendre la géopolitique ou la géostratégie.
Pendant toutes ces années, le travail du CAP a été dominé par les différentes facettes de la crise énergétique dont nous avions bien analysé les prémices dès le printemps 1973, par le thème du nouvel ordre économique mondial, consécutif au quadruplement du prix du pétrole, ou encore par l’évolution des pays de l’Est et les affaires politico-militaires.
J’ai déjà cité la question de la dissuasion. Il faudrait aussi mentionner la réorientation majeure de la posture française face à la prolifération nucléaire (qui n’a abouti que beaucoup plus tard – en 1992 – à l’adhésion de la France au Traité de non-prolifération).
S’agissant de l’économie, on ne parlait pas encore de gouvernance ni de mondialisation, mais le système monétaire international (le système de Bretton Woods était mort en 1971), la volatilité des marchés de matières premières, ou encore le protectionnisme et les questions commerciales multilatérales étaient (déjà !) au cœur de nos préoccupations.
En plein accord intellectuel avec Raymond Barre, nommé Premier ministre en 1976, qui me recevait régulièrement, nous avons réfléchi à l’idée d’un « libéralisme organisé », rejetant dos à dos les schémas marxistes ambiants et le paradigme libéral pur et dur, très prisé aux États-Unis ou en Allemagne.
En Europe, nous nous penchions sur les conséquences de la chute des derniers régimes autoritaires (Franco et Salazar) et nous intéressions aux mouvements perceptibles en « Europe de l’Est ». Le phénomène de l’eurocommunisme retenait toute notre attention. Nous nous ouvrions à l’Asie, surtout au Japon, et même à la Chine à la faveur de la chute de la bande des quatre.
Quant à la « diplomatie intellectuelle », elle se manifestait naturellement dans nos rapports avec nos homologues, principalement mais non exclusivement occidentaux. Nos liens avec le PPS du Département d’État américain furent particulièrement étroits à l’époque de Kissinger. Nous participions à des réunions multilatérales comme le groupe de planification de l’Alliance atlantique. Nous nous introduisions dans des organisations influentes où la France était insuffisamment représentée, comme le Bilderberg ou la Commission trilatérale.
Je me souviens particulièrement, dans ce dernier cadre, de joutes oratoires sur le concept de libéralisme organisé avec le comte Otto Von Lambsdorff, brillant ministre des Finances libéral de la République fédérale d’Allemagne. Ainsi sortions nous du cadre franco-français et des relations internationales « entre soi », si prisées de nos compatriotes, et prenions nous le risque de présenter nos idées à l’extérieur et d’en débattre. Plus généralement, la diplomatie intellectuelle se manifestait par des échanges avec les grands think tanks étrangers, notamment américains, anglais, allemands ou soviétiques, et par des relations suivies avec les milieux de la recherche appartenant à de nombreux pays. Ainsi avons-nous introduit en France la pratique connue sous la locution américaine track 2 diplomacy, qui correspond à la forme la plus structurée de la diplomatie intellectuelle. Nous nous attachions aussi, au niveau franco-français, à établir des liens au-delà des divisions partisanes, ce qui n’était nullement évident dans l’ambiance intolérante des années 1970.
L’influence du CAP s’exerçait grâce à sa liberté de contacts et à ses accès au sein de l’État, à son droit de participer à beaucoup de réunions importantes au sein de l’administration et de déterminer la diffusion de ses notes. À chaque échéance électorale, nous préparions pour le futur ministre ce que nous appelions un « aide-mémoire au roi » (AMR), sorte de revue des grands enjeux internationaux de la France.
Depuis la décennie 1970, le CAP (donc maintenant la DP) a connu des hauts et des bas mais il est bien implanté dans le paysage administratif français. Pour l’essentiel, il s’est développé sur les fondements que nous avons assurés dans ces premières années, au cours desquelles j’ai ainsi découvert le monde des think tanks, alors inconnu des élites françaises. À cette époque est né mon désir de bâtir en France une institution comparable au Council on Foreign Relations de New York ou à Chatham House en Grande-Bretagne. Ce devait être l’Ifri.
Mais avant d’en parler, il convient de revenir brièvement sur l’origine des think tanks, bien avant que ce vocable ait commencé à être employé, et d’évoquer les circonstances des lendemains de la Grande Guerre. Il était dans la mentalité américaine de ce temps-là d’attribuer le cataclysme à des vices fondamentaux du système international, et en conséquence de vouloir changer le système lui-même. Deux institutions privées et indépendantes majeures ont été créées presque simultanément dans cet esprit : l’une en 1921 à New York, le Council on Foreign Relations (CFR) ; l’autre en 1920 à Londres, le Royal Institute for International Affairs (RIIA), aussi connue sous l’appellation de Chatham House.
Ces deux institutions qui répondent parfaitement à ma définition du think tank, se fixèrent dès l’origine des buts similaires : analyser objectivement les situations internationales ; élaborer des modes de résolution pacifiques pour les conflits ; organiser des débats sur les enjeux correspondants, associant acteurs, analystes et observateurs ; contribuer à l’éducation du public sur les relations internationales.
Je n’entreprendrai pas ici de retracer le parcours déjà assez riche de l’Ifri. J’essaierai plutôt d’en décrire les caractéristiques actuelles, et d’utiliser cet exemple pour faire quelques observations plus larges.
Les missions de l’Ifri s’inscrivent dans le prolongement de celles de ses aînés anglo-saxons à leur origine : analyser objectivement, dans une démarche prospective, les situations politiques et économiques internationales – régionales et fonctionnelles ; contribuer à l’élaboration des modes de gouvernance renforçant la stabilité structurelle du système international (je reviendrai un peu plus loin sur cette notion de stabilité structurelle) ; à partir de là, aider des acteurs publics et privés – notamment les entreprises – à forger leurs propres stratégies internationales ; participer à tous les niveaux aux débats sur ces sujets en France, en Europe et dans le monde.
Pour remplir ces missions, l’Ifri dispose actuellement d’une soixantaine de collaborateurs à demeure, dont une moitié de chercheurs et une moitié de personnels de soutien. Ces chercheurs s’entourent également de chercheurs associés, extérieurs, en fonction de leurs besoins.
Les chercheurs sont répartis en centres ou en programmes. Idéalement, un chercheur de l’Ifri doit être familier des terrains sur lesquels son activité s’exerce, en connaître les réseaux les plus significatifs et les principaux acteurs, et apporter une contribution identifiable, en France et dans le monde, aux débats concernant son domaine.
Les collaborateurs sont évalués par leurs pairs pour ce qui concerne leurs publications. La direction de l’Ifri s’intéresse aussi à leurs capacités managériales (aptitude à diriger une équipe ou à trouver des financements). La différence avec la recherche académique se trouve surtout du côté des destinataires des travaux, au-delà des pairs.
Comme ses principaux homologues dans le monde, l’Ifri doit atteindre des cibles qui se situent dans ce que j’appelle les « usines de fabrication des décisions ». Il doit également s’adresser directement aux publics intéressés par les grands enjeux internationaux.
La compatibilité entre ces deux catégories de cibles ne va de soi ni du point de vue de la méthode ni de celui de l’utilisation du temps. Les premières poussent à la confidentialité, les secondes à la médiatisation. La référence à l’idée d’intérêt général, inhérente à la qualité de think tank, oblige à rechercher un équilibre.
En dehors des interventions dans la presse écrite ou audiovisuelle, qui ne constituent en tout état de cause qu’une activité marginale pour une institution fondée sur la qualité de la recherche, l’Ifri atteint ses cibles ou ses partenaires en diffusant des publications et en organisant des débats. Le grand public francophone connaît le rapport annuel Ramsès, dont la trentième édition paraît en septembre 2011, qui s’est imposé comme le leader dans sa catégorie. Les experts connaissent également la revue trimestrielle Politique étrangère, créée en 1936 par le Centre d’études de politique étrangère et dont l’Ifri a assuré la continuité.
L’institut publie ou participe à la publication de livres et de rapports souvent issus de travaux collectifs avec des personnalités et homologues étrangers. De plus en plus, il diffuse par voie électronique des notes sur des sujets très précis. Autant que possible, ces publications sont diffusées en deux ou trois langues, seule manière d’être présent dans le débat intellectuel global.
L’utilisation des technologies numériques conduit à concevoir et à élaborer des « produits dérivés » destinés à des publics précédemment difficilement accessibles. Mais l’extension de ces publics doit être cohérente avec la préservation des relations avec les décideurs et les leaders d’opinion, qui se situent au cœur de la raison d’être de l’Ifri.
L’institut organise environ deux cents débats par an, qui vont de conférences internationales construites autour de spécialistes à des dîners-débats restreints et soumis à la règle de confidentialité dite de Chatham House, permettant à des personnalités économiques et politiques ainsi qu’à des leaders d’opinion d’échanger avec de hauts responsables (chefs d’État ou de gouvernement, CEOs de grandes entreprises multinationales, etc.).
De même que le journalisme n’est pas la vocation première de l’Ifri, ces dîners-débats (ou autres rencontres du même type) ne ressortissent pas à la logique des manifestations conçues par les agences de communication ou de lobbying, dont le métier est radicalement différent de celui des think tanks. Il s’agit pour l’Ifri de favoriser la compréhension réciproque à travers des échanges approfondis et non protocolaires, ce qui suppose le respect de la règle de confidentialité. Plus généralement, l’Ifri organise des réunions spécifiques pour ses grands partenaires, afin de remplir au mieux sa fonction de conseiller, toujours conçue avec l’arrière-plan de l’intérêt général.
Ayant ainsi défini à grands traits les missions et les productions de l’Ifri, il convient de parler de ses structures. Toute étude sérieuse d’un think tank particulier devrait examiner en détail trois questions essentielles : (1) ses structures légales et sa gouvernance, aussi bien en théorie qu’en pratique ; (2) son financement ; (3) sa culture et donc son histoire. A fortiori, je ne vois pas comment procéder à une étude d’ensemble sur les think tanks sans comparaisons approfondies au regard de ces trois aspects.
L’Ifri est une association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, rassemblant actuellement environ 430 membres individuels et plus d’une centaine de personnes morales (entreprises [60] et ambassades [60] principalement). Il est dirigé par un conseil d’administration comprenant entre 18 et 24 membres, cooptés en raison de leurs compétences dans les domaines traités par l’institut et de leur engagement à défendre son indépendance.
Le conseil se réunit quatre fois par an et travaille selon des normes rigoureuses de gouvernance. Le directeur général, nommé par le conseil, prépare et exécute le budget. Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. Les opérations de l’Ifri font l’objet d’un double contrôle, privé (certification annuelle par un commissaire aux comptes) et public (examen régulier par la Cour des comptes).
Récemment, l’institut a entrepris de professionnaliser son management, en mettant en place des procédures comparables à celles familières aux entreprises. Je suis en effet convaincu que pareille professionnalisation est une condition nécessaire – ce qui ne veut pas dire suffisante – pour assurer la pérennité de l’institut. L’action du conseil d’administration est complétée par un conseil stratégique, à l’interface avec la direction générale, qui se penche plus particulièrement sur les différents aspects de la politique de la recherche.
La question du financement se pose dans des termes comparables à la composition du conseil d’administration. En 2010, le chiffre d’affaires de l’Ifri s’est élevé à près de 6,7 millions d’euros. En pourcentage, la contribution de l’État représente environ 27 %, sous la forme d’une ligne inscrite dans le budget du Premier ministre (et non pas celui des Affaires étrangères, comme on le croit souvent), et votée par le Parlement. Depuis 2005, cette subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs (CPO) avec l’État. Ce contrat formule dans les grandes lignes les missions d’intérêt général de l’institut, et reconnaît son indépendance.
Les cotisations des membres représentent environ 16 % des recettes. L’essentiel de ces cotisations vient des entreprises membres, parmi lesquelles un nombre croissant de PME. Le reste comprend les financements et les dons dédiés ou non à des programmes de recherche et à d’autres activités spécifiques, comme l’organisation de conférences. Le point important est qu’aucun financement individuel n’excède 300 000 euros, soit moins de 5 % du budget total de l’Institut. La plupart sont beaucoup plus modestes.
De plus, la direction de l’Ifri veille scrupuleusement à ce qu’aucun de ces financements ne s’accompagne explicitement ou implicitement de contreparties susceptibles de mettre en péril le principe d’indépendance. Cette dernière exigence a plus d’une fois conduit à écarter des opportunités par ailleurs alléchantes !
J’ajoute que, depuis 1995, l’institut est propriétaire de son immeuble, entièrement financé à l’époque par une campagne de levée de fonds privés pour un montant équivalent à environ douze millions d’euros. À l’époque, comme aujourd’hui, cette campagne a été conduite de façon à garantir l’indépendance.
Sans une bonne gouvernance et sans un financement sain, solide et équilibré, l’indépendance est un vain mot. Mais ces deux conditions nécessaires ne sont pas suffisantes. L’identité d’une institution est ancrée dans sa culture et donc dans son histoire. En dernier ressort, l’indépendance c’est celle des esprits. L’Ifri n’a aucune affiliation politique et n’a jamais dévié de cette ligne, ce dont la composition de son conseil d’administration témoigne également.
Les chercheurs sont recrutés exclusivement sur la base de leurs compétences, mais aussi de leur sens des responsabilités, car une voix qui s’exprime à l’Ifri augmente sa portée. C’est comme si l’institut leur donnait un haut-parleur. Ils partagent quelques valeurs fondamentales, comme l’intégrité morale, le désir d’atteindre l’objectivité mais aussi celui d’ajouter une pierre à l’édifice d’une gouvernance régionale ou mondiale plus respectueuse des hommes et des peuples. Dans cette quête, ils ne méconnaissent pas les vertus de la stabilité structurelle, autrement dit des réformes maîtrisées, dont l’échec conduit au déclin ou au chaos. Ainsi ne sont-ils pas des apôtres du « droit de l’hommisme », selon la fameuse expression d’Hubert Védrine, ou ne mènent-ils pas des croisades pour ou contre tel ou tel pays, tel ou tel régime ou telle ou telle cause. Et s’ils sont généralement engagés dans la construction européenne, par exemple, c’est par un acte de raison et non de militantisme. En un mot, le travail de l’Ifri s’inscrit dans un idéalisme de long terme et un réalisme de court terme.
Je conclurai mon propos en rêvant à voix haute d’un nouveau think tank, qui aurait pour mission d’observer et de disséquer tous les autres au regard de critères objectifs, tout en les situant dans le mouvement général des marchés des idées. Un professeur de l’Université de Pennsylvanie, James McGann, s’est lancé en 2007 dans l’élaboration d’un classement annuel mondial des think tanks, basé non pas sur des données objectives, mais sur des enquêtes d’opinion. L’Ifri n’a pas à se plaindre, puisqu’il en ressort comme le premier en France, le troisième en Europe et le seul français visible dans le classement mondial. Il n’en reste pas moins que la méthodologie de ce classement, ou plutôt de ces classements, mériterait d’être affinée. En outre, les institutions anglophones sont évidemment avantagées.
Un think tank sur les think tanks devrait évidemment réfléchir aux caractères qui les différencient des autres institutions. À mesure qu’elles se complexifient, les unités politiques ont besoin d’instances de réflexion critique sur elles-mêmes, aussi indépendantes que possible de leurs institutions classiques. Par institutions classiques, j’entends les organisations de toute nature (par exemple, administrations, banque centrale, universités, etc.) en charge du fonctionnement interne et externe de ces unités.
Le paradoxe des think tanks, c’est que pour exercer l’influence qui est leur raison d’être sans tomber dans le court terme et le commentaire quasi journalistique, ils doivent eux-mêmes exister en tant qu’institutions solides, mais des institutions d’un type particulier, puisque dénuées de toute responsabilité explicite dans la conduite des affaires publiques ou privées. Leur intérêt social procède justement de leur liberté d’analyse et de pensée que seule pareille déconnexion permet. Dans leur rôle d’aide à la décision, les think tanks se distinguent ainsi des autres conseillers professionnels publics ou privés, dont l’ouverture intellectuelle est par nature bridée.
Le monde n’étant pas près d’être constitué comme une unité politique, les think tanks seraient suspendus dans le vide, s’ils ne s’inscrivaient dans un cadre social précis : un État dans la plupart des exemples cités dans la présente communication, une communauté d’experts (originellement de l’Alliance atlantique pour l’Institut international d’études stratégiques de Londres, par exemple).
De même que, dans l’état actuel des choses, il n’existe guère d’entreprise « globale », de même tout think tank est ancré dans un environnement culturel particulier, qui en fait la richesse et en marque les limites. D’où l’importance, à l’ère de la mondialisation, d’un vivier de think tanks large, varié et interactif. De par leur nature, ces institutions sont bien placées pour tirer parti de l’enrichissement croisé des cultures, et donner ainsi consistance à l’idée si vague et galvaudée de dialogue des civilisations. Dans le même sens, on peut voir dans l’univers des think tanks comme un embryon de société civile mondiale et donc un aspect majeur de l’extension de la démocratie.
Pour que cette vision optimiste prenne corps, il faut cependant que l’esprit libéral se répande, c’est-à-dire que les conditions matérielles et spirituelles propres à l’épanouissement de vrais think tanks – pour lesquels une vision dépassant les intérêts particuliers de toute nature est essentielle – soient réunies. Or nous en sommes loin. Même dans un pays comme la France, la viabilité économique ou politique des think tanks dignes de ce nom est incertaine. Le risque est donc que les acteurs dominés par des intérêts particuliers ou par des idéologies jusqu’aux plus redoutables, ne s’imposent sur les marchés des idées, en usurpant la qualité de think tank.
Toute innovation a deux faces, une positive et une négative. Avoir confiance en l’homme, c’est croire que la première finit toujours par l’emporter. Gageons donc que le phénomène des think tanks, qui a pris son essor au cours du XXe siècle, s’épanouira au cours du XXIe siècle et, les technologies de l’information et de la communication aidant, jouera un rôle déterminant dans l’avènement d’une société mondiale à la fois plus équilibrée, plus juste et plus pacifique.