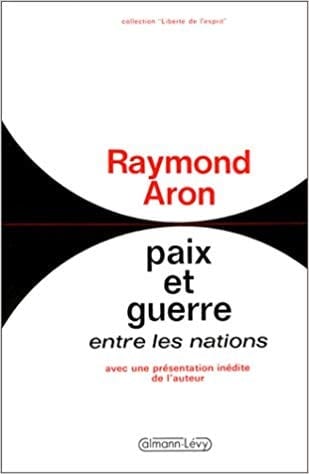
Relations internationales
Textes
Intervention au colloque «Relecture de Raymond Aron – Paix et guerre entre les nations – cinquante ans après (1962‑2012)» à l’Académie des sciences morales et politiques le 5 novembre 2012.
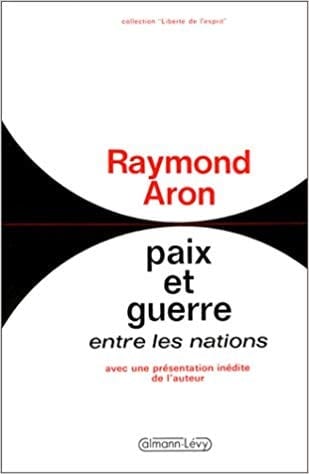
Je ferai quelques remarques préliminaires. Et d’abord, je viens d’ailleurs. Je veux dire que je suis à l’origine un scientifique et un économiste mathématicien. Je n’ai attaqué sérieusement l’étude des relations internationales qu’en 1973, en devenant le premier chef du Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères . L’avantage de la distance, c’est que l’on jette sur les choses un regard neuf et différent.
Ma deuxième remarque, c’est que, tout en admirant profondément l’œuvre de Raymond Aron, je n’hésiterai pas me montrer critique dans mon propos. Toutefois, je ne doute pas que, s’il pouvait m’entendre, il répondrait aussitôt à mes propres critiques par les objections les plus pertinentes. Ce qui peut parfois rendre un peu compliquée la lecture de ses œuvres, c’est justement que les objections à ses propres analyses apparaissent à l’intérieur même de ses développements.
J’ai rencontré Raymond Aron pour la première fois en 1973. Il m’avait invité à déjeuner au lendemain de ma nomination au Quai d’Orsay, et m’avait longuement parlé de Paix et guerre, dont il était très fier. Un peu plus tard – en 1976 très précisément – je l’ai lu intégralement et annoté à chaque page, et relu plusieurs fois par morceaux depuis. Parallèlement, je me suis attaqué à Clausewitz grâce aussi à Raymond Aron. C’est lui qui m’a incité à découvrir l’auteur de Vom Kriege dans le texte. Je me souviens nettement de mon plaisir en découvrant la fameuse clarté aronienne, une clarté toutefois relative pour la raison que je viens d’indiquer : chez Aron, dès que l’on commence à être convaincu par un raisonnement, apparaissent les objections qui vont créer le doute. Mais la clarté l’emporte ! Je garde aussi, encore aujourd’hui, l’impression d’une multiplicité de pépites. J’y reviendrai en conclusion tout à l’heure. Je crois qu’en lisant les classiques, ce que l’on retient, c’est parfois davantage des morceaux que le tout. D’autant plus que, en règle générale, ce « tout » nous est déjà parvenu à travers le filtre de réinterprétations successives (par exemple, en économie, Keynes « traduit » par Hicks et Hansen dans le fameux diagramme qui porte le nom de ces deux auteurs). Les grandes œuvres sont celles où l’on découvre presque à chaque page des aperçus surprenants, à l’écart de l’axe principal. Quand on a envie de tout souligner dans un texte, c’est assez impressionnant. Pour quelqu’un comme moi qui, je vous l’ai dit, ne connaissait pas grand-chose aux relations internationales, la première lecture de Paix et guerre entre les nations fut une véritable initiation, et toute initiation marque pour toujours.
Ma dernière remarque préliminaire, c’est que ce livre est d’une facture typiquement française par son foisonnement même. On n’imagine pas un livre américain écrit dans ce style. C’est en partie peut-être pour cette raison que le livre n’a pas eu de postérité aux États-Unis (on pourrait dire la même chose des autres ouvrages d’Aron), outre le fait qu’il fut assez mal traduit, ce qui est un autre problème.
Ayant dit cela, je commencerai par évoquer le plan du livre. Il contient quatre parties, intitulées : théorie, sociologie, histoire et praxéologie. La distinction entre théorie et sociologie ne me convainc pas. Un seul exemple : la puissance est traitée dans la théorie, alors que les ressources qui conditionnent la puissance ou qui la conditionnent en partie sont traitées dans la sociologie. Pourquoi l’espace, le nombre et les ressources sont-ils abordés dans trois chapitres différents et sur le même plan, alors que les deux premiers sont fondamentalement des facteurs de puissance particuliers, et donc des ressources ? En fait, sous ce vocable, Aron parle essentiellement des ressources économiques, c’est-à-dire de ce que les économistes appellent les facteurs de production, parmi lesquels la terre, laquelle apparaît donc dans deux endroits différents : la terre est traitée dans un sens que nous appellerions aujourd’hui géopolitique, et par ailleurs comme une ressource économique. Pour moi, il s’agit d’un seul concept qui revêt des faces ou des qualités différentes.
C’est ce genre de considérations qui m’ont conduit plus tard à écrire mon propre traité, L’Action et le système du monde, que j’ai donc entrepris en grande partie en pensant à Raymond Aron . La solution que j’ai trouvée pour ce problème des ressources ou des forces, c’est d’en prendre une acception large, en traitant sur le même plan et en généralisant les catégories classiques de facteurs de production, ainsi que la notion de fonction de production. Dans cette approche, font notamment partie des ressources les ressources humaines au sens le plus large du terme, y compris les ressources morales, à des degrés de stabilité variables dans le temps – la culture et les idéologies, mais aussi les passions ou les émotions. Je note au passage que le terme de géopolitique intervient chez Raymond Aron dans un sens très restrictif. Il traite essentiellement de la géopolitique allemande. Je rappelle que le terme géopolitique, aujourd’hui utilisé partout, n’a fait son apparition dans son acception actuelle que dans les années 1980. Il y a cinquante ans, on parlait plutôt de diplomatie. Pour moi, la géopolitique est une ressource morale particulière : l’idéologie relative au territoire. D’où cette remarque à ce point de mon exposé.
Revenons-en à la trilogie classique des facteurs de production : la terre, le travail et le capital. De mon point de vue, la terre doit être entendue à la fois dans le sens géopolitique d’espace et dans le sens de ressources économiques. Ce sont deux notions complémentaires et à vrai dire indissociables. Le travail doit être étendu aux ressources humaines, et le capital, par exemple, aux capacités militaires.
Il faut aussi, me semble-t-il, raisonner sur la chaîne ressources-pouvoir-puissance : ressources dans le sens large que je viens d’indiquer, pouvoir au sens de capacité de mobiliser les ressources dans une direction déterminée, et puissance, dans ma propre conception, au sens de passage à l’acte. Les explications très étendues que donne Aron sur la distinction entre pouvoir et puissance ne m’ont jamais parues totalement limpides. Pour moi, la distinction fondamentale entre pouvoir et puissance, c’est le passage à l’acte. Le passage à l’acte est toujours une discontinuité. Et d’ailleurs l’impuissance, dans tous les domaines, c’est précisément l’incapacité de passer à l’acte, alors même que l’on a théoriquement des ressources et la capacité de les mobiliser.
Il y a une autre distinction fort importante, également évoquée par Raymond Aron, mais pas totalement clarifiée de mon point de vue, qui est la notion de potentiel. Le potentiel, en effet, est souvent confondu – chez lui comme chez bien d’autres auteurs – avec les facteurs de production au sens large du terme. Cela revient, pour un économiste, à confondre la fonction de production avec le produit ou, si vous voulez, à identifier les facteurs de production – qui servent à produire quelque chose – avec ce quelque chose. On commet typiquement cette erreur lorsqu’on évalue le potentiel militaire d’un État par une mesure de ses capacités en hommes et en matériels. En fait, en dehors du cadre conceptuel de l’économie pure, le potentiel ne peut exister que comme notion qualitative : c’est ce que l’on peut virtuellement réaliser à partir des ressources dont on dispose. Cela, Aron en parle, mais certainement pas avec une netteté conceptuelle suffisante.
J’en arrive à la troisième partie du livre. Ce que je viens de dire, c’est qu’il y a certains recouvrements entre la première et la deuxième partie qui ne sont pas satisfaisants pour l’esprit. La troisième partie, consacrée à la conjoncture « actuelle », c’est-à-dire celle de 1960, constitue, comme il le dit lui-même, une histoire du système planétaire à l’âge thermonucléaire. Elle couvre une quinzaine d’années, avec, là aussi, de nombreuses incrustations théoriques. Plus généralement, ce qui m’a frappé en lisant ce livre avec un regard neuf, c’est que, de même que l’on voit beaucoup de références historiques dans la partie théorique, on trouve aussi beaucoup d’incrustations théoriques dans les autres, en particulier dans la troisième dont je parle à l’instant. Cela étant dit, cette troisième partie constitue un livre dans le livre, et de fait Aron a effectivement hésité sur la manière de la placer. Le texte proprement historique est évidemment daté et reflète la façon dont à l’époque on se représentait les problèmes du moment.
Mais mon malaise maximal est dans la dernière partie, c’est-à-dire celle qui s’appelle « Praxéologie ». Pourquoi praxéologie ? Aron a évidemment pensé à l’opposition theoria/prâxis chez Aristote, ou théorie/pratique chez Kant. Or, le substantif praxéologie n’apparaît que beaucoup plus tardivement chez Espinas en 1897 et Von Mises en 1949. Il signifie essentiellement science de l’action. Je l’ai moi-même repris dans ce sens dans L’Action et le système du monde. Quoi qu’il en soit, la praxéologie d’Aron comprend six chapitres. Les deux premiers, sous le chapeau « En quête d’une morale », sont consacrés respectivement à la dialectique idéalisme-réalisme et au thème wébérien de l’éthique de conviction et de l’éthique de responsabilité. De mon point de vue, ces deux thèmes relèvent plutôt de la théorie, et s’insèrent parfaitement dans la chaîne ressources-pouvoir-puissance à laquelle j’ai fait allusion. Le problème de la dialectique idéalisme-réalisme est à la base de la théorie des relations internationales. Avec l’éthique de conviction et de responsabilité, on entre dans la théorie de la décision et de la stratégie. Ce dernier thème comprend en particulier la question de la fixation des objectifs de l’action, de la décision, de la stratégie, et ces objectifs peuvent être définis – cela aussi, c’est un thème général – au sens étroit (l’intérêt au sens étroit), ou au sens large, puisqu’on sait bien que la notion d’intérêt est flexible, au-delà même de l’imbrication des passions et des intérêts, pour faire un clin d’œil à Hirschman. Aron montre d’ailleurs, que les objectifs peuvent se situer jusque dans l’au-delà. Ainsi en est-il de la gloire. Il insiste sur la gloire comme objectif, et l’une de ses affirmations qui revient à plusieurs reprises, est : la politique veut de la puissance afin d’accomplir une œuvre. La notion d’œuvre est essentielle. Mais ce qui reste de l’œuvre réside en définitive dans la mémoire des hommes. Le souvenir qu’il va laisser, la légende qu’il va engendrer, peuvent être au moins aussi importants, pour un grand homme d’action, que son œuvre concrète.
Dans les deux chapitres suivants, toujours dans la partie intitulée « Praxéologie », Aron s’adresse aux décideurs, et là il recherche une stratégie occidentale pertinente pour le début des années 1960, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque. Ces chapitres auraient pu trouver leur place dans la troisième partie, consacrée justement à l’analyse du temps présent. Ils auraient même à mes yeux justifié cette partie, présentée en quelque sorte comme application de la théorie. Je vous disais que la quatrième partie était celle qui me donnait le plus de malaise, mais dans cette quatrième partie, les chapitres qui me laissent le plus interrogatif, encore aujourd’hui, ce sont les deux derniers, c’est-à-dire ceux où l’auteur s’interroge sur l’alternative classique de la paix par la loi et la paix par l’empire. Ces sujets peuvent évidemment être traités de différents points de vue, et certainement en particulier des points de vue de la théorie et de l’histoire.
Dans le premier cas, c’est-à-dire la paix par la loi, il s’agit du problème de la construction dans le temps des institutions de la coopération internationale. Cela, c’est ce que nous appellerions aujourd’hui la gouvernance. Or c’est un sujet théorique par excellence, plus encore aujourd’hui qu’hier.
Quant à la paix par l’empire, il est évident à mes yeux que l’on doit l’aborder dans la théorie. Il s’agit de la stabilité, de la robustesse, de la fragilité plus ou moins grande des unités politiques au sens aronien, c’est-à-dire des États. Par exemple, le livre insuffisamment connu de Jean-Baptiste Duroselle, Tout empire périra, est un exercice de réflexion théorique sur le concept de fragilité des unités politiques. Incidemment, on oublie trop souvent que la chute de l’Union soviétique, le phénomène de 1989-1991, c’est en réalité deux phénomènes superposés, puisque c’est à la fois la chute du système communiste et celle de l’empire russe, c’est-à-dire la chute du dernier grand empire. L’histoire du XXe siècle est une histoire de chutes d’empires. Elle commence avec la fin de l’empire austro-hongrois et de l’empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, et finit avec celle de l’empire russe, mais ce dernier s’écroule d’un seul coup alors que les autres se sont désagrégés dans des conditions très différentes, surtout les empires coloniaux européens, qui ont mis trente ans à tomber.
En fin de compte, la distinction introduite dans Paix et guerre entre les quatre « niveaux de compréhension » ne m’a jamais séduit. Peut-être Aron aurait-il pu se contenter en fait de deux parties, qui auraient été « Théorie » – mais dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus systématiquement ordonné – et « Histoire ». Peut-être la « théorie » aurait-elle suffi, s’il avait voulu produire la sienne. Pour le théoricien des relations internationales, les concepts empruntés à la science politique, par exemple la légitimité, ou encore à la sociologie, à l’économie, à l’histoire, etc. sont des outils utilisables pour ses propres élaborations. Et l’« Histoire », du point de vue du théoricien, ce sont surtout des exemples, des illustrations, des études de cas.
Une difficulté vient de ce que Aron ne dit nulle part dans ce livre ce qu’il entend par théorie. Bien sûr, il a abordé le sujet par ailleurs, et plus tard, en particulier dans un article de 1967 intitulé « Qu’est-ce qu’une théorie des relations internationales ? ». Faute d’une définition de la théorie dans Paix et guerre, se pose un problème de classification. Je ne vais pas me livrer ici à un exercice épistémologique, mais il faut tout de même rappeler que, quelle que soit la manière dont on définit la théorie, on progresse dans la connaissance par des cheminements poppériens, du genre : examen des faits (on est souvent confronté à la difficulté de définir « les faits »), confrontation de ces « faits » avec un modèle issu d’une théorie, formulation de nouvelles interrogations, lesquelles conduisent à des réponses qui remettent en question et les « faits » que l’on veut observer et les modèles ou la théorie, et ceci dans une chaîne sans fin. C’est typiquement selon un schéma de ce genre que l’on peut avancer sur l’intelligence du système international. J’emploie à dessein le mot intelligence, qui fait notamment écho à la notion de « renseignement » dans son acception la plus large.
Aron donne une définition à la fois précise et imprécise du système international. « J’appelle système international l’ensemble constitué par des unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres des relations régulières et qui sont susceptibles d’être impliquées dans une guerre générale. » Ou encore : « Le centre des relations internationales, ce sont les relations interétatiques, celles qui mettent aux prises les unités en tant que telles. » Et, dans une conception parfaitement classique ou réaliste, Aron précise, je le cite encore : « Chaque unité revendique le droit de se faire justice elle-même et d’être seule maîtresse de combattre ou de ne pas combattre. » Il n’y a pas d’ambiguïté dans ces définitions. La dernière, en particulier, paraît très obsolète à la lumière des développements des dernières décennies, j’y reviendrai.
L’approche d’Aron est très proche de celle, encore plus concise, de Kenneth Waltz, l’une des grandes références de l’école réaliste américaine. Waltz dit tout simplement : « Les États sont les unités dont les interactions forment la structure du système international. » Ces définitions sont aux antipodes de celle d’un auteur français comme Marie-Claude Smouts, pour qui : « L’objet des relations internationales est le fonctionnement de la planète ou, pour être plus précis, la structuration de l’espace mondiale par des réseaux d’interactions sociales. » Les définitions d’Aron et de Waltz ont le mérite de se vouloir opérationnelles, mais soulèvent deux problèmes majeurs.
D’abord, chez l’un comme chez l’autre, les termes système et structure sont employés de manière vague. Nulle part ne sont approfondies les notions de système ou de structure qui, pourtant, soulèvent de vraies difficultés. D’un point de vue fondamental, ce n’est pas innocent. Nous étions à l’époque du structuralisme triomphant dans les sciences sociales. Je me souviens du temps où, en France, les facultés de sciences économiques donnaient des cours de « systèmes et structures économiques », qui ont depuis disparu du paysage. Il faut cependant attirer l’attention sur l’importance de la distinction introduite par Aron, certes trop marginalement, entre systèmes internationaux homogènes et hétérogènes. Il en attribue la paternité au Grec Panayis Papaligouras, dont je n’ai jamais vu le nom cité ailleurs. Dans mes propres travaux, je recours largement à cette distinction à mon sens fondamentale pour l’intelligence du monde contemporain.
Le deuxième problème, c’est que Aron ne précise pas ce qu’il entend par unité politique. On pourrait lui retourner un reproche qu’il adresse à Tocqueville. Il remarque que l’auteur de La Démocratie en Amérique n’a jamais défini rigoureusement ce qu’il entendait par société démocratique. Je cherche vainement ce que Aron entend par unité politique, sauf à identifier de facto ce concept aux États. Donc unité politique apparaît pratiquement toujours comme synonyme d’État, un État en quelque sorte insécable comme le noyau atomique du point de vue du chimiste. Il en résulte une simplification qui interdit typiquement de comprendre le monde dans lequel la réalité des relations internationales dépasse largement celle des relations interétatiques. Déjà à son époque, Aron a bien vu la difficulté, mais il la traite en surface et de façon juxtaposée, non intégrée dans une même théorie. Pour ma part, j’ai cherché, dans L’Action et le système du monde, à élargir le concept d’unité politique, que je conçois comme des unités actives composites qui se considèrent souveraines. La notion d’unité active – qui demande évidemment à être précisée – est à la base de ma propre construction. J’ai également proposé une définition moins contraignante du « système international » sur laquelle je n’insisterai pas davantage. On comprend en tous cas que Aron ait pu être accusé de holisme, ce dont il a tenté de se justifier dans la préface de la réédition de 1984.
Je mentionnerai brièvement deux inconvénients majeurs de ce holisme. D’abord au niveau de la prévision. Ni Waltz ni Aron ne semblent avoir envisagé sérieusement que l’URSS pourrait rapidement s’écrouler de l’intérieur. Je ne vois nulle part dans Paix et guerre un développement conséquent sur la possibilité même de la chute de l’Union soviétique. Et j’ajouterai que, dans le livre de Raymond Aron, Les Dernières Années du siècle, publié peu de temps avant sa mort, l’hypothèse de la chute de l’URSS n’a pas été prise en compte. De mon point de vue, il n’y a pas de théorie qui vaille sans capacité de prévision . Ce qu’il faut bien voir par rapport à la notion de prévision, c’est qu’une chose est de dire qu’un événement peut se produire mais avec une très faible probabilité – des événements de très faible probabilité se produisent tous les jours, nous le savons bien ; si l’on tire uniformément au hasard un nombre réel entre 0 et 1, la probabilité du nombre tiré était nulle ex ante –, autre chose est de ne pas envisager qu’un événement puisse se produire, ce qui est en effet d’un autre ordre que le fait de l’envisager avec une faible probabilité. Une des difficultés de la notion de prévision est que les causes immédiates des phénomènes complexes ne sont généralement pas de même nature que leurs causes fondamentales, et ne peuvent donc pas être approchées avec les mêmes théories ou modèles. C’est le cas, typiquement, des tremblements de terre… ou des révolutions !
J’ajoute qu’aujourd’hui la lecture de Paix et guerre ne prépare pas à l’intelligence du phénomène de la mondialisation, même si on trouve ici ou là dans son livre des remarques pertinentes pour cette question. Par exemple, à un certain moment, il fait allusion au monde fini de Paul Valéry, et écrit en note – c’est tout à fait typique de sa manière : « À vrai dire, Valéry songeait moins à l’occupation de toute la terre qu’à la mise en communication de toutes les fractions de l’humanité, de toutes les régions de la planète. » Cela, c’est évidemment l’essence de la mondialisation, et fait partie des petites pépites dont je parlais au début. Incidemment, et malgré les Dix-huit Leçons sur la société industrielle et tant d’autres écrits d’Aron, la technologie joue un rôle très limité dans Paix et guerre, sauf pour les questions d’armement. Or c’est bien la mutation des systèmes technologiques qui est la cause fondamentale à la fois de la chute de l’Union soviétique et de la mondialisation. C’est d’ailleurs à toute cette problématique que j’ai essayé moi-même de répondre, dans L’Action et le système du monde, en formulant d’autres concepts, et notamment comme je l’ai déjà dit un concept d’unité politique plus large que celui des États, qui permette par exemple d’inclure des unités comme Al-Qaïda ou d’autres groupes humains organisés susceptibles de jouer des rôles d’acteurs majeurs dans les relations internationales.
Je terminerai par quelques remarques qui reprennent sous un autre angle les questions soulevées à propos de la quatrième partie : est-ce que ce livre traite de paix et guerre, ou de guerre et paix, abstraction faite, si j’ose dire, de Tolstoï ?
À la fin de sa présentation sur la jaquette de l’édition dans laquelle je l’ai lu, et se référant aux deux derniers chapitres de son livre, Aron écrit ceci : « En un exercice de pensée utopique, je cherche les conditions de la paix par la loi ou par l’empire, dans l’immédiat ces conditions ne sont pas réalisées, et la paix ne sera rien d’autre que l’absence ou la limitation de guerre. Mais l’utopie conserve peut-être une vertu positive, s’il est vrai qu’à l’âge thermonucléaire seule est raisonnable donc réaliste une politique de paix. » L’auteur avait sans doute l’obsession de la paix, et d’ailleurs cela ressort aussi de la première partie de cette jaquette. Mais en réalité, Paix et guerre traite essentiellement de la guerre, et la paix n’apparaît que comme des interludes entre des conflits armés. Le scepticisme de Raymond Aron pour des notions comme la sécurité collective, l’arms control, etc. est omniprésent. Il peine manifestement à imaginer que le monde puisse évoluer dans le sens d’une sécurité plus collective, ou d’une organisation internationale plus structurée, malgré l’envolée des deux dernières pages de son livre qu’il emprunte à Jean Fourastié, lequel spécule en remarquant que l’homo sapiens ou sapiens sapiens représente une centaine de milliers d’années, alors que l’Histoire n’a que cinq ou six mille ans, et de se demander à quoi pourront ressembler les quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze prochains millénaires. Mais à part ce genre d’envolées empruntées, il n’y a à peu près rien sur la façon de construire un monde « meilleur », c’est-à-dire où les conflits soient davantage amortis. Il n’y a rien ou presque sur l’Union européenne, à l’époque Communauté européenne. Vous me direz que nous sommes en 1962 et que le traité de Rome date de 1957. Mais la raison pour laquelle je relève ce point, c’est que, dans son livre, Aron ne partage pas l’optimisme des pères fondateurs, l’optimisme sans lequel justement rien ne peut être entrepris. Toute entreprise, en effet, se donne pour but de transformer un rêve en réalité. Intellectuellement, un Jean Monnet n’arrivait pas à la cheville de Raymond Aron. Il n’empêche qu’il a eu l’intuition de ce que l’on appelle aujourd’hui le « fonctionnalisme » ou l’« engrenage ». Malgré tous les défauts que l’on connaît à l’Union européenne, celle-ci a montré au moins jusqu’à la crise de l’eurozone sa capacité à progresser dans le sens de la paix et de la prospérité à l’échelle d’un continent. En fait, toutes les notions liées à ce que l’on appelle dans la théorie moderne des relations internationales les régimes, qui sont plus que des alliances et moins que des fédérations, ou des notions comme des unités politiques susceptibles de dépasser la notion d’État, tout cela est fondamentalement absent de Paix et guerre. Et je pense qu’une théorie des relations internationales, certainement à l’époque contemporaine mais peut-être même déjà à celle d’Aron, doit consacrer une place importante à ces problématiques de construction de structures, de gouvernance et de durée nécessaire pour les construire. En d’autres termes, le but d’une théorie n’est pas seulement d’« expliquer » et de permettre des prévisions, mais aussi d’aider à construire un monde meilleur (par exemple, un fonctionnalisme effectif) de même que, à certains égards, les sciences de la nature sont les auxiliaires de la technologie. Pour me résumer sur ce point, je dirais que la géopolitique de la paix, pour employer un terme moderne, est au moins aussi importante que la géopolitique de la guerre .
Je conclurai en reprenant mon propos du début : Paix et guerre entre les nations mérite le statut d’un grand classique. Mais comme tout classique on le lit ou on le relit avec un regard différent de celui des contemporains. Ce qui me frappe, en lisant des livres dits classiques dans les domaines que je connais un peu, par exemple en économie, c’est de découvrir que leurs auteurs avaient une vision infiniment plus riche et diversifiée que la manière dont on les caricature à leur suite, dans les manuels ou les interprétations où on les schématise en les réduisant finalement à un squelette plus ou moins juste. La richesse merveilleuse d’un livre comme Paix et guerre entre les nations, c’est précisément ce côté touffu, le fait qu’à chaque page on trouve un aperçu qui suscite la réflexion et peut encourager des recherches nouvelles. Maintenant, si vous me demandez : « Raymond Aron a-t-il lui-même construit une théorie originale des relations internationales ? », la réponse est clairement négative. Mais il convient aussitôt d’ajouter que ce n’était pas son but. Et peut-être rejoint-on là son véritable drame, celui d’avoir davantage commenté que construit.
Quand le premier quart du XXIè siècle touche à sa fin
08 décembre 2025
MédiasUn effondrement de l'Ukraine n’est pas à exclure
04 décembre 2025
Relations internationalesL’Union européenne face à un déclin inévitable ?
28 novembre 2025
Relations internationales50 ans de la création du G7
17 novembre 2025
