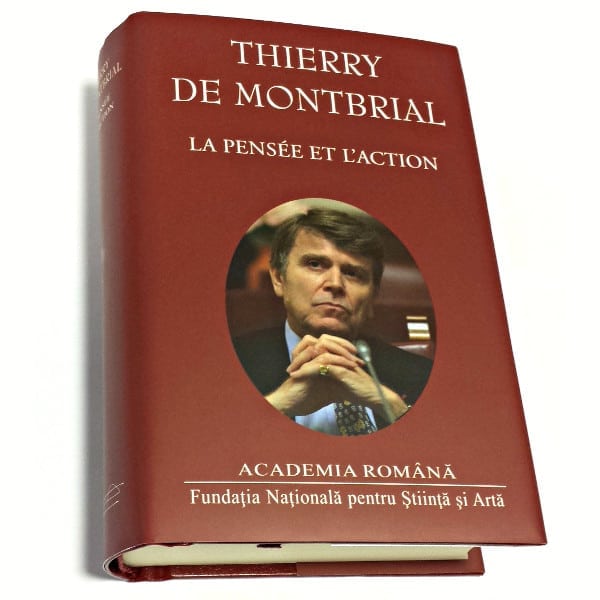Louis Joxe
« Notice sur la vie et les travaux de Louis Joxe » lue lors de la séance de l’Académie des sciences morales et politiques, le 3 mai 1994
Le siècle n’avait pas deux ans quand Louis Joxe vint au monde. Le XXe n’avait pas encore vraiment percé sous le XIXe. Lorsque, presque neuf décennies plus tard, il rendit son âme à Dieu, le monde venait de basculer dans le troisième millénaire. La vie de ce grand serviteur et de ce grand esthète a coïncidé avec l’une des périodes les plus fascinantes de l’histoire de l’humanité, le passage de l’âge européen à l’âge planétaire, la disparition d’un univers enfanté par la Révolution française et l’entrée dans une phase que l’on pressent radicalement nouvelle, qui nous excite et nous inquiète, et dont nous ne parvenons pas encore à saisir les contours.
Sur notre continent qui occupait le premier rang, ce long XXe siècle a commencé avec les illusions de la Belle Époque et s’est terminé avec les angoisses de la guerre, de la maladie et de la crise. Les cavaliers de l’Apocalypse occupent notre imaginaire. Plus que d’autres, les Français souffrent de leur recul, et leur humeur est sombre. Avec la chute de l’URSS, la Révolution française est vraiment terminée. Nos compatriotes redoutent sourdement que la France ne soit plus désormais qu’un pays comme les autres.
L’enfant Louis Joxe a grandi dans ces années où l’Europe brillait de tous ses feux et ne doutait pas de son avenir ; la France ne doutait pas non plus de son rayonnement universel. L’adolescent Louis Joxe a traversé la Grande Guerre. Le jeune homme s’est épanoui dans ces « années folles » de décompression, placées sous le signe de l’espérance en la construction rationnelle d’un monde meilleur. Il a vécu ses premières expériences politiques dans ces années 1930 de toutes les inconsciences et de toutes les lâchetés. À quarante ans, Louis Joxe rencontre le destin. Le général de Gaulle fut la grande passion de sa vie. Ses Mémoires se terminent par l’évocation du conservateur d’un musée mexicain qui, au terme d’une visite où il l’avait accompagné, lui prit les mains en disant : « Adieu, serviteur d’un héros… » Serviteur d’un héros, serviteur de la France, tel fut entre 1942 et 1968 le métier de Louis Joxe dans la force de l’âge, celui d’un acteur d’une tranche de l’histoire de France dominée par l’homme de l’appel du 18 juin. Dans la dernière partie de sa longue existence, Louis Joxe, témoin actif, observateur aigu, conseiller inappréciable, vécut les transformations de la France et du monde avec ce subtil mélange – qui contribuait à son charme – d’implication et de détachement, de conviction et de scepticisme. Il est parti discrètement, comme il avait vécu, ayant servi la France avec la grandeur de la simplicité, ayant beaucoup aimé la vie.
La Belle Époque, pour la famille Joxe, ne fut pas celle des plaisirs et des jeux, celle du monde ou du demi-monde, des De Dion-Bouton, des Hispano-Suiza ou des Rolls-Royce, celle de l’univers de Proust, de Colette ou de Feydeau. Pour l’enfant Louis, ces années où s’accumule la myriade d’impressions qui, en se cristallisant, déterminent l’axe autour duquel se déroulera la vie de l’adulte à venir, furent marquées par l’austérité, le devoir et la tendresse. Breton par son père et Alsacien par sa mère, petit-fils d’un artisan menuisier et d’un professeur d’allemand, fils d’un agrégé de sciences naturelles exigeant et sévère, Louis Joxe était fier de ses ascendances universitaires. Il avait neuf ans lorsque son grand-père maternel, le professeur, exilé et patriote militant, avait pu lui faire connaître l’Alsace alors allemande, quelques jours avant de mourir. « L’Alsace, écrit-il, fut pour nous un constant thème d’amour. La République aussi. » À sa grand-mère, quarante-huitarde, il envoyait un mot chaque année, le 4 septembre, anniversaire de la proclamation de la Troisième République, comme s’il s’était agi de la propre fête de son aïeule. Toujours, Louis Joxe se référera à la République comme un navigateur se sert d’une boussole. Mais son enfance studieuse à Bourg-la-Reine fut aussi illuminée par une mère qui sut créer pour lui « une sorte de féerie perpétuelle au cœur d’une vie modeste », en lui enseignant le goût de la peinture et de la musique, sources d’inépuisables joies pour sa vie entière.
Louis Joxe sera donc universitaire et républicain. Universitaire, au moins pour un temps, mais suffisamment pour être marqué d’une empreinte indélébile. Républicain, c’est-à-dire adepte du système de valeurs sur lequel la Troisième République se constitua et se consolida. Ces valeurs, comme la laïcité ou le service militaire obligatoire, portent encore une charge émotionnelle considérable . Mais, aujourd’hui, les querelles se sont déplacées, car tout le monde ou presque se dit républicain. Ce n’était pas encore le cas pour les hommes de la génération de Louis Joxe.
Le jour de l’armistice de 1918, le jeune homme venait d’avoir dix-sept ans. On imagine ce que purent être pour lui ces années 1920 où la France exténuée, mais glorieuse, explosait du désir de vivre. Attiré par le journalisme et passionné par la politique étrangère, il suivit néanmoins les conseils de son père et se présenta, mais sans succès, à l’École normale supérieure. Il ne devait jamais complètement oublier cet échec.
En 1923, Louis Joxe adhère au Groupement universitaire pour la Société des Nations (SDN) qui vient d’être créé dans le but de promouvoir l’organisme genevois pour la paix. Comme beaucoup des meilleurs esprits de l’époque, il adhère à l’idéologie wilsonienne. Il rencontre, dans ce club, de fortes personnalités qui compteront dans sa vie : Pierre Cot, Henry de Jouvenel, Pierre Brossolette, René Pleven, les journalistes Robert Lange et Jacques Kayser, l’avocat Philippe Serre. Ce milieu, dominé par la sensibilité radicale (1924 est l’année du Cartel des gauches et du gouvernement Herriot), est teinté de « pacifisme ancien combattant », une caractéristique du temps.
La SDN jouera un rôle important dans la vie de Joxe. « Jeter les fondements de la sécurité collective, condamner la guerre, poursuivre l’agresseur en mobilisant contre lui toutes les forces des autres nations, parvenir au désarmement général ou, tout au moins, à une réduction des moyens de guerre, l’entreprise, certes, ne manquait pas de noblesse, mais plutôt de réalisme. » Voilà ce qu’il écrit au début de Victoires sur la nuit , avant d’ajouter : « La plupart des hommes d’État que j’ai connus alors, la plupart de mes compagnons de jeunesse, donnèrent dans cette espérance. » Plus tard, ayant accumulé l’expérience et les combats, il deviendra sceptique, mais jamais amer ni destructeur. Réaliste, mais pas cynique. Sans doute aimait-il que la foi dans la construction d’un monde meilleur à partir de l’intelligence fasse toujours de nouveaux adeptes, même si lui-même n’y adhérait plus. Un peu comme les personnes qui ne croient pas en Dieu mais sont heureuses que d’autres y parviennent.
Dans les années 1920, Louis Joxe n’en est pas encore là. En 1925, il prend la revanche de sa défaite de la rue d’Ulm. Il est reçu à l’agrégation d’histoire et de géographie – alors un très grand concours – en même temps que son ami Pierre Brossolette, ainsi que George Bidault. Aussitôt, il va enseigner à Metz, mais guère longtemps ; car, décidément, sa vocation l’appelait vers d’autres horizons.
Un an après l’agrégation, il épouse Françoise Halévy, dont il a fait connaissance à la Sorbonne. Fait considérable dans sa vie. Louis Joxe avait horreur de parler de lui et de ses affections. Au seuil de ses Mémoires, il observe : « Tout homme chargé de responsabilités ou mêlé à des événements d’importance devrait […] être astreint à rédiger le compte rendu de sa propre existence. Le “moi”, pour une fois, ne deviendrait pas tout à fait haïssable. » Mais il entend que son « compte rendu » – ou, comme il dit, son « rapport » – ne dévoile pas ce qui n’appartient qu’à lui. Dans Victoires sur la nuit, on chercherait en vain quelque confidence personnelle, même si parfois, au détour d’une phrase, l’auteur laisse percer sa sensibilité. Joxe semble faire écho à Malraux qui, pour d’autres raisons, demande au début de ses Antimémoires : « Que m’importe ce qui n’importe qu’à moi ? » Il faut respecter la pudeur de Louis Joxe, et je ne ferai donc qu’évoquer la silhouette de Françoise Joxe, discrète et remarquable, dont il disait lui-même qu’elle possédait les vertus romaines, dont le destin s’unit désormais au sien ; dans des circonstances souvent difficiles, elle sut partager ses espérances et adoucir ses épreuves, et lui donna quatre enfants.
Avec son mariage, Louis Joxe pénétrait dans la grande bourgeoisie libérale où l’attendait sa place. Il se liait avec une famille qui, « par les dons et talents éclatants dont témoignèrent les membres des générations successives, traversa en une chaîne ininterrompue les XIXe et XXe siècles français ». Je citerai le saint-simonien Léon Halévy et son frère Fromental (1799-1862), le musicien de La Juive, qui, au Conservatoire de Paris, eut pour élèves Bizet, Massé et Gounod ; à la génération suivante, Ludovic Halévy (1834-1908), auteur avec Henri Meilhac des livrets des principales opérettes d’Offenbach : La Belle Hélène, 1864, La Vie parisienne, 1866, La Grande-Duchesse de Gerolstein, 1867, La Périchole, 1868 ; les deux fils de Ludovic, Élie (1870-1937) – cofondateur avec Xavier Léon de la Revue de métaphysique et de morale et auteur d’une célèbre Histoire du peuple anglais au XIXe siècle –, et Daniel (1872-1962), le père de Françoise, ami de Péguy et collaborateur des Cahiers de la Quinzaine, essayiste renommé. Daniel Halévy fut élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 1949. Le jeune ménage allait s’installer dans ce bel immeuble du 39 quai de l’Horloge, le port d’attache venu à la famille Halévy par les Bréguet, dont on peut dire qu’il appartient au patrimoine historique de Paris.
Louis Joxe fut plus proche d’Élie que de Daniel. La sympathie de l’auteur de l’Histoire du peuple anglais, qui vivait en partie à Londres, allait aux travaillistes. L’auteur de La Fin des notables , dont la vie fut beaucoup plus longue, se situait plutôt à droite ; il s’opposa à de Gaulle. Plus tard, la guerre d’Algérie fut l’occasion de nouveaux déchirements, reflets d’un mal dont souffrit la France tout entière. C’est peut-être vers l’académicien Jean-Louis Vaudoyer, oncle de sa femme, un homme qui fut au centre de la vie culturelle de son époque, que Louis Joxe se dirigeait le plus naturellement, à cause de leur passion commune pour la peinture, la littérature et le théâtre.
Le jeune agrégé ne voulait pas rester dans l’université. Louise Weiss le fit entrer à L’Europe nouvelle. Elle avait créé cette publication en janvier 1918, alors que la guerre n’était pas terminée, pour « prôner la création d’une Europe fondée sur des solutions meilleures que des coups de feu ». Dans un article publié en avril 1961 dans La Croix, Wladimir d’Ormesson évoquait cette revue hebdomadaire « qui rendait des services appréciables quand on voulait suivre dans tous ses détails le cours de la politique internationale. Rien ne l’a jamais remplacé[e] ». Commentant un film documentaire diffusé par la chaîne Arte à l’occasion du centenaire de Louise Weiss, Jean-Claude Rouy note que « L’Europe nouvelle est rapidement considéré comme le journal officieux de la naissante Société des Nations. On attend ses informations, ses traductions ». L’infatigable Louise Weiss associa également celui qu’elle appelait affectueusement « p’tit Louis » à son « école de la Paix ». Le futur ministre y côtoya, écrit-il dans ses Mémoires, toutes les vedettes internationales du moment, depuis Albert Thomas – socialiste et directeur du Bureau international du travail (BIT) – jusqu’à Paul Valéry, qui venaient y parler. Louis Weiss quittera la direction de L’Europe nouvelle en 1934, lorsque la Société des Nations fera faillite. Elle ne cessera jamais de combattre.
Mais, à la fin des années 1920, l’atmosphère est encore aux illusions. Le pacte Briand-Kellog de renonciation à la guerre date du 27 août 1928. Les années 1930 commencent dans l’allégresse et sombrent dans le drame. Louis Joxe diversifie ses activités. On le trouve dans un cercle d’amis dans la mouvance de L’Aube, un journal catholique né en 1932 sous l’impulsion de Francisque Gay et de Georges Bidault. Il y échange des idées avec Pierre Brossolette, Hubert Beuve-Méry et Maurice Schumann. Le voilà membre du cabinet de Pierre Cot, successivement sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et ministre de l’Air. Il y rencontre Jean Moulin. De Pierre Cot, Louis Joxe écrira : « Cet orateur et ce juriste au talent éclatant me fit faire mes premiers pas dans la négociation diplomatique, et je gagnai, en lui, un ami pour la vie entière. » La relation entre Cot et Joxe explique sans doute les calomnies dont le futur ambassadeur en Union soviétique fera l’objet quant à ses rapports avec les communistes, calomnies qui, quoique persistantes, ne sembleront pas le perturber. Après son passage dans les cabinets ministériels, il revient au journalisme et exerce la fonction d’inspecteur des services étrangers de l’Agence Havas-information, réorganisés à la demande de Philippe Berthelot. Il y apprend, dit-il, que la terre est vraiment ronde et qu’elle tourne ; il travaille avec Léon Rollin, Louis Perrin et « un certain Maurice Schumann dont les interventions et les chroniques brillaient d’intelligence ». Il est membre de la délégation française à la Société des Nations (1932, 1933 et 1939) où il croise Jean Monnet. En 1933-1934, il est membre de la délégation française à la Commission pour la réduction des armements et en même temps (1933-1936) attaché à la section d’information de la Société des Nations.
En plus de ses occupations journalistiques et politiques, le jeune agrégé d’histoire éprouvait le besoin d’établir la connaissance d’un monde en pleine mutation sur des bases plus solides. À l’époque où, en France, s’amorçait « le virage décisif entre l’histoire diplomatique et l’histoire des relations internationales » qui devait déboucher sur ce que l’on appelle aujourd’hui l’« histoire du temps présent », où s’illustrèrent Pierre Renouvin et son disciple Jean-Baptiste Duroselle, émergeait dans les pays anglo-saxons l’étude scientifique des relations internationales contemporaines s’appuyant sur l’histoire, la géographie, l’économie, la sociologie . De nouvelles institutions avaient été établies pour cela – certes dans la mouvance de l’idéologie wilsonienne – à New York (Council on Foreign Relations), à Londres (Royal Institute for International Affairs) et à Berlin (Institut für auswärtige Politik). Il s’agissait de favoriser les débats sur les problèmes concrets de politique étrangère en s’appuyant sur un socle de connaissances éprouvées. Louis Joxe et son ami Étienne Dennery conçurent le projet de doter leur pays d’un Centre d’études de politique étrangère (CEPE) qui pût jouer le même rôle en France. Ils surent y intéresser des personnalités comme André Siegfried, Henri Bonnet et le recteur Charléty, et parvinrent à obtenir une aide des institutions sœurs et des grandes fondations internationales. Louis Joxe et Étienne Dennery seront les cosecrétaires généraux du CEPE jusqu’à ce qu’ils décident de le fermer, en 1940. Le centre devait rouvrir ses portes en 1945 et, après une longue période de discrétion, renaître en 1978-1979 sous le nom d’Institut français des relations internationales (Ifri). C’est tout naturellement que le cofondateur du CEPE sera le premier président du conseil d’administration de l’Ifri, entre 1979 et 1983.
Comme tous les esprits lucides, Louis Joxe voit venir le drame. Il ressent intensément la tragédie de Munich. Une page de ses Mémoires résume l’essentiel :
« Au fil des années, la notion d’un monde dessiné comme un jardin de Le Nôtre est passée de l’idéal à la chimère, et du rêve au cauchemar. La naissance du fascisme, celle de l’hitlérisme, les bruits de bottes, les hurlements, la réoccupation de la rive gauche du Rhin par le Führer, rien ne troublait le morne sommeil de la Troisième République. Même pas la guerre d’Espagne, événement prémonitoire, machine à diviser les Français, répétition générale de ce qui suivrait. Il fallut Munich, l’aboulie apparente de la Grande-Bretagne, l’abandon de ses alliés par la France, la fameuse victoire de la paix pour inquiéter enfin.
Certes, la trahison fait mal – et surtout celle des intellectuels –, mais la mollesse plus encore. Daladier revenant de Munich réunit un soir autour de lui une petite équipe de politique étrangère. Il y avait là des hommes avertis. J’en garde un souvenir horrible. Sympathique mais sentencieux et las, le président du Conseil semblait ailleurs. Il avait, nous dit-il, marché sur les pieds du tambour-major de la garde nazie, qui ne se trouvait pas à la distance réglementaire de la troupe ; il improvisait un procès à l’École polytechnique à propos de l’équipement de l’armée. Tout ceci pour nous laisser entendre que rien n’échappait à sa vue mais trahissait sa lassitude.
Au sortir de cette soirée, le très respecté Maurice Pernot, du Journal des débats, et moi-même marchions en silence, sous une petite pluie fine et tenace. Mon compagnon s’arrêta dans sa course et me confia : “Nous sommes perdus”. Sans plus. »
1940. Louis Joxe, démobilisé, retrouve sa famille qui a échoué à Clermont-Ferrand après l’exode. Il va voir Jules Isaac à Vichy. L’auteur du plus célèbre des manuels d’histoire va sceller son destin en créant pour lui un poste de professeur à Alger. « Me voilà, ainsi, revenu à mes jeunes années, écrit Joxe. J’avais déserté l’Université, je retournais à l’enseignement. Je m’intéressais à la vie publique, elle s’écroulait sous les décombres, j’avais combattu le fascisme, il paraissait vainqueur. Dans le désastre général, ma défaite personnelle ne représente qu’un épisode. Encore me faut-il, tel Énée quittant Troie en flammes, emporter avec moi les divinités du foyer familial. »
En abordant le continent africain, Louis Joxe ne sait pas qu’il va à la rencontre de l’histoire. Dans l’immédiat, il ne se préoccupe que d’échapper à la servitude et d’y soustraire les siens. Lui qui aimait tant le vers sublime de Baudelaire, « Homme libre, toujours tu chériras la mer », savait que l’indépendance est un état de l’âme dont la pleine réalisation suppose des conditions objectives. Comme Janus, il avait deux visages aussi inséparables que ceux de frères siamois. L’artiste, le poète étaient indissociables du sage et du réaliste. Comme tous les grands caractères, le sien était une synthèse d’antinomies harmonieusement dépassées, un bouquet de talents individuellement répandus mais rares dans leur combinaison.
Louis Joxe découvre les charmes d’Alger la blanche et s’en laisse pénétrer. Il hume, observe, furète. Il investit un milieu grouillant de complots – la « marmite aux sorcières », écrira-t-il –, comprend les situations, évite les pièges. Il retrouve beaucoup d’amis, découvre de nombreux compatriotes alsaciens, se lie avec de nouvelles têtes. Parmi elles, Max-Pol Fouchet. Cet homme de grande culture, trop tôt disparu et aujourd’hui injustement oublié, avait vite compris, lit-on dans Victoires sur la nuit, « que tout l’art consiste à faire quelque chose avec rien et qu’un poème bien placé prend plus de sens qu’un long discours ». De même, comme le pensait Plutarque, dans une biographie, tel petit fait, tel mot, telle plaisanterie disent souvent plus sur la vie d’un homme qu’une relation laborieuse de son emploi du temps.
À deux reprises, Louis Joxe s’exprime à la radio d’Alger. Il parle de la victoire de Salamine et de celle de Valmy. Écoutons-le :
« Dans les deux cas, c’est au témoignage de l’ennemi que j’ai recours pour traiter le sujet, ainsi que l’a fait Eschyle dans Les Perses. L’immortel récit du messager apportant la nouvelle de la défaite de l’invincible Darius, l’effet décisif des mots encourageant les Grecs à la bataille restent au nombre des trouvailles dramatiques les plus saisissantes de l’histoire. Le chœur des Perses demande-t-il au messager les noms des chefs qui commandent aux Grecs ? Celui-ci se révèle incapable de citer des noms. Il peut seulement reprendre le cri des combattants se ruant tous ensemble : “Allez, enfants des Grecs, délivrez vos terres, vos maisons…”
Pour Valmy, j’avais fait un travail analogue en citant largement les témoignages des soldats prussiens participant à la bataille. L’essentiel restait, pour moi, que les Prussiens avaient fait demi-tour en entendant les troupes françaises crier d’un seul élan : “Vive la Nation !” »
Les auditeurs de Louis Joxe avaient compris le message. Au milieu des intrigues, l’esprit de résistance se développait. « Dans un régime de liberté surveillée, écrit l’auteur de Victoires sur la nuit, une ou deux phrases échangées, un geste à peine esquissé suffisaient parfois à créer un commencement de complicité. » Tout comme, dans le désert, la plus petite trace de vie remplit de joie et d’espérance le cœur du voyageur.
Joxe est mûr pour l’action. Gaulliste dès le 18 juin, il développe son engagement, non pas par un choix largement délibéré et clairement explicité, mais en conséquence d’un processus graduel et naturel, comme un sucre qui se dissout dans l’eau pourvu seulement qu’on l’agite un peu. Dans ce processus, la famille d’Astier jouera le rôle d’agitateur. En 1941, il avait noué des liens avec René Capitant et Paul Coste-Floret, animateurs d’un groupement gaulliste. Au début de 1942, il se rend à Lyon pour prendre contact avec la « France libre ». Emmanuel d’Astier le charge d’une mission dans le cadre de la préparation du débarquement en Afrique du Nord. Sur le rôle de la tribu d’Astier, laissons encore une fois la parole à l’homme que nous célébrons. Ce passage en révèle long sur lui-même : « Ce patronyme, cité ici, une fois de plus, tiendra sa juste place dans mon récit : c’est celui d’une famille chrétienne dont la tradition fut de “servir” et aussi de cultiver l’aventure. Ses membres évoquent une lignée d’Ancien Régime, où des courants de pensée divers et parfois opposés ne rompent pas l’unité du groupe. Pensons peut-être aux Guise, n’y pensons pas trop, leurs activités diverses s’exerçaient aux dépens du royaume. Les d’Astier, si différents les uns des autres, se retrouvaient sur le terrain commun du patriotisme. Henri se déclare ouvertement monarchiste, sinon d’Action française ; Emmanuel glisse de jour en jour davantage vers le “progressisme”, François se maintient dans l’“opportunisme”, au sens libéral et républicain du terme. Pour en finir avec les abstractions, deux traits les unissent encore. Sur le mode majeur ou sur le mode mineur, ils suivent de Gaulle. Une commune et irrésistible séduction se dégage de leur personne et de leurs propos. »
Louis Joxe entre donc dans l’action par l’intermédiaire d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie. Il participe à la préparation du débarquement allié. Il appartiendra, avec Henri d’Astier et René Capitant, au « triumvirat » des représentants à Alger du chef de la France libre. Le général Giraud l’exile à Constantine. Il retourne à Alger grâce à Jean Monnet qui l’appelle auprès de lui et dont il écrira, en reprenant le propos tenu par Frédéric le Grand sur son aïeul : « Celui-là a fait beaucoup. » Joxe suit en détail les péripéties des négociations entre Giraud et de Gaulle. C’est au cours d’une conversation avec Monnet, dans le forum de Tipasa, le village cher à Camus, que Monnet décide de tout mettre en œuvre pour faire venir de Gaulle.
Enfin, celui-ci arrive à Alger le 30 mai 1943. Voici Joxe, pour la première fois, devant l’homme qu’il suivrait désormais, écrira-t-il, parce qu’il était « celui qui, de tous, marchait le plus droit ». La scène se passe à la villa des Glycines. « Eh bien voilà ! lui dit de Gaulle sans ambages. Nous allons constituer un Comité de libération pour la France. Il nous faut organiser un secrétariat. J’ai pensé à vous. » L’heureux élu, ému, le remercie et s’entend répondre d’une voix ironique, presque gouailleuse : « Il n’y a vraiment pas de quoi. » Un peu plus tard, le Général lui précisera : « Vous saurez tout et vous vous tairez. C’est le meilleur moyen pour se faire respecter. » Mais Joxe sait depuis longtemps qu’en politique la maîtrise du verbe est vitale, et peut-être a-t-il médité la magnifique phrase qu’Homère fait dire à Ulysse l’avisé en réponse à une exhortation malencontreuse de l’impétueux Agamemnon devant le Conseil des chefs achéens : « Fils d’Atrée, quelle parole a franchi la barrière de tes dents ! » Lors du débarquement, Joxe avait admiré « la puissance du secret, là comme ailleurs ». Il partageait l’opinion de son éminent collègue anglais lord Hankey qui, « faisant référence à Polybe aussi bien qu’à l’Imitation de Jésus-Christ, soutenait que la plupart des hommes parlent trop et qu’il ne faut pas leur faire trop confiance ». Le thème du silence apparaît fréquemment dans le livre de Joxe. En voici encore un exemple : « L’art du silence et du secret s’avère aussi difficile que celui de la parole. Nécessaire à l’homme public qui veut surprendre, il se révèle indispensable au chef qui veut s’imposer. »
À deux reprises dans ses Mémoires de guerre , de Gaulle rendra hommage à son collaborateur. Dans le chapitre de L’Unité intitulé « Alger », il écrit ceci : « Techniquement, je me trouvais bien secondé. Dès le 10 juin [1943], nous avons doté le gouvernement d’un “secrétariat général” et mis Louis Joxe à sa tête avec, comme adjoints, Raymond Offroy et Edgar Faure. Joxe reliait les ministres entre eux et, avec moi, constituait les dossiers au vu desquels, d’après l’ordre du jour, délibérerait le Comité, prenait acte des décisions, assurait la publication des ordonnances et des décrets, en suivait l’application. Modèle de conscience et tombeau de discrétion, il devait assister pendant trois ans, en témoin muet et actif, à toutes les séances du Conseil. Le secrétariat général, inauguré à Alger, demeurerait par la suite l’instrument de travail collectif du gouvernement. » Joxe deviendra en effet, à la Libération, le secrétaire général du gouvernement provisoire et sera donc le fondateur d’une institution qui continue aujourd’hui de fonctionner selon les principes qu’il a établis. Dans le chapitre « L’Ordre » du troisième tome des Mémoires de guerre, le Général évoque le fonctionnement de l’hôtel Matignon à cette époque : « Le Conseil [des ministres] se réunit, en moyenne, deux fois par semaine. Ce n’est pas trop, étant donné le foisonnement des sujets et le fait que le gouvernement doit trancher au législatif aussi bien qu’à l’exécutif. Les séances sont préparées avec le plus de soin possible. La constitution des dossiers, la liaison de la présidence avec les ministres et avec le Conseil d’État incombent au secrétariat général dirigé par Louis Joxe. Parlant peu et en sourdine, se tenant sous un jour tamisé, Joxe assure sans à-coups la marche de ce mécanisme auquel tout est suspendu. »
Écoutons maintenant le témoignage de Raymond Offroy qui eut au départ, avoue-t-il, un sentiment assez réservé à l’égard de celui qui allait être son chef à Alger. « La seule qualité que je me reconnaisse, c’est l’habileté », lui avait dit Joxe lors de leur premier entretien. « J’ai toujours admiré, écrit Offroy, l’aisance avec laquelle mon patron manœuvrait dans cette grenouillère, réussissant à demeurer en bons termes avec tous sans jamais rien céder sur l’essentiel. Cette capacité qu’il avait de naviguer au milieu de cette faune inquiéta un moment le Général qui me demanda un jour : “Êtes-vous sûr que Joxe soit totalement avec nous ?” Je répondis : “Je suis certain qu’il est d’une fidélité absolue à votre personne et à votre politique et que son habileté est pour vous une efficace protection ; elle lui permet de déblayer votre route et de vous éviter des affrontements inutiles.” Peu après cette conversation, Louis Joxe sera appelé à assister aux séances du gouvernement. Il devra alors poursuivre son action de conciliateur auprès des personnalités de la Résistance et des partis politiques que le Général faisait venir à Alger. » Raymond Offroy ajoute encore : « Dans le rôle de “père Joseph” où il excella, Louis Joxe donna toute sa mesure ; les ministres oubliaient parfois qu’ils faisaient partie, selon l’expression du Général, “d’un gouvernement insurrectionnel”. Il appartenait alors à ce fin diplomate, qui naviguait à merveille entre Charybde et Scylla, d’aider ce navire improvisé à ne pas se briser sur les écueils qu’il trouvait sur sa route. Bien entendu, au fur et à mesure des succès remportés, son influence grandissait, mais Joxe était assez habile pour rester aussi modeste que silencieux. »
La réussite de Joxe, comme secrétaire général du gouvernement, ne tient pas à des qualités d’organisateur, en l’occurrence peu développées chez lui, mais à un étonnant mélange d’habileté et de fermeté, à sa fidélité à toute épreuve, à la justesse de son coup d’œil et de son jugement face aux situations les plus mobiles. Il excellait dans le rôle de trouble shooter, comme disent les Anglo-Saxons, locution que les mots français de médiateur ou de conciliateur traduisent mal, car il y manque l’idée d’une capacité à localiser avec précision la nature des problèmes à dénouer. Ces dons exceptionnels seraient encore mis à l’épreuve dans la suite de sa carrière.
Vendredi 19 janvier 1946. De Gaulle s’en va. Joxe convoque les ministres pour le surlendemain matin. Écoutons-le : « Nous sommes maintenant tous réunis dans la galerie des Armures du ministère de la Guerre, endroit sinistre et conventionnel que Palewski avait, un instant, transformé pour accueillir Churchill, mais qui est retourné à ses platitudes. Dautry arrive le premier, les larmes aux yeux, il murmure : “Ce n’est pas possible, non, ce n’est pas possible !” Peu résigné aux outrances de la vie parlementaire, il semble, aujourd’hui, le plus atteint. Les uns ont les yeux secs et semblent décontenancés ; les autres demeurent impénétrables selon la tradition gaulliste. Le Général parle en termes très simples, il dit qu’il ne peut, sans recourir à des moyens qu’il réprouve, admettre que l’expérience actuelle se poursuivre. Il se retire donc définitivement. Il les remercie du concours qu’ils lui ont apporté. Il part, comme toujours, en coup de vent. Thorez, visiblement troublé s’approche de moi et me dit : “Voilà un départ qui ne manque pas de grandeur.” »
Quelques instants après, dans le bureau du Général « à deux pas de celui où Clemenceau avait, autrefois, préparé la victoire », Joxe aperçoit un modeste objet, un plumier de carton bouilli semblable à ceux qui servaient aux écoliers du temps de sa jeunesse. « Dans cette seule occasion, note-t-il, je me suis permis de détourner sciemment le matériel appartenant à l’État. »
Le secrétaire général du gouvernement choisit de respecter le principe de continuité. Trente-cinq ans plus tard, un lointain successeur agira de même, pour l’honneur de la République. Ainsi s’achève une période exceptionnelle qui lui paraît, écrit-il dans Victoires sur la nuit, « la plus transparente de celles que j’ai vécues », avant d’ajouter dans une phrase bien de lui : « Ai-je besoin de le dire ? Le général de Gaulle est partout dans ce récit, mais, comme lui, j’aime une certaine discipline qui retient l’émotion. » Louis Joxe rentre dans le rang, mais à un niveau qui convient à ses grandes aptitudes. La Quatrième République le fera un moment conseiller d’État, puis directeur général des Relations culturelles avec l’étranger au ministère des Affaires étrangères (1946-1952), ambassadeur à Moscou (1952-1955), enfin, après un bref intermède comme ambassadeur à Bonn, secrétaire général du Quai d’Orsay.
La direction générale, nouvellement créée, convient à merveille à cet homme supérieurement cultivé, amoureux de la peinture et de la musique, qui avait une vraie dimension artistique. Sans doute éprouvait-il, après l’épopée à laquelle il venait de participer, le besoin de s’éloigner du cœur de la politique. Mais l’éloignement n’est pas toujours l’exil, et Louis Joxe fut le premier patron de ce qui est devenu l’une des plus importantes directions du ministère des Affaires étrangères. Beaucoup plus tard, à partir de 1968, et jusqu’au jour de sa mort, il sera heureux de présider aux destinées de l’importante Association française d’action artistique. Pendant son ambassade en Russie, il s’attachera à renouer nos échanges culturels avec le « pays des soviets ». Grâce à lui, pour la première fois depuis la révolution d’Octobre, la Comédie-française reprendra le chemin des théâtres de Moscou où elle recevra un accueil enthousiaste.
En juin 1952, Joxe s’installe dans ce curieux palais baroque, un bâtiment construit en 1880, de briques roses, de pierres blanches et de mosaïques vertes, qu’un riche marchand moscovite avait offert à une danseuse et dont le destin devait faire une ambassade de France. Lorsqu’il prend son poste, il reçoit des instructions précises de la part du ministère des Affaires étrangères. Pour l’essentiel, il devra vérifier la validité de l’hypothèse sur laquelle repose la politique soviétique de la France : face à la puissance américaine, Staline ne risquera pas ses immenses acquis récents dans une guerre générale. L’ambassadeur devra donc observer tout signe d’évolution de la stratégie soviétique. Il devra concentrer son attention sur quatre problèmes extérieurs : les relations germano-soviétiques, l’attitude soviétique face à l’unité européenne, les rapports entre l’URSS et les démocraties populaires, la question sino-soviétique. L’étude de la politique intérieure soviétique sera son second domaine d’investigation. Par l’analyse de la presse, par l’attention portée à la modification des mots d’ordre du Parti, Joxe devra décrypter les intentions des dirigeants du Kremlin.
Grâce à son pragmatisme, à sa finesse, à une expérience humaine considérable, grâce aussi à sa connaissance de l’histoire, il sera un grand ambassadeur. Quelques semaines après son arrivée, le Généralissime le reçoit. L’entretien fait beaucoup de bruit dans la presse de l’époque. Comment un ambassadeur présent à Moscou depuis si peu de temps a-t-il pu obtenir une audience de Staline ? La presse américaine s’interroge : existe-t-il un terrain commun entre la France et la Russie sur la question allemande ? La question paraît d’autant plus importante que nous sommes en pleine affaire des « notes soviétiques » portant sur la réunification allemande. Joxe n’était évidemment pas tombé dans le piège. Dans le télégramme qu’il envoie au Quai d’Orsay après son entretien, il écrit : « Mon interlocuteur a nettement voulu me donner l’impression qu’il attendait de moi certaines déclarations au sujet de la situation internationale et qu’il a été déçu de voir que, malgré ses invitations répétées, je tenais à garder à cet entretien le caractère d’une visite de présentation. » (télégramme du 22 août 1952) En novembre, l’ambassadeur explique : « Je note, dans les entretiens que j’ai pu avoir ici, une constante amabilité envers la France […]. Je note immédiatement que ces amabilités s’accompagnent toujours, de la part des vrais responsables, d’attaques contre les États-Unis […]. Il convient donc, en face de pareils propos, d’être constamment en position de répliquer et de corriger. » (télégramme du 27 novembre 1952)
Louis Joxe ne se trompait pas sur la nature du régime soviétique. Mais cet homme qui détestait ce qu’il appelait les « abstractions » recherchait sous la carapace de la dictature et de l’idéologie les réalités telles qu’en elles-mêmes l’histoire les change. Il savait que l’art de la politique étrangère ne s’accommode jamais d’une pensée manichéenne. Il pensait, comme le général de Gaulle lui-même, que, si l’URSS n’était pas un État comme les autres, il n’était pas non plus complètement différent des autres. Il croyait que, sans rompre la cohésion de l’alliance à laquelle nous appartenions, il restait une marge de manœuvre pour une politique proprement française.
À l’heure où le monde occidental s’interroge sur les conséquences de la mort de Staline le 5 mars 1953, Joxe fait le point. « Au poste où je suis, écrit-il dans un télégramme du 15 avril, j’ai maintenant l’impression qu’un encouragement donné publiquement par nous à une tendance encore à ses débuts pourrait jouer un rôle utile. Cette indication garderait évidemment un caractère assez général pour ne pas inquiéter l’Allemagne ni nuire à une coordination interalliée plus que jamais nécessaire. Je verrais à cela deux avantages : tout d’abord retirer leurs arguments à ceux des responsables soviétiques (et ils existent sûrement) toujours prêts à déclarer que l’on perd son temps à chercher les contacts avec les Occidentaux insensibles ; celui aussi de ne pas être taxés de réserve à l’égard du dialogue en train de s’établir entre Washington et Moscou et de continuer de jouer le rôle qui nous revient dans la recherche de la paix. » Quelques jours plus tard, Jean Laloy commente : « Le mérite de cette vue est qu’elle ne nie pas la réalité de l’évolution soviétique tout en la situant à sa place véritable, c’est-à-dire très loin d’un véritable tournant. » (compte rendu d’un voyage à Moscou et à Varsovie, 29 avril-20 mai 1953) Le 28 mai, le président de la République interroge l’ambassadeur : « Votre impression ? Sont-ils sincères ? Ne le sont-ils pas ? » Vincent Auriol note la réponse de Louis Joxe dans son Journal d’un septennat : « Ils ont besoin de la paix, de popularité. On relâche les cordes qui serrent le peuple, il y a une détente certaine à l’intérieur. Changement de ton de la presse. Je crois qu’après la mort de Staline, il y a eu flottement et indécision […]. Ils recherchent les contacts au point de vue commercial. Des avances sont faites aux Anglais et aux Français, c’est à mon avis une évolution qu’il faut suivre de très près. Je crois qu’ils recherchent une espèce de coexistence des deux mondes comme nous l’avons connue avant la guerre. » Louis Joxe observe lucidement l’évolution de l’URSS jusqu’aux approches du XXe congrès du PCUS, en février 1956, qui annoncera la déstalinisation. Il se montrera toujours équilibré dans ses conseils, souple ou ferme au moment opportun.
Au moment de la ratification des accords de Paris en décembre 1954, il convainc Mendès-France de l’attitude qu’il faut adopter face à l’Union soviétique. Celle-ci menace de dénoncer le traité franco-soviétique de 1944 si la France ratifie ces accords. Mendès estime préférable de ne pas réagir. Au contraire, Joxe recommande une attitude ferme. Voici ce qu’il écrit au président du Conseil le 20 décembre : « Je crois que nous ne pouvons laisser passer sans réponse l’accusation qui nous est adressée de nous désintéresser du pacte franco-soviétique. Ce procès est faux comme est faux le reproche que l’on nous fait de tolérer, voire d’encourager, une éventuelle agression allemande. […] Une réponse ferme et précise ne modifiera pas l’attitude actuelle de l’URSS. Elle placera dans sa véritable perspective l’indispensable ratification des accords de Paris. » Mendès se rallie à la position de Joxe et propose qu’une note soit envoyée de conserve avec les Britanniques.
À partir de 1952, alors que l’URSS redéfinit son attitude face aux Occidentaux, et jusqu’en 1955, quand les positions de chacun sont à nouveau bien solides, la diplomatie française cherche sa voie. Faut-il sacrifier sur l’autel de la « détente » l’intégration de la RFA à l’Occident ? Dans le triangle Paris-Bonn-Moscou, quel côté faut-il privilégier, sans pour autant remettre en cause les relations avec les Anglo-Saxons ? Telles sont les grandes questions qui préoccupent alors le Quai d’Orsay, où Joxe occupe désormais une place éminente.
Après un passage de quelques mois à Bonn, le voici, en juillet 1956, secrétaire général du ministère. Il succède au prestigieux René Massigli et compte, parmi ses prédécesseurs, Alexis Leger dit Saint-John Perse, prix Nobel de littérature en 1960, et Philippe Berthelot, fils de l’illustre chimiste Marcelin Berthelot qui, lui-même, avait été brièvement ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République, dans le cabinet Léon Bourgeois (1895-1896). Pour Louis Joxe, la fonction qu’il va occuper pendant trois ans est la première de l’administration française. Il en éprouvera certes de grandes satisfactions, mais aussi de grandes frustrations. Ces trois années sont riches d’événements considérables : la crise de Suez, l’affaire hongroise, la question algérienne, le traité de Rome. Le désastre de Suez le remplit de chagrin. Il a certes participé à toutes les rencontres administratives sur le sujet, et pourtant il est exclu des principaux aspects diplomatiques et plus exactement gouvernementaux de l’expédition. Après l’échec, il confiera à un proche : « Cela leur apprendra ce qui arrive quand dans les affaires graves on tient à l’écart les fonctionnaires compétents. » Les choses ne se sont d’ailleurs pas arrangées depuis lors. Sous la présidence du général de Gaulle, la diffusion des informations nécessaires pour que chacun pût tenir son rôle était méthodiquement assurée. Depuis une vingtaine d’années, les diplomaties parallèles et l’amateurisme semblent s’être progressivement répandus, en même temps que s’affaiblissait l’esprit d’indépendance sur lequel la haute administration française avait bâti sa réputation.
Louis Joxe est donc au Quai d’Orsay lorsque de Gaulle revient aux affaires. Sans doute le Général pense-t-il un moment lui offrir le bureau de Vergennes, mais son choix se porte finalement sur Maurice Couve de Murville. L’ancien secrétaire général du Comité français de libération nationale est-il déçu ? Sûrement. Amer ? Sûrement pas. Il aimait de Gaulle et considérait donc qu’il n’appartenait qu’à lui de déterminer la façon dont il pourrait le servir. Et de fait, il entra très vite au gouvernement, après avoir été élevé à la dignité d’ambassadeur de France. Entre 1959 et 1968, Joxe sera successivement secrétaire d’État auprès du Premier ministre (1959), ministre de l’Éducation nationale (1960), ministre d’État, chargé des Affaires algériennes (1960-1962), enfin garde des Sceaux (1967-1968).
De toutes ces fonctions, la plus importante par le rôle personnel qu’il y joua fut incontestablement la troisième. Lorsque, le 22 novembre 1960, de Gaulle le nomme ministre d’État, chargé des Affaires algériennes, l’ancien professeur d’histoire se sait investi d’une mission de sacrifice. Dans ses Mémoires, Michel Debré note qu’il a accepté « dans des conditions qui lui valent les remerciements du Général ». À la fin de 1960, les Français commencent à comprendre que, si l’on veut le cessez-le-feu, il faut parler avec le Front de libération nationale (FLN) et, pour parler avec le FLN, il faut se résoudre à reconnaître, au moins de facto, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) comme interlocuteur – peut-être même comme seul interlocuteur – dans une négociation globale et politique sur les conditions, les modalités et le contenu de l’autodétermination. Tournant extraordinairement difficile à prendre, d’autant plus qu’en Algérie comme en France les positions se radicalisent. À Paris, les tensions se manifestent au plus haut niveau de l’exécutif. Trois décennies plus tard, les Israéliens connaîtront une expérience semblable avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le 8 juillet 1961, de Gaulle remporte le référendum sur l’autodétermination et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie. En fait, le travail diplomatique a commencé dès le début de l’année, par l’entremise du Suisse Olivier Long. Louis Joxe consacre désormais l’essentiel de son temps à une négociation qui sera la plus difficile de sa vie.
Le 22 avril, le putsch éclate à Alger. Louis Joxe et le général Olié, chef d’état-major, vont en Algérie « prendre la température » et échappent de justesse aux parachutistes acquis aux rebelles sur la base de Télergma. Parmi les qualités de Louis Joxe qu’il est opportun de relever ici, son courage physique n’était pas la moindre. Il lui en fallut beaucoup pour exercer une fonction qui exposait sa vie, mais aussi celle de ses proches.
Le 25 avril, le putsch s’effondre. Joxe serre les vis, et la négociation reprend. Elle s’étendra du 20 mai 1961 au 18 mars 1962. Pendant tous ces mois, le ministre défendra avec acharnement les intérêts de la France et déploiera toutes ses qualités de diplomate hors du commun. Il forcera l’admiration de ses collaborateurs, mais aussi des négociateurs algériens. Cependant, avec la dégradation de la situation en France même, avec les activités de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), nous avions perdu la maîtrise du temps qui, désormais, ne jouait plus pour nous, mais contre nous.
L’Algérien Saad Dahlab, rapporte Olivier Long , « ne cache pas une très grande admiration pour le ministre Joxe. À l’issue de la dernière séance [des Rousses], Dahlab avait dit à ses collaborateurs que, même si la réunion des Rousses ne devait mener à rien, ils auraient acquis un enseignement précieux à voir négocier pendant dix jours un homme comme Louis Joxe ». Dans ses Mémoires, le même Dahlab rapporte l’anecdote suivante : « Un jour, M. Joxe, exténué, arracha d’un geste vif de la main gauche ses lunettes et les déposa devant lui, en jetant de la main droite son stylo au bout de la table : c’est un geste qui nous devenait familier chaque fois qu’il était en colère ou feignait de l’être. “Depuis quarante ans, grommela-t-il, que je noue et je dénoue des ficelles cassées, je n’ai jamais vu une négociation pareille !” Je lui répondis doucement de la manière la plus détendue possible : “Mais, Monsieur le Président, c’est la première fois que vous négociez avec des Algériens !” Il esquissa un imperceptible sourire en s’armant de nouveau de ses lunettes et de son stylo. » Et voici le témoignage de Vincent Labouret, collaborateur fidèle du ministre : « Devant les délégués du FLN, son calme était imperturbable. Il ne se permettait aucune facilité de propos ni d’attitude. Il traitait l’interlocuteur comme si celui-ci avait déjà la charge d’un État appelé à jouer un rôle international de grande conséquence. Il accomplissait, ce faisant, une œuvre d’initiation à la responsabilité et refusait l’appel à la facilité sentimentale. Ce n’était pas toujours compris, ni nécessairement apprécié. Ses interlocuteurs disaient parfois en confidence à des journalistes qui me le rapportaient : “Le ministre français nous parle comme si nous étions des diplomates belges ou hollandais.” Il ne voulait jamais brusquer, partisan comme le cardinal de Richelieu de toujours parler et de toujours négocier. Les interruptions qui marquèrent une négociation longue de quinze mois ne furent pas de son fait mais d’instructions qu’il recevait ou d’hésitations du FLN . » Vincent Labouret fait ici allusion au chapitre du Testament politique de Richelieu, au titre magnifique : « Qui fait voir qu’une négociation continuelle ne contribue pas peu au bon succès des affaires », où le ministre de Louis XIII déclare d’emblée : « J’ose dire hardiment que négocier sans cesse, ouvertement ou secrètement, en tous lieux, encore même que l’on n’en reçoive pas un fruit présent et que celui que l’on peut attendre à l’avenir ne soit pas apparent, est chose du tout nécessaire pour le bien des États. » Orfèvre du silence, Joxe était aussi argentier de la parole quand il s’agissait de rechercher avec un interlocuteur une position raisonnable.
Dans les Mémoires d’espoir, de Gaulle évoque Louis Joxe et l’Algérie. « Il souhaite ardemment, écrit-il, parvenir à un accord, mais il entend le bâtir valable et, par conséquent, raisonnable. Comme ses laborieuses fonctions de secrétaire général du Gouvernement, puis de ministre, l’ont placé depuis vingt ans au centre de l’éventail des affaires publiques, il embrasse complètement les multiples questions, politiques, économiques, financières, sociales, administratives, scolaires, militaires, posées par la construction d’un État algérien à partir de l’État français, puis par leur coopération étroite. Comme il est un homme de cœur, il s’applique à ce que les conventions à conclure ménagent la condition des personnes et, d’abord, celle des Européens qui va être péniblement mise en cause par la mutation des pouvoirs. Comme il est dévoué à l’entreprise du renouveau national, il s’attache à faire en sorte que l’affranchissement de l’Algérie porte la marque de la générosité et de la dignité de la France . »
L’histoire jugera les accords d’Évian. Le moment n’est pas encore venu. Mais on ne peut que souscrire à ce commentaire de Vincent Labouret dans l’article cité : « Que le statut des Européens défini à Évian – et qui rétrospectivement apparaît comme un exceptionnel échafaudage de privilèges et de dérogations aux usages communs – soit resté lettre morte est imputable à des événements et à un exode dont il n’avait pas la maîtrise : il en fut profondément affecté. » Louis Joxe ne porte pas davantage la responsabilité personnelle des injustices dont devaient souffrir de nombreux Algériens ayant opté pour la France. Dans son discours à l’Assemblée nationale, le 10 novembre 1961, il avait affirmé : « Le gouvernement a adopté un statut des Harkis qui doit donner satisfaction aux intéressés. Les Harkis seront maintenant plus assurés de leur avenir, et seront convaincus que la France ne les lâche pas. » La France les a lâchés, et Joxe en a été atteint au plus profond de lui-même. L’historien qu’il était savait mieux que quiconque que l’histoire peut déraper. Que l’on songe, par exemple, à la nuit communiste qui s’étendit sur le Vietnam après 1975. Pour cette Algérie qu’il connaissait si bien, Louis Joxe a accompli, sans broncher, la mission de sacrifice que lui avait confiée de Gaulle. « Car, en définitive, écrit encore Vincent Labouret, il y avait chez cet amoureux de la vie, chez cet hédoniste, un fond peu connu de stoïcisme. »
Une dernière fois, au gouvernement, Louis Joxe connaîtra l’épreuve du feu. En mai 1968, alors garde des Sceaux, il remplace le Premier ministre Georges Pompidou, en voyage en Iran et en Afghanistan. Pour lui, comme pour le Général, la situation est insaisissable. Le 10 mai, il refuse de libérer les étudiants arrêtés après les premières manifestations, bien qu’il ait proposé de rouvrir la Sorbonne. Il reste pragmatique car, le 24, il soumettra une loi d’amnistie pour les actes commis lors de ces manifestations. Il quittera le gouvernement à l’occasion du remaniement consécutif aux « événements de mai », sachant, comme dit Musset, que « le bien a pour tombeau l’ingratitude humaine ». Il servira encore comme député de Lyon, puis comme membre du Conseil constitutionnel, qui bénéficiera pendant douze ans de sa vaste culture et de sa prodigieuse expérience. L’Académie des sciences morales et politiques l’élira dans la section générale, le 16 juin 1980, sur le siège d’Alexandre Parodi.
Ce qu’il y a de plus intéressant dans l’homme, c’est l’homme lui-même. Louis Joxe était l’homme divers dont parle Montaigne. Il avait le goût de la vie sous tous ses aspects, de la gourmandise aux beaux-arts. Il aimait la vie mondaine, dans ce qu’elle peut avoir de raffiné. Il était très gai. Il était tout de charme et de séduction. Il aimait sillonner Paris à pied et en connaissait les secrets. Il savourait la compagnie des gens de musée. Il adorait le théâtre et, en musique, il allait avec le même plaisir de Bach à Villa-Lobos. Il connaissait l’opéra de Mozart à Wagner, mais aussi l’opérette, en particulier l’œuvre d’Offenbach, bien sûr, qu’il fredonnait. Sa culture était plus sensible que livresque. Chez ses contemporains, il recherchait moins l’œuvre que l’homme. Sa curiosité intellectuelle, immense, trouvait sa limite dans l’abstraction, qui ne l’attirait guère. Plus moraliste que philosophe, il détestait qu’on le traitât d’intellectuel, et, de fait, il ne l’était pas. À un collaborateur qui lui risqua un jour le mot, il répondit gentiment : « Ne m’insultez pas, ni un certain degré de culture auquel je suis parvenu. » Cela ne l’empêchait pas de croire que la pensée précède l’action, ce qui, après tout, est le principe premier de la stratégie. Il admirait les âmes de foi.
Louis Joxe n’était pas doué pour les langues vivantes, mais il excellait dans la relation humaine et avait un grand sens de l’étranger. Piètre orateur, mais raconteur éblouissant, il possédait au plus haut point le sens de l’humour, celui de l’ironie, et saisissait au vol, comme un caricaturiste, les situations cocasses. Il dominait l’art de la citation opportune, en français ou en latin. Peut-être parce qu’il n’était pas un grand travailleur, il renâclait à l’écriture et à ses exigences, mais son unique livre Victoires sur la nuit, que j’ai beaucoup cité, est magnifique.
À partir d’un certain âge, dit-on, on a le visage de ce que l’on est. Cicéron dit brièvement : « Le visage est le miroir de l’âme. » Celui de Louis Joxe vieillissant était plein, rose, encadré d’une chevelure blanc neige ondulée. Il était, ce visage, dominé par un regard bleu clair, à la fois embrumé et brillant, enveloppé comme celui du poète ou du rêveur, et intense comme celui du félin prêt à bondir, un regard à la fois distancié et proche, à la fois juge et partie. L’expression en était rehaussée par la broussaille des sourcils et par la moue de la bouche, parfaitement expressive. L’âme de Joxe s’est parfois laissé projeter sur des photographies qui en disent plus que ce discours. Personnage très contrôlé, il était cependant trop bon vivant pour aplanir ses expressions, et s’il savait ô combien que « savoir dissimuler est le savoir des rois », lui, qui était le moins vain des hommes, n’avait pas la prétention de parvenir au sommet de cet art monstrueux.
Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !
L’Homme et la mer. Homme libre, Louis Joxe et son regard bleu. Profondeurs infinies. Homme libéré. Cosmos inaccessible aux vivants, mais royaume des morts.