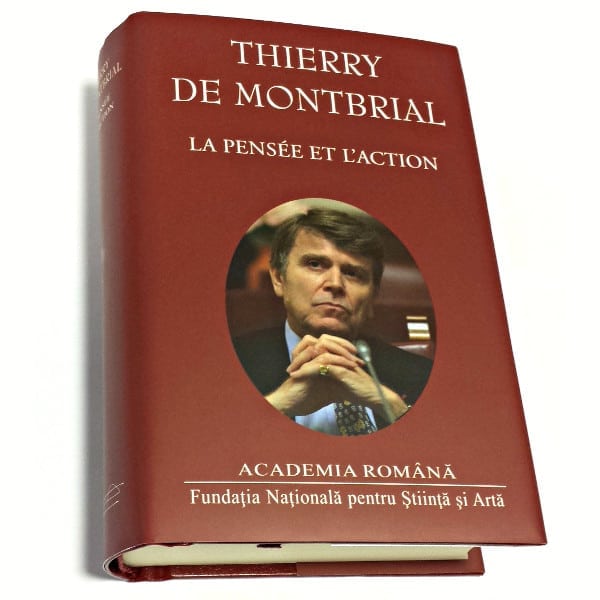L’informatique et la pensée
Transcription d’une conférence à la Société française de philosophie. Bulletin de la Société française de philosophie, séance du 13 janvier 2001
Une remarque terminologique avant de commencer. Au lieu d’« informatique », j’aurais pu dire « science de l’information ». C’est qu’il y a davantage dans l’expression « informatique ». Informatique suggère quelque chose de plus, qui est de l’ordre de l’écriture. De la même manière que l’on ne peut pas mettre de nom sur l’invention de l’écriture – je vois beaucoup plus l’écriture comme le résultat d’une évolution ; ce n’est pas vraiment une invention, c’est une émergence -, nul ne peut désigner le Newton ou l’Einstein de l’informatique. J’y reviendrai plus en détail. Quant au terme de « pensée », je l’utiliserai tantôt dans un sens faible, comme la ou les manières de penser, tantôt dans un sens plus fondamental.
Quelques mots sur l’organisation de cet exposé : audacieusement, je partirai – je commence mal pour un non-philosophe ! – de la pensée elle-même et j’envisagerai la conscience, le langage, l’écriture, les nombres, les mathématiques et la communication, tout cela allant ensemble dans notre sujet. Puis je passerai à l’informatique, à la fois science et traitement de l’information, l’informatique, en tant qu’hyper-écriture. Ensuite je proposerai quelques réflexions sur l’impact de toutes ces nouvelles réalités sur la culture, sur la manière de penser, sur la pensée elle-même ; avant de conclure, je reviendrai sur quelques questions fondamentales et même cruciales telles que la place de la logique et des mathématiques dans la pensée, sinon dans la conscience.
La pensée évoque la capacité d’identifier, sinon de créer des choses, des objets de pensée, de porter des jugements sur ces objets et d’établir des relations entre eux. Je dis : pensée en tant que capacité d’identifier, sinon de créer des choses, car cet aspect de « création » est important. Le constructivisme social, parfois de manière convaincante, parfois d’une manière excessive, s’attache à montrer que les choses, les objets de l’attention de l’esprit, sont souvent autant créés que donnés. Dans le domaine des sciences politiques, cet aspect le fait que la pensée crée des objets qui deviennent réels, dans la mesure où, dès lors qu’ils sont créés, ils se transforment en enjeux est particulièrement important. Par exemple, la « nation » est au moins autant un objet construit qu’un objet donné. Certains partisans du constructivisme social soutiennent que la notion d’objet construit s’applique également dans les sciences de la nature. Je ne me prononce pas sur le point de savoir où il faut arrêter exactement le curseur.
Pensée en tant que capacité d’identifier, sinon de créer des choses, capacité aussi de porter des jugements sur elles et de les mettre en relation. Il faut entendre par là que les jugements ne sont pas séquentiels, mais hélicoïdaux : la pensée fonctionne de façon hélicoïdale, c’est-à-dire que l’on revient constamment sur les mêmes choses, mais en montant. La pensée est évidemment étroitement liée au corps et plus particulièrement mais non exclusivement au cerveau. Ce sont là des affirmations à la fois banales et profondes. En disant que la pensée est plus particulièrement mais non exclusivement liée au cerveau, je veux souligner qu’à ma connaissance on n’a jamais vu une tête, complètement détachée d’un corps, qui continuerait de fonctionner avec des états de conscience. C’est concevable : peut-être arrivera-t-on un jour à détacher complètement des têtes et à irriguer le cerveau par une sorte de périphérique : un cœur artificiel, un poumon artificiel, un rein artificiel, etc. S’il apparaissait que la question avait un sens, il serait intéressant de savoir quel est le morceau minimal du cerveau qui, relié à des machines extérieures, pourrait encore donner lieu à des états de conscience. Peut-être découvrira-t-on que le corps tout entier participe à la conscience, à des degrés divers selon ses parties. Peut-être en viendra-t-on à connecter volontairement des cerveaux humains plus ou moins, donc, dépendants des corps dont ils font partie en réseau ! On découvrira peut-être que de telles connexions existent à l’état naturel dans un espace-temps où la distinction entre passé et futur n’est pas celle des données immédiates de la conscience, à travers des formes d’énergie que nous ignorons aujourd’hui. Jung, notamment, en était convaincu. En tout cas, ces phénomènes ne sont pas encore entrés dans le champ de la science. Des questions de ce genre constituent l’aspect, pour employer une image informatique, hardware ou « matériel » (ou encore « matériel-énergétique ») de la question de la pensée et du corps.
Le corps n’est-il que le « portemanteau » de l’esprit – pour reprendre une métaphore à la Bergson -, et l’esprit est-il davantage que ce portemanteau ? Cette question restera probablement posée indéfiniment : personnellement, j’ai l’intime conviction, indémontrable évidemment, que l’esprit ne se réduit pas au corps, et que les tentatives pour le réduire au corps ou le confondre avec lui sont vouées à l’échec. Et, question également fondamentale sur le très long terme : comment s’articulent dynamiquement les rapports entre l’esprit et le corps, la capacité de penser et le cerveau, tout au long de l’évolution ? Il est sans doute également impossible de répondre totalement à cette question. Incidemment, je suis frappé par cette sorte de réductionnisme consistant à mesurer la capacité de penser par le volume de la boîte crânienne. Je ne reconnais pas pour autant la corrélation entre le nombre des neurones (une centaine de milliards pour l’homme, environ vingt mille pour le cerveau de l’Aphysia, une espèce d’escargot utilisée par Éric Kandel dans ses travaux sur la mémoire) et l’espace nécessaire pour les loger. Cela dit, l’évolution humaine n’est certainement pas achevée. Il se peut même que, dans les siècles et peut-être dans les décennies à venir, l’homme en vienne à participer à sa propre évolution, ce qui entraînerait une accélération prodigieuse du phénomène. Il serait concevable que, dans les trois ou quatre prochains siècles, l’homme évolue biologiquement plus vite qu’il ne l’a fait dans les vingt mille dernières années. Donc, l’évolution humaine n’est pas achevée. Il se peut que nous participions à cette évolution de diverses manières, à travers nos modes de vie, bien entendu, qui peuvent modifier la sélection naturelle, mais aussi par une action plus directe, à travers les manipulations génétiques.
Sur le plan ontologique, la pensée est inséparable de la conscience dans son acception la plus fondamentale (je suis conscient d’être conscient…), laquelle constitue le plus indéfinissable des concepts. Certes, rien n’est définissable : on rejoint la pensée hélicoïdale. Je me souviens de mon premier cours de mathématiques spéciales. Pierre Martin, mon remarquable professeur au lycée Janson-de-Sailly, nous disait : « Qu’est-ce qu’un ensemble ? J’admettrai que vous en avez la notion et que vous en avez tous la même. » Et d’ailleurs, quand, en métamathématique, on cherche à faire la théorie dite formelle ou pure des ensembles, je ne suis pas convaincu que l’on obtienne beaucoup plus que ce que donne la théorie dite naïve des ensembles. De grands mathématiciens, comme Roger Godement , sont de cet avis. Il est donc normal qu’il soit impossible de définir un concept primitif : on n’approche les choses que progressivement. Mais, de la conscience, au sens le plus fondamental, on ne peut même pas parler. Je me sens toujours aussi frustré devant les définitions étroites de la notion de conscience qu’il m’arrive de rencontrer. Tout ce que l’on peut dire, c’est que nous avons effectivement conscience de notre conscience et que cette conscience réfléchie se manifeste notamment par le langage ou, plus généralement, par la communication avec les autres, ce qui renforce l’intime conviction que nous avons d’être des sujets conscients. Que dire de plus en termes simples ?
Cette remarque est cruciale, en raison de questions comme celle-ci : un ordinateur peut-il penser ? Ou encore : peut-on imaginer que la toile la toile étant Internet puisse devenir, en s’étendant, une sorte d’hyper-cerveau ? Pareille idée, qui reflète à mes yeux la forme actuellement la plus extrême du scientisme, réduit la conscience à une affaire de complexité, l’esprit étant conçu comme une forme d’organisation de la matière ou de l’énergie. Mais en employant ce dernier mot, on ouvre d’autres fenêtres, puisque l’on peut imaginer, par extrapolation de l’expérience historique, que le concept d’énergie est extensible. Après avoir établi au XIXe siècle que la biologie était un prolongement de la chimie , il s’agirait d’éprouver l’hypothèse qu’il en va de même de l’esprit et donc de la conscience.
Inséparable de la conscience, la pensée telle que nous pouvons l’appréhender dans la vie sociale l’est aussi du langage, c’est-à-dire de l’aptitude, observée chez les hommes, à communiquer au moyen des langues. Je n’aborderai pas les cas pathologiques et les problèmes redoutables qu’ils posent. L’intelligibilité du langage ou des langues met en jeu des structures très élaborées qui sont loin d’être élucidées. Ces structures sont beaucoup plus sophistiquées que des suites de monèmes ou, a fortiori, de phonèmes.
La pensée, dans ses manifestations sociales, est étroitement liée à la culture : c’est l’aspect software, ou logiciel du problème, alors que le cerveau et plus généralement le corps en seraient l’aspect hardware. La culture comprend au moins trois termes : une communauté, la nature au contact de laquelle cette communauté se situe et une mémoire « vive », c’est-à-dire constamment réactualisée. La langue, par opposition au langage, caractéristique sociale par excellence, est un élément majeur de la culture. Elle appartient en quelque sorte à son noyau dur. En constitue-t-elle l’élément majeur ? La réponse n’est nullement évidente. Pour un Français, ce sera sûrement oui, parce que, dans l’objet « nation française », objet en partie socialement construit, les deux caractères identitaires les plus simples ceux avec lesquels la notion de France s’identifie le plus immédiatement sont probablement la langue et l’Etat. Dans un pays comme les États-Unis, il en va autrement. La langue anglaise, pour les Américains, est un élément certes majeur de la culture, mais ce n’est pas le plus important. Si vous demandez à des Américains ce qui caractérise le mieux leur culture, ils vous répondront souvent : la Constitution. Il existe incontestablement une culture suisse, mais pas de langue suisse. L’hindouisme, élément structurant de la culture indienne, ne coïncide pas avec une langue.
La langue est pour les hommes dans leur ensemble le principal moyen de communication, fondé sur la faculté de parler ; mais il n’est pas le seul ; et bien d’autres signes sont simultanément échangés jusque dans la communication par la parole. C’est ce que l’on appelle familièrement la communication non verbale dont les signes mettent en jeu d’autres capacités et d’autres sens, par exemple la vue et l’odorat. Aujourd’hui, nous avons une idée plus précise de la variété des facultés que les communications les plus simples mettent en œuvre. Forme majeure, mais non exclusive de la communication humaine, la langue est aussi un élément fondamental de la pensée elle-même ; et, comme on dit, la forme agit sur le fond.
Je continue ces explorations ; vous pressentez qu’elles sont destinées à préparer les propositions que je formulerai ensuite sur l’informatique. On sait que l’on appelle langue tout système de signes vocaux doublement articulé propre à un groupe humain. La première articulation est celle des unités significatives de base, les monèmes ou les morphèmes, avec la distinction entre signifiant et signifié. Le signifiant, c’est la manifestation matérielle du signe, qui constitue le support d’un sens ; et le signifié, c’est le contenu du signe, c’est-à-dire le sens lui-même. La deuxième articulation du langage est celle des unités vocales, c’est-à-dire les phonèmes. Toute langue permet, par les ressources infinies de la combinatoire et de la structure, d’associer le précis et le flou, et ainsi de rendre ou de plutôt de suggérer les images qui forment la trame des états de conscience a priori insaisissables comme la conscience elle-même. J’ai eu le privilège de rencontrer dans son grand âge le philosophe René Poirier, dont l’une des idées clés était que la pensée est essentiellement associée à des images, images mentales, bien entendu. Le courant du langage et des images permet de combiner le précis et le flou. Toute langue riche sert ainsi de support à l’intuition, à l’invention, bref, au jaillissement de la « pensée constituante », qui fait éclater la « pensée constituée ». La poésie est l’une des manifestations de ces possibilités. Le rapport entre la langue et la conscience n’épuise certes pas le rapport entre la pensée et la conscience mais il en constitue l’une des principales manifestations objectives.
L’écriture n’est pas l’attribut essentiel du langage ; elle en est même un attribut tout à fait secondaire. Je lisais, par exemple, le dernier livre de Claude Hagège, Halte à la mort des langues . L’éminent linguiste évoque à peine l’écriture. Il en est tout de même un peu question, parce que, pour sauver une langue, il est clair que l’écriture intervient : si l’hébreu n’avait pas été écrit, on n’aurait pu le restituer ; et c’est également l’écriture qui, par des passages subtils, a permis de traduire les hiéroglyphes. Il n’empêche que, pour le linguiste, la langue, c’est d’abord le parler ; l’écriture ne vient qu’après, comme un appendice non nécessaire. Pour le linguiste, l’écriture se définit ainsi : c’est un système de signes picturaux ou graphiques qui correspondent aux signes vocaux du langage et servent à les représenter sous une forme plus durable. L’écriture peut être phonétique : elle est alors soit alphabétique (chaque signe visant à reproduire un son unique) ; soit syllabique (chaque signe correspondant à une syllabe) ; et elle est dite idéographique quand l’unité représentée est de première articulation .
L’histoire de l’écriture, comme celle de la représentation des chiffres, est inséparable de l’aventure humaine, même si les systèmes achevés d’écriture sont relativement récents : je suppose qu’il y avait des éléments partiels d’écriture avant la découverte de l’écriture. Cela est très clair pour l’histoire des chiffres. Les premières formes d’écriture achevée sont récentes : les premiers signes cunéiformes, les premiers hiéroglyphes apparaissent aux environs de 3 000 avant J.-C., donc il y a cinq millénaires. L’« invention » de l’alphabet je ne suis pas sûr que ce soit une invention semble dater d’environ 2 700 avant J.-C. Quant aux nombres et aux choses mathématiques en général c’est un point important pour mon propos , ils ne constituent d’aucune manière une langue au sens propre. Les nombres et plus généralement les choses mathématiques forment un univers en soi, et je me sens en parfaite harmonie avec la théorie platonicienne des nombres et des figures, dans son principe de base. Cela est important notamment par rapport à ce qui, dans les développements contemporains, est lié à l’informatique. Les linguistes ont de bonnes raisons de marginaliser l’écriture ; mais, lorsque l’on s’intéresse à la pensée, ou plutôt à l’expression sociale de la pensée, il en va autrement : l’écriture est en effet un instrument qui affecte la forme du discours et donc de la pensée achevée. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne puisse pas y avoir de discours achevé sans écriture. Mais on bute très vite sur tout ce qui limite la mémoire et la transmission orale.
L’écriture, de mon point de vue, fait partie du phénomène de l’évolution. Elle en est même probablement un caractère nécessaire, pour autant que l’on puisse rapprocher le mot « nécessaire » du mot « évolution ». L’écriture, je la vois comme une forme dont l’émergence est inséparable de la montée de la conscience, au sens le plus large du terme. Redisons-le en termes naïfs, la forme et le fond sont imbriqués. Jusqu’à quel point l’élaboration d’une pensée complexe est-elle concevable sans l’écriture ? Peut-on imaginer les grandes œuvres philosophiques ou mathématiques, par exemple, sans l’écriture ? L’écriture traduit le langage, en l’appauvrissant à certains égards, puisqu’il y a perte de signes d’accompagnement, mais elle le déborde dans d’autres domaines. Répétons ici que les mathématiques sont un système d’écriture qui ne correspond pas, pour l’essentiel, au langage. Ce n’est que par abus que l’on parle de « langage mathématique ». Il y a donc à la fois restriction-conservation et débordement. L’écriture est un acte physique, dont les modalités matérielles le stylo ou le crayon, l’encre, le papier ou l’ordinateur, les ratures influent peut-être sur l’émergence et le jaillissement même de la pensée. D’où, typiquement, l’importance de la calligraphie pour les « lettrés » chinois. J’ai connu personnellement un grand économiste, aujourd’hui disparu, John Hicks (prix Nobel de sciences économiques en 1972), qui disait volontiers que sa propre pensée se construisait progressivement laborieusement au fur et à mesure qu’il écrivait et réécrivait constamment livres et articles. Oserais-je dire que je « fonctionne » de la même manière ? L’écriture, indépendamment du parler qu’elle exprime par d’autres moyens, ne fait pas appel aux autres sens, dans l’acception physiologique du terme, de la même manière que l’ouïe. Dans la relation entre l’écriture et la pensée, le jeu des images mentales n’est pas le même qu’entre le parler et la pensée. Les ressorts d’ordre esthétique, par exemple, sont différents : la sonorité des mots et leur association sont une chose, leur arrangement graphique en est une autre. Il n’est pas équivalent de lire et de voir une pièce de théâtre. Certains poètes français du XXe siècle, comme Apollinaire, Éluard ou Cocteau, ont éprouvé le besoin de dessiner les phrases. Les hiéroglyphes, les caractères chinois, l’alphabet grec sont des petits chefs-d’œuvre dont les combinaisons véhiculent un pouvoir propre.
Revenons un instant aux mathématiques. Beaucoup de mathématiciens sont sensibles à l’aspect proprement esthétique de l’écriture mathématique, mais il y a davantage. L’écriture permet de considérables économies de pensée, la Denkökonomie selon le concept d’Ernst Mach. En mathématiques et dans toutes les sciences, il y a un ressort qui correspond à une sorte de principe de minimisation, de moindre effort, principe en fait commun à toutes les activités humaines. Et, naturellement, dans l’écriture mathématique, l’aspect condensation de l’écriture est fondamental. Pour un mathématicien contemporain, la lecture dans le texte des œuvres de Descartes, de Pascal, ou même d’Henri Poincaré, est extrêmement ingrate, quoiqu’il s’agisse, en ce qui concerne les deux premiers, de choses familières aux élèves des lycées. Ces choses s’expriment aujourd’hui beaucoup plus simplement et beaucoup plus brièvement, parce que la matière a été constamment décantée, restructurée (la notion de structure est devenue fondamentale en mathématique), notamment grâce aux systèmes de notation, et toujours selon deux principes, un principe d’économie et un principe esthétique. Quand j’étais élève à l’École polytechnique, on enseignait des théories qui ne figuraient pas dans les programmes d’agrégation trente ans plus tôt, et ce processus a évidemment continué. Cela ne signifie pas que les élèves ou les étudiants soient devenus plus intelligents ou plus capables : cela veut dire qu’il y a des processus de simplification, de reclassement, et les notations y jouent un rôle important. Les équations de Maxwell, qui établissent la synthèse des théories de l’électromagnétisme et de la lumière, en sont un exemple tout à fait frappant. À l’époque de Maxwell, ces équations étaient des écritures longues, pas très belles, assez encombrées. Dans la formulation contemporaine, elles s’écrivent sous la forme de quatre petites égalités, extrêmement plaisantes à contempler ; il existe même une forme encore plus condensée, fondée sur l’analyse tensorielle, et qui permet de les ramener à une seule relation d’apparence extrêmement « simple ». Les équations de la relativité, même générale, un domaine d’accès difficile, peuvent s’écrire très simplement et très joliment. Cet aspect de condensation de l’écriture est fondamental, parce que l’élévation des degrés de sophistication serait inimaginable s’il n’y avait pas l’écriture. Notre écriture n’est pas un simple appendice du langage : elle est beaucoup moins à certains égards, mais beaucoup plus à d’autres. Ainsi donc, autant il peut être licite de parler d’écriture pour les usages de systèmes de signes différents de ceux auxquels on se réfère habituellement. Je pense, par exemple, à un géographe comme Philippe Pinchemel, qui décrit sa discipline comme une sorte d’écriture de l’homme sur la face de la Terre. Pareille métaphore est licite. Ainsi encore lorsque l’on parle de l’architecture comme d’une écriture. Ce type de glissement sémantique est donc justifié dans certains cas et, en particulier, dans le cas de l’informatique.
J’ai rappelé la définition du langage telle que les linguistes la formulent, avec cette variante possible : le langage est l’ensemble de toutes les langues humaines considérées dans leurs rapports communs. Cependant, répétons que l’on n’a pas intérêt à nommer langue ou langage un système de communication humain, tel que peinture, musique, cinéma, etc., ou un système de communication animal, celui des abeilles, des dauphins, etc., dont on n’a pas démontré qu’il est structuré comme les langues naturelles humaines. Cette position est la seule possible quand il s’agit de borner un champ du savoir ; mais si l’on s’intéresse au problème général de la communication entre les hommes, dont les langues sont les moyens fondamentaux mais non exclusifs, il faut ouvrir l’éventail et non pas le refermer ; un exemple banal, auquel je me suis référé au tout début de ce chapitre, c’est la communication ordinaire entre deux individus, qui échangent certes des paroles mais aussi bien d’autres signes. Le pape Jean-Paul II a toujours été un « acteur », et les grands orateurs sont comme des acteurs de théâtre qui ne rendent leurs pleins effets que par l’association de l’ouïe et de la vue, dans le cadre d’une véritable mise en scène. Ils interagissent avec un public : la lecture à voix haute n’est pas la même chose pour celui qui écoute et pour celui qui lit, ou encore la lecture d’un livre illustré ne procure pas les mêmes sensations ou les mêmes rapprochements que celle d’un livre ordinaire, et ainsi de suite.
Du point de vue des sociétés humaines dans leur ensemble, les modes de communication se superposent ou plutôt s’enchevêtrent, c’est-à-dire qu’ils sont interdépendants. L’intelligibilité d’un discours fait appel à tous les ressorts de l’inné et de l’acquis, à toute une accumulation d’expériences cognitives, charnelles et spirituelles, hormis peut-être les énoncés les plus simples du genre : « Cet objet est une table », et encore une telle affirmation est-elle en fait assez riche. L’intelligibilité d’un discours est tributaire d’une culture, dans le sens le plus large du terme, et pas seulement d’une langue. En permettant d’étendre la diffusion de l’information, la découverte de l’écriture d’abord, celle de l’imprimerie quelque trois millénaires plus tard ont entraîné des métamorphoses culturelles, et, avec elles, des transformations profondes dans les modes de communication, dont l’évolution des langues n’est qu’un aspect. À une échelle de temps plus étendue, ces transformations, qui sont des reflets de l’évolution, pourraient-elles avoir un effet sur le genre humain lui-même ? On peut se le demander. Si le rapport entre l’écriture et la pensée ne se confond pas avec le rapport entre le langage et la pensée, on peut soutenir aussi, me semble-t-il, qu’il y a eu et qu’il y a un rapport spécifique entre l’imprimerie et la pensée. Dans les deux cas, écriture et imprimerie, il y a altération du rapport individuel entre signifiant et signifié, mais aussi, et peut-être surtout, transformation induite dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique, etc., et donc dans la culture, dont la langue n’est qu’un aspect.
L’informatique, je l’ai dit au début, peut être entendue comme la science de l’information ; en réalité, le vocabulaire dans ce domaine est flottant : on parle de science de l’information, de technologies de l’information, aux États-Unis de computer science, information processing, etc. Ce qui est intéressant, c’est que l’on mélange le fondamental et l’appliqué, le hard et le soft. La distinction entre le fondamental et l’appliqué s’estompe de plus en plus dans tous les domaines. Je relève pour l’instant le flottement terminologique. Il y a un gigantesque mouvement de convergence : l’ordinateur, les télécommunications, la télévision, les médias ne forment qu’un seul et même système. Ce mouvement n’étant pas encore stabilisé, il n’est pas surprenant que le vocabulaire ne le soit pas non plus, que des idées simples et claires n’aient pas émergé comme ce sera probablement bientôt le cas.
Dans le vocabulaire courant, le mot « information » est pratiquement synonyme de « renseignement », « ce par quoi on fait connaître quelque chose à quelqu’un », selon Le Robert. Sur le plan scientifique, la liaison entre La Science et la Théorie de l’information (titre d’un livre de Léon Brillouin publié en 1959 chez Masson) a pris sa source dans les années 1930. Le théorème de Gödel date de 1931, la « machine de Turing » de 1936. Rapidement, il est apparu que les idées pertinentes pour traiter certaines des questions pratiques dans le domaine des télécommunications puis des ordinateurs, idées étroitement liées à la théorie des probabilités, pouvaient, selon les propres termes de Brillouin, jeter des clartés imprévues sur une grande variété de problèmes « purement scientifiques ». Je cite Brillouin : « La définition de l’information dérive de considérations statistiques. […] Considérons un système susceptible de prendre différents états au nombre de p0, sous réserve que ces p0 états possibles soient également probables a priori. Telle est la position initiale du problème, si nous ne possédons pas d’information particulière concernant le système considéré [ce point de vue qui consiste à assigner des probabilités égales à des éventualités diverses sur lesquelles on ne possède aucune information correspond au principe de rationalité dite laplacienne]. Si nous obtenons des informations supplémentaires sur le problème, nous pourrons spécifier que l’un seulement des p0 états est effectivement réalisé. Plus grande est l’incertitude du problème initial, plus grand sera p0 et plus grande sera la quantité d’information nécessaire pour faire la sélection. » À partir de là, des considérations simples permettent de retenir comme mesure de l’information en question une grandeur proportionnelle au logarithme népérien du nombre p0. Dans un petit ouvrage célèbre de 1949 intitulé The Mathematical Theory of Communication , Claude Shannon et Warren Weaver ce sont les deux fondateurs du domaine ont généralisé cette formule au cas où la distribution des états initiaux est probabilisable sans être équiprobable. Du point de vue de ces auteurs dont les préoccupations étaient tout à fait pratiques , la transmission télégraphique d’une phrase est une suite de lettres choisies au sein d’un alphabet, comprenant par exemple les vingt-six lettres usuelles plus des blancs ou espaces entre les mots. Une telle suite peut être numérisée, c’est-à-dire transformée en une suite de 0 et de 1. Dans le cas de la transmission de phrases ordinaires, une partie de la difficulté est d’attribuer des probabilités aux différentes lettres en fonction de la langue au sens propre du terme et aussi en fonction de la nature du message transmis. Il est évident que les probabilités sont différentes selon le champ linguistique dans lequel on opère et selon les sujets dont on parle. L’une des connexions les plus remarquables entre la théorie de l’information ainsi élaborée par les ingénieurs et la science entendue comme l’étude des lois fondamentales de la nature en général est certainement l’interprétation de la grandeur « entropie », définie par le second principe de la thermodynamique selon la célèbre formule de Boltzmann-Planck : l’entropie d’un système est proportionnelle au logarithme népérien du nombre de ses complexions élémentaires, chacune de ces complexions correspondant à un état microscopique possible du système. Cette formule suggère un rapprochement entre les notions d’entropie et d’information qui s’est révélé extrêmement fécond. En fait, c’est la diminution de l’entropie d’un système, c’est-à-dire l’augmentation de sa néguentropie et donc de son ordre, qui correspond à l’accroissement d’une certaine quantité d’information. La science de l’information s’est aussi développée avec les ordinateurs, initialement considérés essentiellement comme des machines à calculer, avant de devenir des auxiliaires pour des problèmes d’organisation ou de management de toute nature, en approfondissant l’isomorphisme naturel entre les phénomènes électroniques, notamment les propriétés des semi-conducteurs, et la pensée logique : théorie des ensembles, algèbre booléenne, logique formelle, métamathématique.
Un des traits les plus intéressants de cet isomorphisme, tel qu’on le perçoit au tournant du siècle, est qu’il opère, si l’on peut dire, à proximité de certaines limites fondamentales. Il se passe quelque chose de tout à fait étonnant : la technologie des systèmes informatiques au sens large, y compris la téléphonie mobile, Internet, etc., opère d’ores et déjà à proximité des limites physiques, dans l’ordre des distances interatomiques. Les phénomènes d’écho dans les systèmes de positionnement terrestre (Global Positionning System ou GPS) font intervenir des corrections relativistes, où il s’agit de la relativité non pas restreinte mais générale. Ce genre d’observation conduit à poser le problème des limites ultimes de ce que l’on appelle la calculabilité, et, plus généralement, des possibilités de traitement de l’information. Il y a là des connexions fascinantes, par exemple avec la théorie du chaos. Nous sommes dans un indéterminisme situé dans un cadre déterministe : la théorie du chaos montre que, dans des systèmes d’équations différentielles non linéaires des systèmes entièrement déterministes (comme celui du problème des trois corps, à savoir le Soleil, la Terre et la Lune, étudié par Poincaré à la fin du XIXe siècle) , le fait que pour des raisons fondamentales les calculs ne puissent pas être exacts implique, contrairement à ce qu’affirmait Laplace, que la connaissance des données initiales (positions et vitesses en mécanique) non seulement ne permet pas de prédire quel sera au bout d’un certain temps l’état du système, mais ne permet même pas de savoir si le système lui-même (typiquement celui formé par la Terre, le Soleil et la Lune) est stable. Ou encore, dans un autre domaine qui lui aussi est du ressort du chaos, celui des grands courants sous-marins comme le Gulf Stream, on ne sait pas aujourd’hui si la trajectoire de ces courants est stable ou instable. Il suffirait d’un petit déplacement du Gulf Stream pour qu’un pays comme la France se retrouve sous les glaces. Le propre du chaos, c’est qu’il y ait dans un système des bifurcations certaines mais imprévisibles. Cette caractéristique est donc liée, non pas à un indéterminisme intrinsèque, comme en mécanique quantique, mais à la répercussion de petites erreurs qui ne peuvent pas être éliminées si la calculabilité à des limites absolues. Aujourd’hui, on ne sait pas s’il y a des limites à la calculabilité, mais on subodore qu’il doit y en avoir. Cela pose des problèmes fondamentaux sur la nature même des mathématiques.
Ces réflexions nourrissent le vieux problème de l’adéquation entre la nature et les mathématiques, et celui de la nature des mathématiques elles-mêmes. De ce point de vue, il est remarquable que les problèmes très pratiques évoqués ci-dessus se télescopent avec des problèmes touchant aux fondements des mathématiques. Je pense au théorème de Gödel déjà mentionné, parfois considéré comme un monument d’abstraction et qui se transcrit en la question de savoir si certains programmes ou certains algorithmes de programmation informatique peuvent ne jamais converger. Du point de vue de la pensée pure, il y a là des rapprochements fulgurants.
L’informatique, en tant que science de l’information, a acquis une ampleur considérable au cours de la seconde moitié du XXe siècle ; ses différentes branches ont donc tendu à prendre place dans un système unifié, en même temps que, sur le plan économique, se matérialisait la convergence entre télécommunications, ordinateur et télévision. Parallèlement s’est développé un nouveau paradigme, une nouvelle manière d’envisager les phénomènes. C’est ainsi que le vocabulaire et les concepts de la science de l’information ont accompagné avec succès l’immense développement de la biologie depuis les années 1950. En fait, dès 1944, dans son petit chef-d’œuvre intitulé What is Life ? , le grand physicien Erwin Schrödinger avait pressenti ce mouvement. On peut dire, en simplifiant, que le paradigme mécanique a dominé la science aux XVIIe et XVIIIe siècles, que le paradigme énergétique a graduellement pris le dessus au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Ce paradigme a évidemment été renouvelé avec la théorie de la relativité, l’équivalence matière-énergie, puis la dualité onde-corpuscule de la mécanique ondulatoire, mais il semble qu’il ne s’est jamais complètement débarrassé de la primauté de la matière sur l’énergie « pure ». On le voit bien à travers les difficultés que l’on éprouve à étendre le concept d’énergie et celles que les scientifiques ont à aborder et même à reconnaître des problèmes tels que la transmission de pensée ou ce que Jung appelait la synchronicité. Il existe incontestablement une catégorie de phénomènes et donc de problèmes tournant autour de la limite de l’extension de la notion d’énergie et de la question des rapports entre l’énergie et la matière qui sont quasiment niés par les scientifiques. Quoi qu’il en soit, le paradigme de l’information l’a emporté depuis la seconde moitié du XXe siècle, et rien n’indique qu’il soit condamné à une fin prochaine. Les paradigmes orientent le travail scientifique comme la culture oriente les comportements concept d’habitus cher à Pierre Bourdieu, mais, avant lui, à saint Thomas d’Aquin : les chercheurs qui se sont obstinés à sauver la théorie de l’éther restaient prisonniers de la vision mécaniste ; penser l’énergie sans un support matériel n’était nullement évident, pas plus qu’il n’est facile de comprendre le résidu d’indéterminé dans les fondements de la physique quantique.
Sommes-nous aujourd’hui prisonniers à l’excès du paradigme de l’information ? Cela est bien possible. Je prendrai encore une fois l’exemple du langage : pour un informaticien, un langage en fait un langage de programmation est un système de signes utilisé pour donner des instructions dépourvues de toute ambiguïté à un ordinateur ; c’est donc en fait une écriture logique, et tout langage de programmation doit être parfaitement traduisible en langage machine à base de données binaires. Le recours au mot « langage » est ici trompeur. La communication dont il s’agit s’établit entre homme et machine, ou entre machine et machine, mais elle n’est pas en tant que telle porteuse de sens et ne s’insère dans aucune culture. Elle est radicalement dépourvue de l’ambiguïté créatrice des langues réelles, laquelle est inséparable du phénomène de la conscience, de ce que j’ai précédemment appelé la combinaison du précis et du flou, combinaison qui permet de rendre ou tout au moins de suggérer des états de conscience. L’emploi d’un même mot, celui de langage, pour qualifier des réalités aussi différentes, n’est pas innocent. Il alimente la tentation d’affirmer que les ordinateurs en tant que tels ou les réseaux d’ordinateurs pourraient se trouver un jour capables de pensée, sinon de conscience. Il me semble qu’il y a là un glissement naïf, qui reflète la croyance selon laquelle la complexification des connexions informatiques aboutira un jour, de par son propre élan, à une structure plus ou moins comparable à celle du cerveau humain et qu’il en jaillirait en raison même de cette complexité, une sorte de conscience. Une telle vision n’a actuellement aucune consistance, mais elle exerce d’ores et déjà une certaine influence sur la manière de penser.
En ce qui concerne la notion d’information telle qu’elle est comprise aujourd’hui par les informaticiens, j’ajouterai trois brèves remarques. Primo, la notion d’information est toujours relative : il n’y a d’information que par rapport à des hommes et aux problèmes précis qu’ils se posent ; l’information n’est jamais définie de manière absolue, universelle, en dehors d’un contexte humain (c’est particulièrement évident quand on cherche à définir la « valeur » de l’information). Secundo, tout problème d’information est lié à un problème décisionnel ; et là, on rejoint la stratégie, l’analyse de la décision. C’est un aspect particulier de son caractère humain. Tertio, la distinction entre les concepts à la base des notions d’information et de traitement de l’information, à savoir le concept d’information lui-même et celui de donnée, est de même nature que la distinction entre les concepts de tactique et de stratégie : il y a des relations hiérarchiques entre la manière de classer ce qui est donné et ce qui est traitement de l’information : ce qui est donné au sens où l’on dit « les données d’un problème » pour les uns peut être information pour les autres ; ce qui est, au niveau le plus bas, tactique pour les uns peut être stratégie pour d’autres, et ainsi de suite : cela est lié au caractère relatif de l’information.
Abordons à présent la grande extension des dernières années et les perspectives qu’elle ouvre. Cette grande extension a, me semble-t-il, trois caractéristiques fondamentales : la première, c’est la combinaison de l’écriture au sens usuel, du son et de l’image. Bien sûr, il existait des interactions de ce type auparavant, par exemple l’opéra, où se combinent la musique, l’image et la parole. La deuxième, c’est l’interactivité tridimensionnelle, c’est-à-dire la combinaison des trois dimensions que je viens d’évoquer avec l’abolition des distances qui bouleverse les formes de la communication. Déjà, téléphoner fait que vous avez avec le langage une interaction différente de celle que vous avez quand vous parlez face à face. Donc modes d’interaction tridimensionnelle et abolition des distances, mais mécanismes d’interaction différents. Et la troisième dimension, c’est l’hypertexte, l’hyperlien, qui désigne la possibilité de « naviguer » sur Internet, avec ce que l’on appelle des aides à la navigation, des moteurs de recherche, selon des règles permettant de retourner en arrière sans se perdre. Ce sont donc des modes de fonctionnement différents des procédures traditionnelles de lecture ; l’informatique, en ce sens, peut être considérée non pas comme un hyperlangage, mais comme une hyperécriture, le concept d’écriture étant, je l’ai dit, à la fois plus étroit, mais à certains égards plus riche, que celui de langage.
Tout cela soulève un monde de questions. La plus générale concerna la manière de penser le problème du lien entre la forme et le fond. Puisque la forme change, le fond ne va-t-il pas changer ? Nouveau mode de perception, nouveau mode d’expression, nouveau mode d’association, nouveaux stimuli : on ne circule pas dans les réseaux comme dans les livres. Nouveaux comportements, nouvelles attitudes : face à un problème, on ne cherche pas comment le résoudre regardez certains jeunes aujourd’hui : ils ne savent pas comment résoudre le problème, ils cherchent à savoir qui l’a déjà résolu, ce qui est une tout autre démarche. Ces nouvelles manières exercent un effet sur la génétique culturelle, dans toutes ses dimensions, y compris la création artistique : rétroaction, en particulier, sur le langage lui-même et peut-être, à plus ou moins long terme, sur l’évolution cérébrale, avec ou sans manipulations génétiques. Ce qui rejoint le thème de l’homme participant à sa propre évolution. Exemple de question particulière : comment l’utilisation de ces hyperécritures va-t-elle transformer le problème de l’analphabétisme et de l’illettrisme, l’illettrisme étant habituellement défini comme l’incapacité de maîtriser un texte simple ? Ou encore : le développement des jeux électroniques avec ses perversités (formes plus ou moins dissimulées de violence, etc.) va-t-il modifier les comportements sociaux ? Dans l’ordre économique et dans l’ordre politique, mentionnons des problèmes tels que l’avènement de ce que l’on appelle l’économie d’accès, et sa problématique liée à la notion de bien public, le bouleversement de la notion d’intermédiaire, le commerce électronique, les perspectives de développement. Dans l’ordre plus spécifiquement politique : la réorganisation des unités politiques, l’avenir des États-nations. L’Union européenne, par exemple, est une reconstruction complète, en grande partie en conséquence des mutations induites par la révolution de l’information. Mentionnons aussi la question de l’avenir des modalités de la démocratie et donc de la démocratie elle-même.
Je voudrais avant de conclure revenir sur quelques questions, à mon avis, fondamentales. Tout d’abord le triomphe et les limites de la pensée logique : la convergence, bien comprise à la fin du XXe siècle, ce n’est pas seulement ce que l’on désigne habituellement par ce terme, à savoir les télécommunications, l’ordinateur et la télévision. Je veux parler ici de la convergence entre le domaine des fondements des mathématiques, de la métamathématique, de la logique, de l’informatique et de la technologie, donc de nouvelles façons d’envisager l’interaction entre la pensée et la nature. Deuxièmement, le problème de la place particulière des mathématiques dans le fonctionnement de l’esprit et dans la nature. J’ai déjà eu l’occasion, au début de cet exposé, de me déclarer platonicien.
Cela me conduit à quelques remarques complémentaires : l’une des merveilles des mathématiques, c’est que l’on peut tout construire à partir de l’affirmation de l’existence de l’ensemble vide, ou encore d’un élément unique commun à tous les ensembles concevables et que l’on pourrait appeler l’élément « rien ». L’ensemble vide est l’ensemble qui contient « rien », et rien que « rien ». À partir de là vous pouvez, uniquement avec les opérations logiques « il existe », « quel que soit », « implique »… , construire l’ensemble des entiers naturels, puis successivement l’ensemble des entiers relatifs, les nombres rationnels, les nombres réels, etc. Tout s’enchaîne. Et donc, vous accédez au concept de l’infini, qui se déduit de « rien » : l’infini vient de « rien ». C’est assez extraordinaire. Toutes les mathématiques peuvent se construire à partir de littéralement « rien ».
Est-ce à dire que toute la connaissance et les échanges relatifs aux connaissances seraient réductibles à des systèmes logiques, donc à de suites de messages binaires 0 et 1 (0 correspondant à l’ensemble vide et 1 à l’ensemble qui comprend deux éléments, à savoir « rien » et 0) ? N’est-ce pas une illusion de croire que tout peut se ramener à des échanges logiques ? L’utopie de ceux qui attendent de « la science » l’explication ultime de l’Univers ? J’oppose « Univers » à « univers ». L’astrophysicien Edward Harrison a publié un bel ouvrage sur la cosmologie dans lequel il distingue entre l’Univers auquel nous n’avons par définition pas accès et les « univers » qui ne sont que des modèles de l’Univers tel qu’on se le représente à des phases successives de l’humanité. Utopie, donc, de croire que la nature serait entièrement déductible du néant représenté par l’ensemble vide : si tout est mathématique, vous pouvez tout construire à partir de rien, littéralement, c’est-à-dire du vide tel que vous l’imaginez avec votre support cérébral (peut-être celui auquel se réfère le bouddhisme !). Autrement dit la nature, dans l’acception la plus large du terme, serait isomorphe aux mathématiques : dans ses moindres aspects, l’Univers serait mentalement constructible par une suite d’inductions logiques. Il me semble qu’une telle vision doive être catégoriquement rejetée. Croire que des suites numérisées de signifiants, dépourvus d’un contexte culturel, et donc relationnel, puissent engendrer un sens, me paraît aussi puéril que de concevoir la conscience comme la simple conséquence d’une combinaison matérielle, ou énergétique, au sens où nous concevons aujourd’hui le concept d’énergie. D’ailleurs, peut-on penser les mathématiques en dehors du langage humain ? deuxième aurait-il pu écrire son traité des Éléments de mathématique sans aucun recours à une quelconque langue, au sens propre du terme ? Et à supposer qu’une telle entreprise ait été menée à bien avant l’apparition de l’homme sur la planète Terre, quel usage un homo sapiens vivant il y a vingt mille ans, fût-il génial, aurait-il pu en faire ? Du reste, le projet de Bourbaki s’est rapidement ensablé, sans doute parce qu’il ne pouvait pas en être autrement.
Sur la planète Terre, la communication entre des civilisations et des cultures sans passé commun mémorisé est possible pour trois raisons essentielles : la première, c’est l’appartenance au même genre humain et la possibilité de communication non verbale ; la deuxième, c’est l’existence des mêmes référents sensibles, c’est-à-dire la terre, l’espace, les besoins de base de la vie, etc. ; la troisième, c’est l’existence de passés relationnels non mémorisés mais intégrés dans les cultures et qui, de ce fait, favorisent leur compatibilité. D’où les possibilités d’élaborer des traductions, de fabriquer des langues mixtes de communication, lingua franca, sabir, pidgin… Tout cela n’empêche pas, bien entendu, la possibilité d’une incompréhension fondamentale, à laquelle sont confrontés ceux qui travaillent fréquemment avec des étrangers ; et, dans le phénomène de la communication, les aspects synchroniques et diachroniques sont inséparables de l’évolution.
Imaginons a contrario une expérience de pensée, un Denkexperiment, comme disait Mach le genre d’expérience mentale que le mathématicien Alain Connes aime envisager, à ceci près qu’il est platonicien à l’égard des mathématiques, mais qu’il tire de cette expérience une conclusion radicalement différente de la mienne. Imaginons donc que l’on établisse une communication avec des extraterrestres, admettons qu’il existe ailleurs dans une galaxie (peut-être la nôtre) une population d’êtres vivants dotés de formes de conscience et d’intelligence et capables d’acquérir les mêmes connaissances objectives que nous sur l’Univers, mais, pour le reste, peut-être très différents de nous dans leur constitution physique et dans leur environnement courant, c’est-à-dire que leur Terre ne soit pas très semblable à la nôtre. Imaginons cependant que nous puissions échanger des suites de signaux binaires, à l’exclusion de toute autre forme de communication, ce qui paraît réaliste pour des raisons physiques. Comment, en effet, concevoir d’autres formes de communication ? Pourrait-on aboutir à autre chose, dans ce type d’échange, qu’à des « pas de danse » ? J’appelle « pas de danse » la répétition d’un signal ou le renvoi d’un signal avec de simples transpositions ou d’autres opérations très simples. Peut-être pourrait-on se faire comprendre que l’on comprend les tables de multiplication élémentaires. Mais je crois que l’on serait incapable d’aller beaucoup plus loin, précisément parce que les suites de 0 et de 1, dépourvues de tout environnement, ne peuvent d’aucune manière véhiculer un sens. C’est fondamental. Et donc j’aboutis à l’idée d’une limitation absolue des possibilités de l’informatique, discipline qui à la fois change considérablement le monde et, à d’autres égards, ne le change pas du tout.
Ma conclusion, c’est que toute connaissance est incarnée. Ce qui n’empêche pas, d’ailleurs, les flashs, les sauts dans l’inconnu, les fulgurances de l’esprit. La pensée, l’esprit ne se réduisent pas à la chair, du moins j’en ai l’intime conviction. Autrement dit, le mystère de la conscience et de l’esprit demeure. L’explosion de l’informatique modifiera nos manières de penser, sinon notre pensée elle-même, à travers ses effets sur l’évolution, qu’ils soient directs ou indirects, mais je ne parviens pas à imaginer qu’elle puisse dissiper le mystère de la conscience, dans l’acception la plus fondamentale et donc la plus indéfinissable de ce terme.
Nous devrons réfléchir davantage, dans les décennies à venir, au fait que, à la cadence à laquelle l’aventure humaine se poursuit, la question de son terme se pose inéluctablement. En raison du développement des sciences et des techniques, à travers les disciplines de l’information et toutes les possibilités qu’elles engendrent, a priori bénéfiques ou maléfiques (on songe à la possibilité d’un hiver nucléaire provoqué volontairement ou non), nous pouvons nous retrouver dans un ou deux siècles peut-être, en nous fondant sur les hypothèses les plus « optimistes » , dans une situation où l’homme aurait pratiquement résolu tous ses problèmes matériels fondamentaux.
Que feraient nos descendants à ce moment-là ? À quoi occuperaient-ils leur temps ? N’est-il pas vrai qu’ils seraient obligés de philosopher ? Votre discipline n’a-t-elle pas un très grand avenir ? À vrai dire, je crois que nos descendants seront obligés d’aller au-delà de la philosophie. Je pense que la philosophie ne pourra pas rester découplée de la spiritualité, comme c’est la tendance depuis le Siècle des lumières et la révolution industrielle et positiviste du XIXe siècle et du XXe siècle. En un sens, la philosophie médiévale n’est-elle pas pleine de promesses pour l’avenir ? Plus les hommes auront le loisir de se poser la question du sens de la trajectoire humaine et du cosmos, plus ils seront en fait obligés de le faire. Certains objecteront avec de bonnes raisons que la nature continuera de mobiliser l’esprit des hommes. Avec ou sans « effets anthropiques », par exemple, les climats peuvent changer en quelques dizaines d’années et engendrer d’immenses problèmes politiques. L’humanité n’en a sûrement pas terminé avec ses préoccupations habituelles et sa capacité à s’entretuer. Mais combien de temps ces jeux-là pourront-ils durer ?