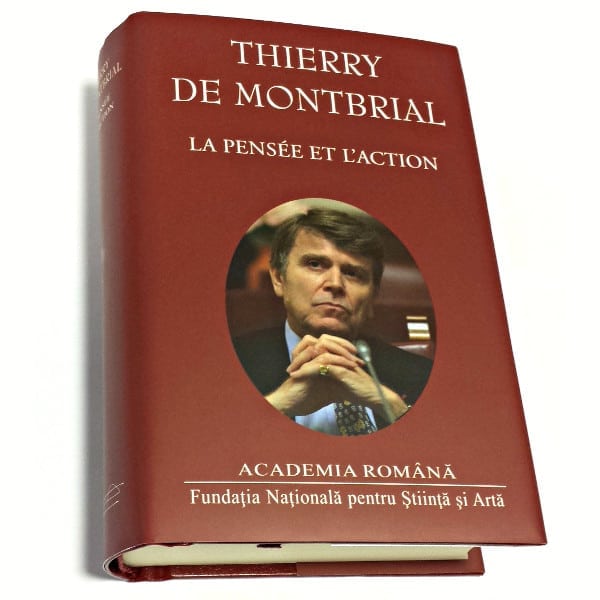Les relations franco-américaines en perspective
Texte publié sous le titre « Franco-American Relations: A Historical-Structural Analysis » dans Cambridge Review of International Affairs, vol. 17, n° 3, octobre 2004
Pour traiter des relations entre deux pays, il faut un cadre analytique, auquel le début du présent chapitre est consacré. Le lecteur pressé d’en arriver au fait pourra sauter ces quelques paragraphes et aborder directement les relations franco-américaines, traitées ici dans une perspective historique. Je conclurai avec quelques brèves réflexions sur la situation consécutive à la guerre de 2003 pour le changement de régime en Irak.
Je limiterai mes remarques méthodologiques préliminaires au cas de deux États, les États constituant la principale catégorie d’unités politiques. Conformément au système conceptuel introduit et développé dans mon ouvrage L’Action et le système du monde, on appellera unité active tout groupe humain structuré par une Culture et une Organisation (je mets des majuscules pour éviter la confusion avec l’emploi courant de ces termes). La Culture réunit les membres du groupe dans un même sentiment d’appartenance et donc, d’abord, de reconnaissance mutuelle. Elle est le principe même de l’identité du groupe. L’Organisation est un sous-groupe qui, selon des règles en principe déterminées, prend les décisions affectant le bien collectif, c’est-à-dire les intérêts intérieurs ou extérieurs du groupe considéré en tant que tel. Une unité politique est une unité active qui se considère souveraine, c’est-à-dire ne reconnaît aucune autorité qui lui soit supérieure. Dans le cas d’un État, l’Organisation est le gouvernement, avec ses trois branches (exécutive, législative et judiciaire) et ses différents niveaux territoriaux. Pour une unité politique, on parle de bien public plutôt que de bien collectif . Les unités actives en général, politiques en particulier, sont plus ou moins fragiles. Une unité forte se caractérise par une Culture forte, donc homogène, et par une Organisation forte. Une unité faible a une Culture faible, donc souvent hétérogène, et une Organisation faible. Les situations réelles sont intermédiaires. Une Organisation faible peut être partiellement compensée par une Culture forte. La réciproque est vraie, mais il est rare qu’une unité politique sous-tendue par une Culture faible survive dans la longue durée, même si le gouvernement est autoritaire ou dictatorial. Ainsi les empires sont-ils voués à périr, le dernier en date étant l’Empire soviétique et, au-dessous de lui, l’Empire russe . Pour terminer de fixer le cadre d’analyse, j’observerai encore qu’avec le temps la Culture et l’Organisation tendent à s’imbriquer partiellement. Ainsi le jacobinisme est-il entré dans la Culture française, et la Constitution de 1787 est-elle, avec la Déclaration d’indépendance de 1776, au cœur de la Culture américaine.
Lorsque l’on parle des rapports entre deux États, il convient de distinguer trois niveaux d’analyse. Le premier, le plus classique, est celui des rapports interétatiques, c’est-à-dire entre les gouvernements qui sont les Organisations porteuses, par définition, des « intérêts nationaux » de leurs citoyens. Le deuxième non traité directement dans le cas franco-américain qui fait l’objet de cet article est phénoménologique : il s’agit de classer et de décrire objectivement les échanges entre ressortissants des États en question, typiquement dans le domaine économique (exportations ou importations, mouvements de capitaux, etc.). Ces échanges sont naturellement canalisés par les engagements des gouvernements. Le troisième niveau est le plus fondamental, mais aussi le plus difficilement repérable : c’est celui de l’interaction des Cultures. Il ne s’agit pas ici des échanges culturels, mesurables en termes économiques comme l’exportation des films d’Hollywood ou les déplacements touristiques, lesquels appartiennent à la catégorie précédente. L’interaction des Cultures, c’est ce qui dans chacune manifeste l’influence de l’autre, c’est tout ce qui caractérise la capacité du citoyen d’un pays à vivre quand il se trouve soudain transplanté dans un autre, et plus largement tout ce qui touche aux images collectives réciproques, lesquelles contribuent à modeler la géopolitique que j’ai définie comme l’idéologie relative aux territoires . La façon peut-être la plus simple de concevoir la Culture d’une unité politique (plus généralement d’une unité active) est de se la représenter comme un album de photos, une série d’images fortement corrélées, série constamment modifiée par des additions et par des retouches . Si la Culture d’une unité politique est forte, un même album est essentiellement commun à tous ses membres. Si l’on prend maintenant un couple d’unités politiques, chacun a de l’autre une « vision » généralement réduite à un « cahier » plus ou moins mince, voire à un seul cliché . Et les deux cahiers n’ont aucune raison de s’harmoniser.
Les trois niveaux ainsi distingués dépendent les uns des autres. Face à un problème particulier, les réactions premières et même secondaires des dirigeants d’un État à l’égard d’un autre sont en partie marquées par l’idée qu’ils s’en font à partir des clichés intégrés à leur bagage intellectuel. Les échanges concrets entre deux pays sont influencés par les images réciproques, hors le cas extrême des produits (commodities) comme le pétrole ou les matières premières qui sont neutres de ce point de vue. Enfin, dans la durée, les images réciproques sont modifiées par la mémoire des actions interétatiques et par les échanges concrets de toute nature, y compris, par exemple, d’ordre littéraire. Ainsi, en France comme aux Etats-Unis, La Démocratie en Amérique de Tocqueville (1835-1840) reste-t-elle un élément non négligeable de l’interaction entre les deux pays.
Je me suis inspiré des considérations précédentes pour brosser un tableau structurel des relations franco-américaines . Je me place, inévitablement, d’un point de vue français. Je ne crois pas en effet qu’en matière anthropologique au sens large l’objectivité absolue soit possible, tout analyste étant tributaire de sa propre culture. La multiculturalité est elle-même une forme d’étrangeté par rapport aux cultures composantes. Je veux dire par là qu’un Franco-Américain même parfait ne serait ni tout à fait français, ni tout à fait américain, et que son point de vue serait donc encore autre.
Pour traiter ce genre de sujet l’approche historique me paraît la meilleure, parce qu’elle seule permet de comprendre comment se forment les clichés, cahiers ou feuillets dont j’ai parlé métaphoriquement. S’agissant de la France et des États-Unis, l’histoire commence avec les deux siècles de l’époque coloniale . Vers 1760, il n’y a pas pires ennemis que les colons des deux pays. La différence, déjà, est que l’Angleterre s’intéresse davantage que la France au nouveau continent qui, en termes d’image, n’a pas toujours bonne presse chez les philosophes et les savants des Lumières, au-delà du cliché du « bon sauvage ». Buffon, Raynal ou Voltaire expliquent que l’Amérique est un continent décevant. Buffon, en particulier, décrète l’infériorité physique de l’Amérique et de ses productions. Il s’appuie sur une sorte de théorie des climats et sur un ensemble d’observations pour conclure à la dégénérescence ou à l’« altération » de toutes les espèces vivantes. Depuis la révolution scientifique, il est hélas souvent arrivé que des savants illustres assènent de monumentales contrevérités du haut de leur savoir et de leur aura. Les thèses de Buffon sont vulgarisées et radicalisées par le Hollandais Cornelius de Pauw dans ses Recherches philosophiques sur les Américains (1770) publiées à Berlin en français. La quatrième partie de l’ouvrage est intitulée : « Du génie abruti des Américains » !
Cependant, le traité de Paris de février 1763 avait marqué la fin du pouvoir politique de la France en Amérique. La Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 ne pouvait qu’être bien reçue par les intellectuels libéraux des Lumières, quoique leur compréhension des événements fût fort approximative, comme c’est souvent le cas, aujourd’hui encore, entre les élites d’unités politiques lointaines je pense par exemple à la figure d’Allende dans la gauche française aux alentours de 1980. Pour autant, une intervention de la France n’allait pas de soi. Ce fut essentiellement l’œuvre du comte de Vergennes et de Benjamin Franklin. Le raisonnement de Vergennes, fondé sur un pur calcul politique, est bien exprimé dès 1775 dans des Réflexions destinées au roi : « L’inimitié invétérée de [la Grande-Bretagne] nous imposant le devoir de ne perdre aucune occasion de l’affaiblir, nous ne pouvons que gagner à saisir celle qui s’offre : il faut donc favoriser l’indépendance des colonies insurgentes. » L’intervention française ne dut rien aux sentiments, non plus que les engagements américains tardifs sur le Vieux Continent en 1917 et en 1942. Ce qui est vrai en revanche, c’est que de tels engagements, parce qu’ils réorientent fondamentalement le cours des événements, engendrent d’immenses émotions collectives, entretenues par la propagande, et deviennent sources d’images réciproques structurantes pour l’avenir. Dans le cas qui nous occupe, l’alliance avec la France de 1778 marqua le tournant de la guerre d’Indépendance. L’habileté de Vergennes décida finalement l’Espagne puis les Pays-Bas à intervenir en faveur de ceux que l’on appelait les Insurgents. L’envoi d’un corps expéditionnaire commandé par Rochambeau aboutit à la victoire de Yorktown, le 19 octobre 1781, après quoi les Britanniques commencèrent à refluer. L’enthousiasme des Américains d’alors n’aura d’égal que celui des Français à la Libération.
Il arrive, parfois, que des individus s’immiscent dans les rouages des États et y jouent des rôles de premier plan. Tel fut le cas du jeune marquis de La Fayette, riche, anglophobe et romantique, qui s’engagea dans l’aventure américaine dès le printemps 1777, contre la volonté de Louis XVI. Pendant les deux guerres mondiales, un Jean Monnet jouera un rôle majeur par le seul effet de sa force de conviction, au point qu’aujourd’hui encore les figures antinomiques de De Gaulle et de Monnet sont souvent mises en parallèle. L’image de La Fayette franchira les siècles. Lorsque, en juin 1917, le général Pershing arrivera à Paris sous les acclamations de la foule, il s’écriera du moins le dit-on : « La Fayette, nous voici ! » Mais il est dans la nature des relations internationales que, si les épanchements peuvent ressurgir occasionnellement, ils se heurtent rapidement, lorsqu’ils se produisent, au choc des réalités. Ainsi l’amitié franco-américaine survécut-elle mal à la paix de 1783. Les premières querelles apparurent avec la question des dettes de guerre, les États-Unis se trouvant alors dans l’incapacité de les honorer. Après les guerres napoléoniennes et encore après la Grande Guerre, ce sera au tour de la France de ne pas pouvoir rembourser l’Amérique. Progressivement, les intérêts commerciaux des deux pays vont s’opposer, chacun violant allègrement le traité de 1778. Cette situation conduira à la fin du XVIIIe siècle à une « guerre non déclarée », que les historiens américains appellent quasi war, undeclared war, ou encore half war. C’est là, note Jean-Baptiste Duroselle, « avec les journées qui suivirent le débarquement en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, la seule occasion dans toute l’histoire où il y a eu du sang versé entre Français et Américains ». Entre-temps, le parti anglais, avec des personnalités comme John Jay et John Adams, avait repris des couleurs, les dérapages de la Révolution française aidant. Dans son Mémoire sur les relations commerciales, Talleyrand observera à la fin de 1794, après la conclusion du traité de commerce et d’amitié entre les États-Unis et l’Angleterre : « Que fit la France [à la fin de l’Ancien Régime] ? Elle craignit que ces mêmes principes d’indépendance qu’elle avait protégés de ses armes chez les Américains ne s’introduisent chez elle ; et à la paix elle discontinuera et découragera toutes relations avec eux. Que fit l’Angleterre ? Elle oublia ses ressentiments, et rouvrit promptement ses anciennes communications. » La suite du texte montre cependant que Talleyrand lui-même n’était pas sûr que l’on aurait pu s’opposer au cours naturel des choses. Toujours est-il que la « guerre non déclarée » se conclut à la fin de l’année 1800, à Mortefontaine, réglant une partie des problèmes, mais consacrant la fin de l’alliance de 1778.
Le tournant du XIXe siècle et ce qu’avec Duroselle on peut appeler les « années Jefferson » sont aussi marqués par l’apparition de « la notion de la “supériorité morale”, de la “mission” de la politique étrangère américaine, et cette espèce de nationalisme inconscient qui fait croire à beaucoup d’Américains, en toute sincérité, que what is good for America is good for the World ». Ce trait de la Culture américaine, qui n’a fait que s’amplifier au fil du temps, est l’un de ceux qui exaspèrent le plus les Français. Pas seulement parce que, depuis la Révolution française postérieure à la Déclaration d’indépendance , les deux pays ont des « convictions remarquablement semblables, à savoir que les valeurs représentées par leur nation sont des valeurs universelles, et le sentiment qu’il n’y a donc aucune différence entre la poursuite de l’intérêt naturel et la quête pour le bien-être de tout le monde ». De ce point de vue, les Français souffriraient d’un sentiment de jalousie aggravé par leur déclin relatif. Mais il y a aussi entre les deux Cultures une différence fondamentale, liée à la religion, que nul peut-être n’a mieux exprimée qu’André Siegfried dans son ouvrage de 1927, Les États-Unis d’aujourd’hui . En voici quelques citations : « Il ne suffit pas de rappeler que l’Amérique est protestante ; elle est, dans sa formation religieuse et sociale, essentiellement calviniste […]. Pour Luther […], le chrétien sera […] serviteur de l’État (qui est mauvais) dans les choses temporelles […], mais il réservera la liberté de son âme : conception mystique religieusement et cynique politiquement, qui fait du fidèle une individualité spirituelle souveraine, mais un humble sujet dans la Cité. Cette conception de la morale politique, la démocratie anglo-saxonne issue de Calvin la tient presque pour un scandale. Calvin […] regarde surtout la doctrine comme un moyen en vue de l’action. […] L’individu […] devient un chargé de mission dans la société, son devoir est de sanctifier la vie sociale, de moraliser l’État. […] L’individualiste de formation latine souffre, aux États-Unis, de sentir constamment sa personnalité pourchassée, brimée. […] La démocratie puritaine comporte des devoirs en même temps que des droits, et c’est une première différence avec nos démocraties latines, individualistes et négatives. [Cette démocratie] est donc une “élite”, […] une aristocratie morale, [pénétrée de] l’esprit missionnaire. […] Cette passion de réformer, de moraliser, d’évangéliser, serait naturellement vraiment un monopole américain s’il n’y avait aussi l’Angleterre. Tout Américain […] est un évangéliste, qui ne peut laisser les gens tranquilles et qui constamment se sent le devoir de prêcher […]. [Les Anglo-Saxons] ont la conscience d’une supériorité morale, […] du devoir envers autrui pour le convertir, le purifier, le rapprocher du niveau moral de l’élite américaine. » Quelques pages plus loin, Siegfried pousse ses feux : « La civilisation américaine évoluerait différemment si la conception luthérienne ou catholique de l’État l’emportait sur celle du calvinisme. La recrudescence de cette dernière est surtout le signe d’une société qui se défend. En se préservant d’influences étrangères croissantes, il s’agit en effet de maintenir des mœurs qui soient conformes à la tradition nationale. S’il y a des dissidents, on entreprend de les convaincre par l’action constante de croisades innombrables et multiformes ; finalement, on leur impose d’autorité les conditions de vie que l’on estime pour eux les meilleures : la minorité aurait tort de se plaindre car, sincèrement, on n’a voulu que son bien. Dans tout ce qui concerne l’organisation de la vie sociale, l’Américain n’est rien moins qu’un collectiviste, intolérant comme les convaincus, et d’autant plus qu’au point de vue religieux c’est un absolutiste. » Et encore : « Il faut toujours [que l’Américain] “sauve” son prochain, c’est sa vocation ; et notamment il considère comme son devoir de donner les mœurs anglo-saxonnes aux étrangers. » Siegfried écrivait ces lignes à l’époque de la prohibition. Depuis, il y a eu le maccarthysme et, à la fin du XXe siècle, avec Ronald Reagan et surtout avec George W. Bush, le retour en force du conservatisme. Pour beaucoup de Français, George W. Bush est un prédicateur fanatique et dangereux qui risque de mettre le monde à feu et à sang.
Mais ne brûlons pas les étapes, et revenons au XIXe siècle. Le seul événement proprement franco-américain de la période napoléonienne fut la vente de la Louisiane, dans des conditions inespérées pour les États-Unis. Bonaparte ne s’intéressait guère au Nouveau Continent, en dehors des Antilles. Sous l’Empire, les rapports furent dominés par la guerre franco-anglaise, la politique de Jefferson consistant à défendre le commerce américain dans un contexte de blocus. La France fort occupée par ailleurs n’eut rien à voir avec la guerre anglo-américaine de 1812-1814, laquelle débarrassa définitivement les États-Unis de toute menace britannique. Pendant le siècle qui suit la chute du Premier Empire, les relations entre les deux États sont secondaires et espacées, n’étant marquées que par trois épisodes.
Au début des années 1820, la France de Louis XVIII ayant mené une opération destinée à rendre au roi d’Espagne le pouvoir qu’il avait perdu à la suite d’une révolte militaire, le président James Monroe craignit qu’une « Sainte Alliance » n’entende rétablir la domination espagnole en Amérique latine. Le Foreign Office proposa au State Department une déclaration commune en faveur de l’indépendance latino-américaine. Mais il apparut rapidement que la France n’avait aucunement l’intention de se lancer dans pareille aventure, et Monroe en vint à exprimer unilatéralement la doctrine à laquelle son nom reste attaché : toute intervention européenne en Amérique latine, toute extension des colonies européennes d’Amérique serait « dangereuse pour notre pays et notre sécurité » ; inversement, les États-Unis affirmaient qu’ils se tiendraient à l’écart des affaires européennes. Le second volet de cette doctrine, en particulier, devait jouer un rôle essentiel jusqu’à la Grande Guerre. Pendant les années qui suivirent, les rapports franco-américains se réduisirent pour l’essentiel à une querelle sur les dettes françaises datant de l’époque napoléonienne, querelle qui dura jusqu’en 1836.
En fait, dans cette première partie du XIXe siècle, l’Amérique paraît bien loin de la France. Alors que les premières lignes régulières entre les États-Unis et la Grande-Bretagne datent de 1840, il faudra attendre 1864 pour la France. Le niveau de l’émigration française est très bas : pas plus de quatre mille deux cents départs par an entre 1820 et 1850. La plupart des émigrés sont des déclassés ou considérés comme tels. D’une manière générale, la faible pénétration démographique et donc culturelle de la France aux États-Unis est l’un des caractères distinctifs des relations entre les deux pays, dont l’importance a souvent été soulignée. En France même, l’image de l’Amérique dans les milieux cultivés n’est pas bonne. Talleyrand la définit : « 32 religions et un seul plat » et écrit à Mme de Staël : « Si je reste un an ici, j’y meurs. » Dans La Chartreuse de Parme, le comte Mosca songe à partir et écarte l’hypothèse : « En Amérique, dans la république, il faut s’ennuyer toute la journée à faire une cour sérieuse aux boutiquiers dans la rue, et devenir aussi bête qu’eux ; et là, pas d’Opéra. » Jusqu’en 1835, les Anglais seront cependant les plus grands pourvoyeurs en Europe de malveillances sur les États-Unis. Dans ses Domestic Manners of the Americans (1831), Fanny Trollope dénonce l’inculture de l’Américain moyen, son mercantilisme inné, la vulgarité de ses manières, la grossièreté de ses divertissements, la laideur générale du pays, notamment des villes, l’inaptitude de cette population au « délassement », la séparation sociale des deux sexes. Dans un texte de 1855, Baudelaire s’inquiète de ce que « le monde va finir », et qu’il va finir américanisé. Car l’Amérique vue par le grand poète, loin d’être la jeunesse du monde, est « la vieillesse de l’homme […] qui correspond à la période dans laquelle nous entrerons prochainement et dont le commencement est marqué par la suprématie de l’Amérique et de l’industrie ».
Naturellement, il y eut aussi dans cette période des contributions plus objectives, comme celles immenses de Gustave de Beaumont, d’Alexis de Tocqueville et de Michel Chevalier, dont l’influence à l’époque fut considérable, et dont la lecture reste éclairante encore de nos jours. Dans l’idée que l’on se fait de la vision française des États-Unis, certaines images sont contradictoires, et le poids qu’on leur accorde varie d’un groupe à l’autre et dans le temps.
Le deuxième épisode qui marque les relations franco-américaines dans la période 1815-1914 est lié à la guerre de Sécession. Cette fois encore, les questions commerciales dominèrent la scène. Le blocus nordiste contre le Sud provoqua la quasi-interruption des exportations du coton et donc une crise majeure de l’industrie cotonnière française à partir de 1862. Or, l’année précédente, Benito Juarez, s’étant emparé du pouvoir, avait décidé de suspendre le paiement des dettes européennes du Mexique. La France, l’Angleterre et l’Espagne s’entendirent pour monter une opération militaire commune. Seule, toutefois, la première décida d’en profiter pour établir au Mexique un empire catholique, entre les mains de l’archiduc Maximilien, frère de l’empereur d’Autriche François-Joseph. Dans quelle mesure Napoléon III spécula-t-il sur la victoire des Confédérés et sur l’incapacité dans laquelle se trouvait l’Union se faire appliquer la doctrine Monroe ? L’empereur envisagea-t-il d’utiliser les circonstances pour que la France reprenne pied sur le continent américain ? La question reste débattue. Toujours est-il qu’avec la résistance organisée par Juarez et la victoire de l’Union, l’aventure aboutit à un fiasco. Après quoi, comme l’écrit Duroselle, « les rapports franco-américains vont à nouveau sombrer dans le néant ». Mais beaucoup de Français ressentiront durement, après la guerre avec la Prusse qui aboutit à la perte de l’Alsace-Lorraine, la sympathie affichée par les émigrés allemands et par le président Grant pour la création du Reich.
Le troisième épisode se rapporte à la guerre hispano-américaine de 1898 et au débarquement américain à Cuba puis aux Philippines. L’opinion publique française, alors majoritairement favorable à l’Espagne, accuse les États-Unis d’impérialisme ; en même temps, l’image sociale de ce pays se dégrade (répression de Haymarket, le 1er mai 1886). En France, c’en est désormais fini de l’Amérique idéalisée, l’« Amérique en sucre » dont Victorien Sardou faisait grief à Tocqueville. En pleine affaire Dreyfus, la France républicaine et anticléricale fait chorus avec celle des gentilhommières pour conspuer les États-Unis et encenser la monarchie espagnole agressée. « Au plus fort des discordes civiles dans une France déchirée, l’antiaméricanisme est la seule passion française qui calme les autres passions, estompe les antagonismes et réconcilie les adversaires les plus acharnés . » Le gouvernement français est embarrassé. La France proclame sa neutralité, mais prend en charge les intérêts espagnols aux États-Unis. Elle joue un rôle appréciable à la Conférence de la paix de Paris. « De tout cela, écrit Duroselle, subsistera une sensible rancœur de part et d’autre. Certains Français parlent du “péril américain ”. » Brook Adams de son côté conseille aux Français de se résigner à leur déclin progressif. « L’avenir appartient, dit-il, aux Anglo-Saxons. » Après la guerre de Sécession, l’Amérique se consacre en effet à son développement économique, comme le fera la Chine au tournant du XXIe siècle. Avant même l’autodestruction de l’Europe avec la Première Guerre mondiale, la montée en puissance de l’Amérique était inscrite dans la réalité.
Dans ce contexte, une forme d’antiaméricanisme s’était développée dès les années 1870. Le mot « antiaméricanisme » lui-même n’apparaîtra qu’en 1948, et se répand en contrepoint de l’« antisoviétisme ». Antiaméricanisme est le seul substantif en « anti » formé dans la langue française sur un nom de pays. À la fin du XIXe siècle, on ne parle pas d’antiaméricanisme, mais l’idée est bien là. Philippe Roger en fait une description minutieuse dans son livre L’Ennemi américain. En 1873, la pièce de Victorien Sardou, L’Oncle Sam une virulente satire des États-Unis connaît un immense succès. En janvier 1875, le rejet de l’amendement Laboulaye proposant un régime présidentiel, à la suite d’une violente tirade de Gambetta, marque la disparition de la référence américaine chez les républicains français. L’ouvrage de Frédéric Gaillardet, L’Aristocratie en Amérique, publié en 1883, est le premier exposé synthétique d’un antiaméricanisme global. Pour Gaillardet, la France seule a fondé une véritable démocratie ; les États-Unis sont une aristocratie travestie. Il dénonce la « tyrannie sociale », dans ce pays où il a vécu dix ans (intrusion dans la vie privée, conformisme, tyrannie du travail, etc.). Plus tard, comme on l’a vu, André Siegfried reprend à sa façon certains de ces thèmes. Dans les années 1880, on réinterprète la guerre de Sécession comme l’acte de naissance d’un impérialisme yankee. On assiste à la mise en place d’un réquisitoire contre l’Amérique au nom des « victimes américaines » de l’américanité (Indiens, Noirs, minoritaires blancs…). Pendant la première moitié du XXe siècle, les esprits les moins soucieux du sort des peuples colonisés européens se passionneront pour les Indiens d’Amérique ou pour les Noirs de l’Alabama !
Au tournant du XXe siècle, pour de nombreux esprits, l’Europe se met soudain à exister comme entité solidairement menacée et comme seule force capable de tenir tête au « péril américain ». L’antiaméricanisme devient inséparable de l’anticapitalisme, comme aujourd’hui de l’antimondialisation. Toutefois, les socialistes européens (pas seulement français) ne comprennent pas (et à vrai dire ne comprendront jamais !) pourquoi, dans le Nouveau Monde, le postulat de la corrélation nécessaire entre le développement capitaliste et l’avènement du socialisme se trouve grossièrement démenti. En 1906, Werner Sombart publie un livre au titre éloquent : Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? (Pourquoi n’y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ?)
Naturellement, bien des auteurs expriment au contraire toute leur admiration envers les États-Unis, et ces témoignages comportent nombre d’observations qui, aujourd’hui encore, conservent tout leur intérêt. Ainsi Edmond Demolins écrit-il dans À quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons ?, un livre à succès publié en 1897 : « Si les Américains, comme les Anglais, tendent à dominer le monde, […] c’est parce que l’Anglo-Saxon, par nature individualiste, entreprend, agit, ose et persévère seul ou en s’alliant momentanément à ses pairs, tandis que le Latin, casanier et moutonnier, aime se sentir encadré et protégé, dût-il perdre toute liberté ; mais c’est aussi parce que, dans la famille et à l’école, l’Anglo-Saxon reçoit une éducation à la fois complète et concrète : plein développement de l’énergie physique, respect de l’indépendance et éveil du sens des responsabilités, enseignement orienté vers les nécessités de la vie contemporaine . »
Cependant, ces questions n’agitent essentiellement que les élites ; sur le plan interétatique, rien de significatif ne marque les relations franco-américaines. C’est évidemment la Grande Guerre qui va tout bouleverser. En 1914, le président Wilson veut d’autant plus maintenir les États-Unis en dehors du conflit qu’il n’est nullement convaincu de la justice de la cause alliée et qu’il a peur de voir son pays éclater dans l’aventure : sur 95 millions d’Américains, 13,5 sont nés à l’étranger ; sur un foreign stock de 26 millions, il y a 6,4 millions d’Allemands et 3,4 millions d’Irlandais antibritanniques . Comme toujours, les intérêts commerciaux joueront un rôle déterminant. Le 22 janvier 1917, l’ambassadeur d’Allemagne annonce à Wilson la « guerre sous-marine à outrance », et les premiers torpillages de bâtiments américains ont lieu en mars. « Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarèrent la guerre à l’Allemagne sans enthousiasme, certes, mais avec leur habituelle bonne conscience et l’idée largement répandue qu’ils avaient une vaste et confuse mission à accomplir, qui consisterait à régénérer l’Europe . » Il n’empêche que, dans l’entrée en guerre des États-Unis, les intérêts, et non les sentiments, ont joué le rôle déterminant comme autrefois dans l’engagement de la France en faveur de l’indépendance américaine. En 1917-1918, les conditions économiques et militaires du concours américain ne seront pas simples. Mois après mois, en particulier, d’âpres négociations seront nécessaires avec le Treasury. La suite est également bien connue. Après la victoire, lorsque le président Wilson arrivera en France pour prendre personnellement la tête de la délégation américaine à la Conférence de Paris, il reçoit un accueil triomphal. Mais en quelques mois sa popularité s’effondrera au point de se transformer « en une indifférence pire que la haine » (Duroselle). À tort ou à raison ce n’est pas le lieu d’en discuter ici , les Français commencent à se représenter les Américains comme les ouvriers de la dernière heure de la guerre, et ils les accusent bientôt d’avoir saboté la paix. Pour certains analystes français, comme Jacques Bainville, le « mauvais traité » fut la cause fondamentale des malheurs ultérieurs du continent européen, et Woodrow Wilson en porte largement la responsabilité. Le refus du Sénat d’approuver à la majorité des deux tiers le traité de Versailles et par conséquent le pacte de la Société des Nations ainsi que le traité de garantie à la France affecte gravement la relation franco-américaine. La droite nationaliste dénonce une Amérique « mégalomane », en proie au « vertige de la puissance » et au « déclin religieux » (Charles Maurras).
Les choses continuent de s’envenimer avec la querelle sur les dettes de guerre, beaucoup plus dure que les précédentes. Avec l’assimilation de ces dettes à des dettes commerciales, avec la manifestation d’une hostilité systématique à la « clause de garantie » établissant un lien entre ce problème et celui des réparations allemandes, les images réciproques ne cesseront de se dégrader. « Ainsi, tandis qu’aux yeux des Français, les Américains apparaissaient comme des vampires, suçant le sang de leurs partenaires épuisés, aux yeux des Américains, les Français étaient des gens malhonnêtes, qui “ne payaient pas d’impôts”, brutalisaient l’Allemagne afin qu’elle s’acquitte des réparations et entretenaient une armée qui faisait de la France la première puissance militariste du monde, à une époque où les États-Unis dont la sécurité était totale ne rêvaient que de désarmement . » André Tardieu, haut-commissaire français aux États-Unis pendant la guerre, réputé américanophile, ce qui ne sera pas bon pour sa carrière (plus tard, sous la Cinquième République, on flétrira les « atlantistes »), dresse un bilan impitoyable mais lucide de nos relations dans un ouvrage qu’il publie en 1927 sous le titre Devant l’obstacle. L’Amérique et nous : « Ces deux pays, unis de sympathie, n’ont jamais collaboré sans connaître d’immédiates ruptures et, en toutes autres circonstances, l’absence seule de contact explique l’absence de troubles. J’ajouterai que les courtes périodes de collaboration politique […] ont obéi non aux lois du sentiment, mais à celles de l’intérêt et que, l’intérêt épuisé, le sentiment n’a pas suffi à maintenir la coopération. » Il y eut, certes, au moins dans les milieux pacifistes, la brève euphorie du pacte Briand-Kellog, qui est le prototype de ces initiatives sonores et creuses auxquelles les hommes politiques avides de popularité se laissent parfois aller, avec la complicité de diplomates soucieux de plaire. En août 1928, lorsqu’il fut signé, on était en plein boom économique, et les conditions psychologiques étaient favorables pour qu’un message aussi puéril qu’une mise hors la loi de la guerre suscitât de l’enthousiasme dans les opinions. Mais un peu plus d’une année après survint le « Jeudi noir », suivi de la plongée dans la Grande Dépression. Dans les années 1930, « les Américains, abattus par la crise la plus grave de leur histoire, irrités contre les Européens immoraux qui ne payaient pas leurs dettes, se replièrent sur eux-mêmes ». Dans ces conditions, on commencera à chercher le salut dans un projet d’unification, paneuropéen et démocratique, qui préfigure l’aventure ultérieure de l’Union européenne. Mais, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui peut encore croire à ces chimères ? Et l’Amérique paraît à des années-lumière du Vieux Continent. Pourtant, il se trouve encore des intellectuels français pour qui, en 1938, l’Amérique incarne l’espérance. Dans ses Regards sur le monde actuel , Paul Valéry écrit ainsi : « Toutes les fois que ma pensée se fait trop noire et que je désespère de l’Europe, je ne retrouve quelque espoir qu’en pensant au Nouveau Continent… »
Le scénario de la Seconde Guerre mondiale ne répète pas exactement celui de la précédente. Pendant les premières années de sa présidence, Franklin D. Roosevelt avait dû consacrer toute son énergie à la politique intérieure, laissant pour la politique extérieure les mains libres à son secrétaire d’État, Cordell Hull. Cependant, dès 1937, il commença à pressentir le danger. Mais il ne pouvait pas aller trop à l’encontre de son opinion publique ; et lorsque, le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne, laquelle avait envahi la Pologne, le Congrès n’était pas disposé à revenir sur la loi de neutralité. Pour que Roosevelt engage pleinement l’Amérique dans la guerre, il fallut attendre que celle-ci devienne mondiale, avec l’attaque de Pearl Harbour et l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne. Entre-temps, l’effondrement de la France avait littéralement bouleversé l’Amérique qui avait pris soudainement conscience d’une menace directe. Du point de vue qui nous intéresse ici, on ne soulignera jamais assez l’ampleur du choc psychologique pour les Américains. En dépit de tous leurs griefs, ceux-ci vouaient une immense admiration à la France des « poilus ». Le changement d’image allait être radical et, d’une certaine manière, définitif. On ne rafistole pas un prestige en lambeaux. Avec l’Occupation, le stéréotype d’une France antisémite, déjà installé depuis l’affaire Dreyfus, prit une ampleur durable. Désormais, le pays de La Fayette et de Rochambeau serait fréquemment présenté comme un peuple immoral, largement antidémocratique, prompt à trahir ses alliés, avec une armée incompétente et lâche et une propension à se courber devant les dictateurs . L’humiliante défaite de la France allait obliger les États-Unis à se demander quel en était le gouvernement légitime. Dans son effort finalement victorieux pour s’imposer, le général de Gaulle allait se heurter à l’incompréhension, d’ailleurs réciproque, de Roosevelt. Cet épisode enrichit le recueil de clichés, de part et d’autre. Côté américain, la figure du chef de la France libre fit beaucoup pour ancrer le schéma des Français vaniteux et cyniques. Côté français, on n’a pas oublié qu’à la Libération Roosevelt souhaitait créer à Paris un Allied Military Government, comme en Italie, ex-puissance de l’Axe, et aujourd’hui encore on continue toujours de soupçonner les Américains de vouloir imposer leurs vues partout sur la planète. Heureusement pour la France de 1944, il y eut Eisenhower pour « défendre » de Gaulle. Parce que l’essence du gaullisme fut de rétablir la grandeur de la France en tentant de réduire psychologiquement la défaite de 1940 à un accident sans conséquences irréversibles, une nouvelle forme d’antiaméricanisme, qui perdure au début du XXIe siècle, allait prendre corps, consistant à dire « non » aux Américains, le plus bruyamment possible, en cas de désaccords, même lorsque la France n’est pas en mesure d’infléchir leurs décisions. De ce point de vue, Charles Cogan a partiellement raison, lorsqu’il observe : « Le négociateur français estime toujours primordial de défendre la position de l’État ; parvenir à un accord avec son homologue peut être opportun mais c’est d’un intérêt secondaire . » Partiellement cependant, parce que tout dépend des situations et de la nature des intérêts en cause. Lorsque ces intérêts sont principalement économiques ou matériels, les Français recherchent des compromis, comme tous les négociateurs. Lorsque les valeurs symboliques à leurs yeux sont significativement impliquées, les dirigeants, en fonction des circonstances et de leur tempérament, peuvent estimer que les avantages d’un non-accord l’emportent sur les coûts. Telle fut souvent la position que le général de Gaulle, et aussi parfois de ses continuateurs, adopta vis-à-vis des Américains.
Au début d’une étude sur les relations entre les Etats-Unis et la France depuis 1940, Charles Cogan commente la fameuse phrase, inspirée de Shakespeare, que de Gaulle avait placée en exergue de son livre de 1932, Le Fil de l’épée : « Être grand, c’est soutenir une grande querelle. » L’analyste américain, textes à l’appui, écrit : « Pour de Gaulle, gouverner semblait impliquer la nécessité d’une joute permanente. La fonction normale de l’Etat français était d’assurer sa défense. Autrement dit, on donnait, parmi les affaires de l’Etat, la primauté à la défense. Le ton de [certains de ses écrits] suggère que de Gaulle voulait entretenir une sorte de zizanie permanente avec les autres États . » Défendre la France, c’était se bagarrer bec et ongles pour le maintien de son « rang » et de son « indépendance ». Le principal privilège du rang, c’est la participation effective aux grandes décisions. L’indépendance, c’est ce qu’en stratégie on appelle la « liberté d’action ». Pour les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, la question du rang et de l’indépendance ne s’est évidemment pas posée. La Grande-Bretagne, dont l’honneur n’avait pas été atteint, décida d’ignorer son déclin et donc la question, en « collant » aux États-Unis. Pour la France, qui avait connu les abîmes, cette question prit une tournure obsessionnelle. Cogan observe finement que la préoccupation du rang tend vers l’inclusion, et celle de l’indépendance vers l’exclusion. Cela est vrai, sauf manifestement pour les États-Unis. Des autres Occidentaux, seule la France, ou du moins la France telle que de Gaulle prétendait l’incarner au nom d’une légitimité acquise en 1940, choisit de transformer ce dilemme en querelle quasi permanente. Pour autant, tous les Français ne se reconnaissent pas ou ne se sont pas reconnus dans cette posture orgueilleuse et ombrageuse. Les personnalités comme Jean Monnet ou Robert Schumann, qui jouèrent un rôle déterminant dans l’immense aventure de la construction européenne à partir des années 1950, incarnent tout autant que le fondateur de la Cinquième République un aspect de la France. Mais on sait depuis longtemps que, contrairement aux Anglo-Saxons, les Français aiment les « hommes providentiels » plus que les institutions, et chacun d’entre eux porte en lui au moins une parcelle de gaullisme. C’est cela, aussi, la Culture de la France.
Au lendemain de la Libération, le prestige de l’Armée Rouge est considérable, et le soft power de l’Union soviétique est à son zénith. Sur le sol français, la présence des soldats américains a provoqué de part et d’autre une nouvelle série de clichés généralement négatifs. La participation du Parti communiste français (PCF) au gouvernement durera jusqu’en mai 1947. Jusque-là, la France s’abstiendra de prendre position dans la querelle qui montait entre les États-Unis et l’URSS. Cette quasi-neutralité convenait bien à la vision de De Gaulle, artisan avec Staline du Traité franco-soviétique de décembre 1944. Lorsque le Général démissionna, le 20 janvier 1946, l’influence du PCF atteignait son apogée. L’année 1947 marque un tournant. Aux États-Unis, le président Harry Truman opte pour le containment, et son secrétaire d’Etat, le général George C. Marshall, lance le plan auquel son nom reste attaché. En France, les institutions de la Quatrième République ne sont pas faites pour les grands hommes. Pendant onze années, les gouvernements se feront et se déferont dans une succession ininterrompue de crises parlementaires. L’époque, dominée par la reconstruction, la décolonisation et la guerre froide, n’est pas propice au gaullisme. Dans l’ensemble, les circonstances économiques et politiques poussent au contraire fortement au rapprochement franco-américain. Ainsi la France adhère-t-elle au plan Marshall puis, en 1949, au Pacte atlantique. La période n’en est pas moins marquée par de nombreuses tensions transatlantiques.
Dans la mobilisation antiaméricaine des années 1950, le noyau dur travaille à la « défense de l’URSS », mais son succès tient au slogan de « défense de la paix ». On diabolise les États-Unis avec leur bombe atomique. L’idée d’une France « colonisée » par les États-Unis prend corps. En 1959, Jean-Marie Domenach, un intellectuel démocrate-chrétien, ira jusqu’à écrire, dans la revue Esprit : « L’Etat américain est libéral, mais la société est totalitaire : c’est peut-être la société la plus totalitaire du monde. » Jacques Maritain dénoncera « le refoulement progressif de l’humain par la matière ». Et la France continuera de reprocher aux États-Unis de n’être pas révolutionnaires. D’une manière générale, les Français vivent mal les interventions incessantes et souvent maladroites de leur puissant allié. La grande affaire de la Communauté européenne de défense (CED), qui dura de l’automne 1950 à la fin de 1954, prit un tour paradoxal, que Charles Cogan résume bien : « La CED, conçue par des (et non par les) Français, pour détourner la pression exercée par les Américains pour le réarmement allemand à la suite de l’alerte mondiale que fut l’invasion de la Corée du Sud, fut finalement rejetée par les Français eux-mêmes… qui firent presque tout de suite volte-face et acceptèrent essentiellement ce que les Américains préféraient au début : c’est-à-dire une armée allemande faisant partie d’un État souverain ouest-allemand au sein de l’OTAN . » Ce qui n’empêcha pas d’énormes balourdises américaines, comme la déclaration du secrétaire d’État américain Foster Dulles le 14 décembre 1953, sommant la France de ratifier la CED, seul moyen à ses yeux d’empêcher pour toujours la guerre entre la France et l’Allemagne, faute de quoi il y aurait une « révision déchirante » (agonizing reappraisal) de la politique américaine, sans que bien évidemment il spécifie le contenu exact de cette révision . La susceptibilité des Français serait aussi mise à l’épreuve avec le développement des « relations spéciales » entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, particulièrement dans le domaine des armes nucléaires, point de départ de la volonté française de constituer sa propre « force de frappe ».
Mais ce sont surtout les amertumes de la décolonisation et finalement la guerre d’Algérie qui, sous la Quatrième République, vont empoisonner les relations franco-américaines. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Français pensaient, comme le général de Gaulle, que leur pays redeviendrait une grande puissance grâce à l’empire colonial. L’engagement de plus en plus marqué des États-Unis contre la colonisation surtout à partir de la conférence de Bandung de 1955 déchaîna la droite colonialiste qui soupçonna la puissance hégémonique du bloc occidental de vouloir éliminer la France pour prendre sa place. Quelque deux ans après la chute de Dien Bien Phu et le refus de Dwight D. Eisenhower d’intervenir, la crise de Suez de 1956 contribua fortement à nourrir l’antiaméricanisme dans une partie de l’opinion publique. Le socialiste Guy Mollet était alors président du Conseil. L’Égypte était la principale base arrière des « rebelles » algériens. Pour Guy Mollet, Nasser était comparable à Hitler, et lui céder équivaudrait à un nouveau Munich. Au cours des cinquante dernières années, que de fois cette référence aura-t-elle été utilisée à tort et à travers ! Toujours est-il qu’en acculant Français et Anglais à la défaite, les Américains provoquent un ressentiment profond chez les premiers. Aujourd’hui encore, près d’un demi-siècle après les faits, les traces en sont sensibles. Les Anglais quant à eux réagiront différemment, en décidant calmement de se retirer définitivement de l’est de Suez et de renforcer encore davantage leurs « relations spéciales » avec le grand frère.
Le drame algérien eut d’autres conséquences. C’est lui qui provoqua la chute de la Quatrième République et le retour au pouvoir du général de Gaulle. Au début de son règne, tout semble aller bien du point de vue des rapports franco-américains. Nécessité faisant loi, de Gaulle se convertit à la décolonisation, ne remet pas en question l’Europe communautaire qu’il avait combattue dans sa traversée du désert et proclame la nécessité de l’Allemagne atlantique. Sa visite aux États-Unis en avril 1960 est triomphale. Ses réactions, lors de la crise du mur de Berlin (1961) et celle des missiles de Cuba (1962) sont exemplaires. Pourtant, dès la fin de 1958, il se heurte au refus d’Eisenhower d’entrer dans la logique du directoire à trois (États-Unis, Royaume-Uni, France donc sans l’Allemagne) au sein de l’Alliance. Puisque l’Amérique empêche la France d’accéder au « rang » auquel elle estime avoir droit, le président français opère un grand virage, une fois la guerre d’Algérie terminée. De Gaulle ruine le grand dessein de John Fitzgerald Kennedy, influencé par Jean Monnet, d’un nouveau partenariat atlantique, qui aurait consacré la vision anglo-américaine du monde occidental. Il s’éloigne d’Israël (la rupture est consommée après la guerre des Six Jours) et s’affiche désormais comme une sorte de héraut de la « vérité » et de leader spirituel du Tiers Monde, plaçant la France dans une position proche de celles des pays « non alignés » après le retrait du commandement militaire intégré de l’OTAN en 1966. Il engage son pays dans une politique d’« entente, détente et coopération » avec l’Union soviétique. Il accélère la constitution d’une « force de frappe » nucléaire indépendante et donc « tous azimuts ». Il s’opposera par deux fois à l’entrée dans la Communauté économique européenne (CEE) de la Grande-Bretagne, considérée comme un « satellite » des États-Unis. Il dénonce le système du Gold Exchange Standard (étalon de change-or) et ordonne le rapatriement sur le territoire national des stocks d’or détenus à Fort Knox appartenant à la France. Certains de ses gestes blessent particulièrement la sensibilité américaine, comme son refus de participer personnellement aux cérémonies du vingtième anniversaire du débarquement en Normandie. Le discours de Pnom Penh du 1er septembre 1966 condamnant la politique des États-Unis au Vietnam à la suite de la défaite française discours à certains égards prémonitoire suscite une vague d’indignation aux États-Unis et d’enthousiasme dans la majorité du Tiers Monde. Le 24 juillet 1967, du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, il prononce son fameux : « Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français ! Vive la France ! » Mais la crise de mai 1968 sape les bases du pouvoir qui lui avait permis de jouer aussi farouchement et systématiquement la politique du « rang » et de l’« indépendance ». Au cours des derniers mois de sa présidence, il s’abstient de toute manifestation antiaméricaine. Duroselle relève que l’élection de Richard Nixon lui fut agréable. « Et la période se clôt par un geste qui, tout silencieux et en quelque sorte passif qu’il ait été, n’en a pas moins une signification profonde. Exactement vingt-quatre jours avant ce référendum du 27 avril qui allait l’emporter, le 4 avril 1969, le général de Gaulle, par tacite reconduction, maintient la France dans l’Alliance atlantique, mettant ainsi fin à toutes les hypothèses angoissées des Américains qui avaient cru voir dans une attitude résolument hostile les signes précurseurs d’un grand renversement des alliances . »
La politique étrangère du général de Gaulle choqua la petite proportion des élites françaises, européennes et atlantistes, dont Jean Monnet reste le symbole ; mais, dans l’ensemble, il flatta une opinion publique sensible à l’hymne à la grandeur et au discours universaliste de la France. Comme la période fut également marquée par un vigoureux unisson économique et par la poursuite du redressement, cette politique n’eut pas d’inconvénients immédiatement perceptibles dans le domaine du bien-être matériel. À des degrés divers, compte tenu de l’évolution du monde, cette politique devait inspirer durablement l’action de tous les présidents ultérieurs, à commencer par celle de Georges Pompidou. Celui-ci lâcha sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté européenne, ouvrant la voie à d’autres élargissements. Mais, avec son ministre des Affaires étrangères Michel Jobert, il se braqua contre le projet d’Henry Kissinger sur l’« année de l’Europe ». Dans un livre publié en 1965 , le secrétaire d’État de Richard Nixon avait bien prévu qu’un jour viendrait où l’identité de l’Europe ne pourrait plus se forger par la crainte de l’URSS, qu’une Europe unie en viendrait probablement à vouloir exprimer une opinion spécifiquement européenne sur les affaires du monde, que donc elle lancerait un jour un défi contre l’hégémonie américaine en politique atlantique. Il notait que ce serait le prix à payer pour une unité en l’occurrence souhaitable, mais aussi que les États-Unis avaient toujours refusé d’admettre qu’il y aurait un prix à payer. En reprenant à sa manière, en avril 1973, le projet de Kennedy, Kissinger ne semble pourtant pas avoir imaginé qu’un Michel Jobert lui barrerait la route. Celui-ci résume ainsi son point de vue dans ses Mémoires d’avenir : « Nous n’avions pas, pendant des années, justifié notre politique par le refus des blocs pour accepter aujourd’hui un processus consacrant l’hégémonie américaine sur le monde occidental, auquel le projet de Kissinger associait le Japon, par amalgame. » Toujours le « rang » et l’« indépendance ». Au tournant de l’année 1974, après la guerre du Kippour et le premier choc pétrolier, Michel Jobert tenta de s’opposer à l’approche atlantiste des États-Unis de la question énergétique, mais il se heurta cette fois, selon ses propres termes, à la « trahison » de ses partisans européens. Ainsi l’Agence internationale de l’énergie (AIE) fut-elle créée sans la France (elle y adhéra en 1992). Pompidou mourut le 2 avril 1974. La famille politique de Valéry Giscard d’Estaing, qui lui succéda, était proche de Jean Monnet, et les premiers gestes du nouveau président furent apaisants. La France signa la « déclaration d’Ottawa » du 19 juin 1974, le point final de l’année de l’Europe. Cette déclaration, qui légitime les forces nucléaires française et britannique, affirme la nécessité de la présence militaire américaine en Europe. On peut souscrire au jugement suivant de Charles Cogan : « L’année de l’Europe a […] répondu, en quelque sorte, à l’ancienne requête française de création d’un directoire des principaux pays occidentaux, en augmentant le rôle de la Quad [réunion quadripartite des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la RFA]. Cette consultation a été renforcée par d’autres instances créées pendant les années 1970, avec en tête l’initiative de V. Giscard d’Estaing, peu après le début de son mandat, en faveur de la convocation d’un sommet annuel des pays industrialisés […]. À cause de la mort inattendue et prématurée de Georges Pompidou et du départ de Michel Jobert de la scène politique, l’année de l’Europe a marqué la fin du gaullisme traditionnel en France . » La décision de Giscard d’Estaing, en 1976, de se rapprocher des vues américaines sur la prolifération des armes nucléaires, donna également satisfaction à Washington.
Tout cela ne signifie cependant pas la disparition des tensions franco-américaines. Elles se manifestèrent fortement, pendant le septennat de Giscard d’Estaing, sur la question du Moyen-Orient en général et israélo-palestinienne en particulier. La France fut le principal artisan de la déclaration du Conseil européen de Venise en 1978 . À la fin des années 1970 également, Paris se distingua de Washington dans les affaires Est-Ouest, notamment en refusant de s’associer aux sanctions économiques et au boycott des Jeux olympiques de 1980, à la suite de l’invasion de l’Afghanistan. Le président Giscard d’Estaing poursuivit également une politique gaullienne de tiers-mondisme (autour du thème du nouvel ordre économique international [NOEI]), qui n’eut guère de grandes conséquences politiques. Mais les querelles ne prirent jamais un tour acrimonieux. Finalement, le cœur de la politique étrangère de Giscard d’Estaing fut la reprise d’une construction européenne plus proche de l’esprit des pères fondateurs, et donc plus authentique que celle du général de Gaulle, ce qui ne veut pas dire moins inquiétante du point de vue américain, comme le montre l’épisode de la mise en place du système monétaire européen (SME).
La période de vingt années qui s’étend de l’élection de François Mitterrand à celle de George W. Bush fut dominée à l’échelle mondiale par les prémisses puis les conséquences de l’écroulement de l’Union soviétique et par la « mondialisation ». Du point de vue des relations franco-américaines, elle ressemble à l’époque de Giscard, Ford et Carter, avec beaucoup de différends mais peu d’acrimonie. Côté français, Mitterrand imprima son propre style à une politique du « rang » et de l’« indépendance » sans concession sur le fond mais contenue dans la forme, et aucun des trois derniers présidents américains du XXe siècle, Ronald Reagan, George H.W. Bush et Bill Clinton, n’eut à s’affronter avec son homologue français. On prit grand soin d’éviter le genre de psychodrames des années de Gaulle et Pompidou. En deux occasions particulièrement sensibles, Mitterrand prit un parti américain : la crise des euromissiles et la première guerre du Golfe. Dans son discours au Bundestag, le 20 janvier 1983, il plaida en faveur du déploiement des missiles de l’OTAN devant une Allemagne tentée par le pacifisme. Ce choix, des plus risqués, fut vivement critiqué par les gaullistes. En 1991, les forces françaises intervinrent aux côtés des troupes américaines pour libérer le Koweït, mais dans le cadre d’une résolution de l’Organisation des Nations unies. En dehors de ces deux épisodes dramatiques, la posture mitterrandienne (et plus tard celle de Jacques Chirac) resta gaullienne dans les affaires de sécurité. En matière de dissuasion par exemple, il ne se départit jamais du purisme le plus absolu. En ce qui concerne le Proche-Orient, Mitterrand voulut d’abord redresser la position française en faveur d’Israël, mais en resta par la suite à un point d’équilibre finalement peu différent de celui de ses prédécesseurs, ce qui malgré ses efforts contribua à renforcer aux États-Unis l’image d’une France antisémite. François Mitterrand, comme après lui Jacques Chirac, désapprouva la politique américaine du double endiguement vis-à-vis de l’Irak et de l’Iran, tout en évitant la confrontation malgré la campagne américaine contre une France accusée de vouloir protéger les « États voyous » (rogue States). Après la chute du mur de Berlin, puis au début de la guerre de sécession yougoslave, les divergences furent parfois sévères, mais elles ne dégénérèrent jamais. Vis-à-vis du Tiers Monde, le discours se fit plus idéologique, mais après quelques velléités initiales Mitterrand se garda bien d’aller chatouiller les États-Unis sur leur continent.
En fait, l’histoire retiendra surtout, dans l’œuvre extérieure du quatrième président de la Cinquième République, son engagement résolu en faveur de la construction européenne, dans le sillage de Giscard d’Estaing, qui aboutit notamment, cinq ans après son départ, à la création de l’euro. Par là, on en revient au point essentiel des relations franco-américaines contemporaines. En effet, surtout après la chute de l’URSS, la question du sens de ce que depuis le traité de Maastricht de 1992 on appelle l’Union européenne est devenue incontournable, et inséparable de celle qui intéresse les États-Unis au premier chef, c’est-à-dire l’avenir de l’OTAN. Or l’Europe de Mitterrand puis de Chirac reste gaullienne, c’est-à-dire « européenne ». Du point de vue français, cela veut dire que l’Europe doit devenir un sujet « autonome » des relations internationales. La plupart des oreilles américaines entendent : « antiaméricain ». On pourrait multiplier les témoignages à cet égard. Il suffira de citer quelques lignes d’un livre de Jacquelyn Davis : « Le sentiment est de plus en plus répandu en Amérique […] que les désaccords entre la France et Washington ne portent pas sur les principes fondamentaux mais sont alimentés par une intention malveillante du côté français, avec en premier lieu, l’objectif de la destruction de l’OTAN le bras armé de l’Alliance atlantique dont elle s’est retirée en 1966 . » Le malentendu n’est évidemment pas nouveau. Il se trouvait déjà au cœur de la querelle de l’année de l’Europe. Dans les années 1990, sous Mitterrand puis sous Chirac, elle n’a fait que s’amplifier. En 1992, le sommet franco-allemand de La Rochelle lançait le Corps européen, qui allait devenir l’Eurocorps. La même année, ce qui était encore l’Union de l’Europe occidentale (UEO) définissait les conditions de son engagement militaire (les tâches de Petersberg). En 1998, à Saint-Malo, un accord franco-britannique ouvrit la voie à une formule permettant de concilier l’autonomie européenne en matière de défense et le maintien de l’Alliance atlantique. Mais le diable se cache dans les détails et les controverses sont loin d’être closes. D’autant que, au tournant du troisième millénaire, la France a toujours tendance à exprimer tout haut ce que bien d’autres dans le monde pensent tout bas. Ainsi Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de la longue « cohabitation » du premier septennat de Jacques Chirac, a-t-il provoqué une polémique durable en qualifiant les États-Unis d’« hyperpuissance » et en s’interrogeant sur la recherche d’un ordre international (le « monde multipolaire ») qui ne se réduise pas à une hégémonie américaine. Les Américains y virent une nouvelle provocation, d’autant plus qu’en anglais le préfixe hyper a une connotation péjorative qu’il n’a pas en français. À la fin du second mandat de Bill Clinton, les grandes affaires stratégiques revinrent sur le devant de la scène avec le débat sur le bouclier antimissile (National Missile Defense, NMD) et nourrirent de nouvelles querelles. Les choix et le style abrupt de George W. Bush, la violence de l’idéologie néoconservatrice firent beaucoup pour amplifier l’image d’un État arrogant et hégémonique.
Après la réélection de Jacques Chirac en avril 2002, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, voulut rapprocher les deux pays. Entre-temps, il y avait eu le 11 septembre 2001. Mais, peu enclin à écouter quoi que ce soit, même les Anglais malgré une « relation spéciale » au contenu à vrai dire de plus en plus ténu, le quarante-troisième président des États-Unis se lança dans l’aventure irakienne. Il est hautement vraisemblable qu’aucun président français n’aurait pris le risque de se mettre en porte-à-faux avec son opinion publique en le suivant, comme le firent José Maria Aznar en Espagne et Silvio Berlusconi en Italie. Mais il est peu vraisemblable qu’un autre eût choisi cette circonstance pour provoquer un duel, en renouant avec une diplomatie du « non » inemployée depuis trois décennies. Jacques Chirac et Dominique de Villepin y gagnèrent une grande popularité en France et dans une certaine mesure dans une partie du monde. La suite des événements a montré que l’administration Bush avait multiplié les erreurs d’appréciation. Il n’empêche qu’en termes d’image l’épisode irakien a sérieusement relancé la francophobie aux États-Unis, avec son cortège de clichés et de grossièretés, et cela même chez les critiques du président Bush. Dans cette affaire, l’image de la France a été instrumentalisée par l’administration américaine : elle a servi de bouc émissaire, de victime expiatoire (et exemplaire) pour les hésitations de la communauté transatlantique, de « tête de Turc », et de faire-valoir. Pour illustrer ce dernier point, Justin Vaïsse explique comment Washington a utilisé les « paroles insultantes du président Chirac contre les pays d’Europe de l’Est » en permettant « par contraste, de rehausser l’image des États-Unis comme protecteur des petites nations, de l’indépendance de chacun, de la libre volonté » .
Un an après la chute de Saddam Hussein, cependant, les passions s’étaient un peu calmées, au sein des gouvernements comme chez les leaders d’opinion. Selon les instituts de sondage, l’image de la France commençait à se redresser un peu aux yeux des Américains. Depuis l’affrontement de l’hiver 2002-2003, le gouvernement français a pris grand soin de ne plus ajouter d’huile sur le feu, et les responsables américains ont commencé à comprendre que dans l’avenir prévisible les États-Unis auront toujours besoin de l’Europe et donc de la France. Les deux parties ont intérêt à se ménager . Les Européens, en ce qui concerne le processus de leur unification, semblent avoir tiré des conclusions plus positives que négatives de la crise, comme si chacun réalisait désormais qu’une Europe trop atlantique ne serait pas viable, mais qu’une Europe insuffisamment atlantique ne deviendrait jamais « européenne ». Le rapprochement triangulaire entre la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, pourrait ouvrir la perspective d’une entente franco-américaine plus continue, moins passionnelle, plus cordiale, et finalement conforme à l’attirance mutuelle réelle qui, envers et contre tout, réunit les deux peuples beaucoup plus que certaines de leurs élites.