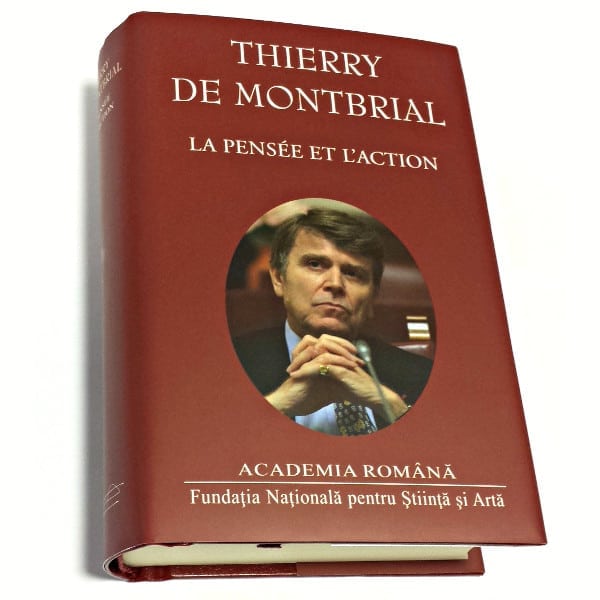Réforme, déclin, révolution
Texte introductif révisé du live Réformes-révolutions. Le cas de la France, Paris, PUF sous la direction de Thierry de Montbrial, Académie des sciences morales et politiques, 2003 (actes du colloque « Réformes-révolutions », organisé par la Fondation Singer-Polignac le 30 octobre 2002)
À l’origine de ce chapitre, il y a une fascination personnelle que j’éprouve depuis mon enfance, à l’époque où, sous l’influence de mon père, je lisais des livres d’histoire, parfois des auteurs célèbres comme Jacques Bainville ou Jules Michelet. Je ne comprenais pas toujours les fondements de leurs assertions. Je jugeais – c’était peut-être le futur mathématicien qui perçait – qu’il y avait dans leurs écrits beaucoup d’affirmations non justifiées. Autrement dit, je ne voyais pas clairement les théories sous-jacentes, dont je pressentais pourtant qu’elles existaient. Je suis en effet convaincu que, dans les discours des sciences humaines ou sociales, y compris chez les historiens, il y a toujours des théories implicites . Chez les bons auteurs, ceux qui sont cohérents, il n’y a jamais de faits sans un substrat non seulement idéologique mais également théorique, et donc conceptuel. Simplement, le plus souvent, ce substrat n’est pas explicité, et il ne l’est pas toujours non plus pour les auteurs eux-mêmes. Cela se fait souvent à leur insu. Par exemple, quand mes professeurs parlaient des causes de la Révolution française, je me demandais : « Oui, mais qu’est-ce que les réformateurs les Maupeou, les Turgot, les Necker ont réellement essayé de faire et pourquoi ? Auraient-ils pu réussir et, si oui, pourquoi ont-ils échoué ? S’ils avaient réussi, aurait-on pu éviter la Révolution ? » Et, depuis une trentaine d’années que je m’occupe principalement de questions internationales au sens le plus large du terme, je n’ai cessé de me trouver face à des interrogations similaires. Pourquoi le shah d’Iran est-il tombé ? Pourquoi l’URSS s’est-elle effondrée ? Et pourquoi à ce moment-là plutôt qu’à un autre ? Etc. Pour aborder de tels sujets, il faut une méthode fiable.
Fondamentalement, le thème de la réforme se confond avec celui de l’adaptation. Je vais utiliser ici quelques concepts que j’ai explicités dans L’Action et le système du monde et dont l’atome, en quelque sorte, est l’unité active. J’appelle unité active tout groupe humain structuré par deux facteurs : l’un, c’est une Culture (au sens ethnologique du terme) qui lui donne le principe de son unité ; l’autre, c’est une Organisation qui fait que cette unité est capable de prendre des décisions la concernant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Lorsqu’une unité active n’en reconnaît aucune autre qui lui soit supérieure, autrement dit lorsqu’elle se considère comme souveraine, on peut parler d’unité politique. Et l’unité politique type, évidemment, c’est l’État. Dans ce cas, l’Organisation, c’est le gouvernement, que l’on appelle communément l’État. Le mot « État » est ambigu, puisqu’il désigne tantôt le gouvernement avec ses trois branches exécutive, législative et judiciaire , tantôt l’unité elle-même. En droit international, l’État désigne le triplet constitué par un territoire, une population et un gouvernement ; il s’agit alors effectivement de l’unité politique elle-même. Mais la notion d’unité politique va plus loin, puisque par exemple Al-Qaïda, dans ma terminologie, est une unité active qui se considère en effet comme souveraine. On doit par conséquent considérer cette organisation criminelle comme une unité politique. Toute unité active se pose le problème de son être. Et le fondement de sa politique incarnée par son Organisation, c’est, comme aurait dit Spinoza, de persévérer dans son être. L’unité politique doit s’adapter en permanence puisqu’il y a toujours un intérieur et un extérieur en mouvement, qu’il y a toujours un environnement changeant, qu’il y a toujours des unités actives coopératives ou antagonistes qui surgissent ou disparaissent. Par conséquent, une unité active, en particulier une unité politique comme un État, ne peut survivre qu’en s’adaptant constamment. Le problème de la réforme, c’est fondamentalement le problème de l’adaptation. Mais c’est le problème de l’adaptation formulé dans le langage de l’action, c’est-à-dire à travers l’Organisation qui incarne, du point de vue de l’action, l’être ou l’identité de l’unité active ou politique en question. L’adaptation est d’autant plus nécessaire que l’Organisation est ancienne et qu’elle doit braver des évolutions séculaires.
L’un des exemples les plus significatifs et les plus réussis est celui de l’Église catholique. Si la « Réforme » sert à caractériser le protestantisme à partir du XVIe siècle, il faut rappeler que l’Église de Rome n’a cessé depuis sa fondation de se réformer. Sans cela, elle n’eût tout simplement pas survécu. Ces ajustements continus expliquent que certains préfèrent le terme de « réformation » à celui de « réforme » pour qualifier le mouvement protestant. En 1500, la nécessité d’une réformation fait l’objet d’un consensus dans toute la chrétienté latine, et Luther lui-même, lorsqu’il afficha ses quatre-vingt-quinze thèses à Wittenberg, n’avait pas d’autre objectif que d’éliminer les « abus » principalement la pratique des indulgences qui avaient « déformé » l’Église . La Réforme a manifesté au début la volonté de corriger les déformations intervenues dans les pratiques ecclésiales ; elle n’avait aucunement pour fin d’instituer une Église rivale.
Dans les années 1550, le théologien Georgius Cassander résume le divorce consommé entre Luther et Érasme pour condamner les positions du premier, en distinguant « réformation » et « transformation » : « Nous appelons maintenant transformation quand on efface tout à fait une forme visible pour en introduire une autre toute nouvelle. Nous appelons réformation quand on touche à réparer et établir la forme première . » En langage moderne, la transformation équivaut bien, pour les adversaires du protestantisme, à une révolution. Ce détour par l’histoire du vocable de « réforme » permet d’en souligner le sens premier de « retour aux origines », et non pas la signification plus tardive d’accompagnement des évolutions ou, plus exactement, de « modernisation » avec tout ce que le monde postérieur aux Lumières y attache de connotation positive.
Les problèmes d’adaptation se posent pour toutes j’insiste là-dessus , pour toutes les unités actives quelles qu’elles soient, y compris dans le monde actuel des unités comme Al-Qaïda. Il n’y a pas de considérations morales à ce niveau d’analyse. Les unités actives de toute nature, en raison de la mondialisation, affrontent aujourd’hui une compétition et une concurrence exacerbées. En biologie, lorsque dans un milieu apparaît une augmentation d’espèces antagonistes, il y a accroissement de compétition, qui se résout par la sélection naturelle. Dans le cas des unités actives construites sur des groupes humains, la sélection n’est pas naturelle dans le même sens, parce qu’il y a des politiques conscientes, des stratégies. Mais le problème se pose néanmoins fondamentalement de la même façon. Et l’accroissement de la compétition et de la concurrence rend plus complexe le problème de l’adaptation, et donc de la réforme. Le besoin de réforme se manifeste en conséquence du changement extérieur, mais aussi intérieur.
On peut d’emblée distinguer deux grandes catégories de réformes, que j’appellerai « conservatrices » et « progressistes ». Il ne faut pas voir derrière cette terminologie un référentiel moral implicite.
Les réformes « conservatrices » sont celles qui visent explicitement ou implicitement à éviter la dégradation : dégradation en raison de l’affaiblissement interne naturel des choses on pourrait dire, en employant une métaphore physique en l’occurrence justifiée, l’affaiblissement entropique, l’accroissement spontané du désordre ; mais aussi, comme je viens de le dire, la dégradation qui résulte de la concurrence, et plus généralement de l’environnement extérieur. Si vous voulez une métaphore non plus historique ou biologique, mais économique, un concept approprié serait celui d’amortissement. Dans le concept économique d’amortissement, il y a deux idées. Première idée, la dépréciation physique : par exemple les machines ou les équipements se dégradent au sens le plus matériel du terme. Deuxième idée, beaucoup plus importante dans un monde en évolution rapide, la dépréciation proprement économique : la machine la plus parfaite, la mieux entretenue, se dégrade économiquement, tout simplement parce que les progrès technologiques font apparaître des équipements plus performants, des hommes éduqués de façon différente et dotés de compétences autres, en sorte que l’équipement initial, même s’il est magnifique, voit sa valeur économique diminuer jusqu’à devenir éventuellement négative. La notion d’amortissement est complexe, et on la retrouve bien dans la question que je pose sous la forme de la conservation des unités actives.
Pour pousser un peu plus loin, on dira typiquement pour un État que la réforme, dans son aspect conservateur, vise à éviter le déclin, c’est-à-dire précisément l’affaiblissement de la capacité d’agir de l’unité active qu’il constitue, ce que j’appelle son « potentiel » dans L’Action et le système du monde. Certains historiens n’aiment pas le concept de déclin qui revêt pourtant à mes yeux une signification opérationnelle comme d’ailleurs celui de renaissance. Je crois qu’une bonne parie des réformes dont on parle actuellement à propos de la France (les retraites, la décentralisation, la « réforme de l’État », etc.) se rattachent à cette notion. En 2001, ayant eu l’honneur de présider l’Académie des sciences morales et politiques, j’avais justement proposé pour thème de réflexion à cette compagnie le problème des réformes dont la France a besoin pour ne pas décliner, notamment pour éviter le recul continu de sa compétitivité. Il s’agit donc ici de réforme défensive, en quelque sorte, si l’on veut une métaphore cette fois-ci stratégique.
La deuxième catégorie de réformes, celles que j’appelle « progressistes », est davantage liée aux aspects idéologiques de l’identité. Si vous avez eu la patience de me suivre jusqu’ici, vous vous souvenez que, dans ma définition de l’unité active, il y a d’abord une Culture, puis une Organisation. Or les concepts de culture et d’idéologie sont proches. Plus généralement, les trois concepts culture, civilisation, idéologie se chevauchent. Si l’on embrasse d’un seul coup d’œil l’histoire de France depuis la Révolution de 1789, où la charge idéologique est particulièrement lourde, un grand nombre de réformes ou de projets de changements structurés, envisagés ou réalisés par les gouvernements successifs, ont été inspirés par l’idée de progrès, sous l’influence plus ou moins forte de la société elle-même, plus précisément en fonction de l’effectivité et de l’efficacité d’unités actives issues de ladite société.
Mais la notion même de progrès a une dimension historique essentielle qui renvoie à la Culture de l’unité active, autrement dit à son outillage mental. À cet égard, le XVIIIe siècle se caractérise par une véritable révolution silencieuse que Saint-Just formule joliment : « Le bonheur est une idée neuve en Europe . » La masse des traités en tout genre consacrés au bonheur et publiés au XVIIIe siècle atteste cette nouvelle croyance. Elle rompt avec des siècles de malheurs subis et acceptés au nom de la soumission de la condition humaine à la volonté divine, modèle de perfection. Au XVIIe siècle encore, la gloire et la sainteté sont les seules aspirations légitimes ; le reste n’est qu’illusoire divertissement. Il ne nous appartient pas ici de nous attarder sur les causes de l’émergence des idées de progrès et de bonheur. Notons simplement que la diffusion des connaissances et des techniques, les progrès de l’agriculture comme ceux de la médecine ont amené les hommes du XVIIIe siècle à considérer que le bonheur était possible, « ici et maintenant », et qu’il était étroitement lié à la mise en œuvre d’améliorations du sort des êtres humains. L’âge d’or n’était plus dans un hypothétique éden ni dans un passé révolu, mais dans un avenir auquel chaque individu pouvait prétendre. En ce sens, pour qu’un système soit susceptible d’être réformé, il faut que la notion même de réforme ait une valeur positive, active. L’échec de Louis XVI face au mouvement révolutionnaire tient pour une grande part à son incapacité à s’affranchir des conceptions traditionnelles caractérisées par leur hostilité à toute innovation.
Éminemment moderne, le concept de progrès n’a cessé depuis le XVIIIe siècle de conditionner la vision du bonheur social et d’inspirer les projets politiques. La Réforme, titre d’un journal publié par Ledru-Rollin sous la monarchie de Juillet, est le leitmotiv des républicains au XIXe siècle, qui veulent impulser le changement sans réveiller les peurs inspirées par la Révolution et ses désordres passés. Il s’incarne dans le programme radical que défend Jules Gambetta en 1869 à Belleville. Un an avant la chute de l’Empire, il reflète les ambitions progressistes de l’extrême gauche en France : liberté politique, séparation des Églises et de l’État, instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, élection des fonctionnaires publics et suppression des armées permanentes. Plus récemment, l’abaissement de la majorité électorale, l’abolition de la peine de mort, des réformes de mœurs, comme l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la question du Pacte civil de solidarité (Pacs), le mariage homosexuel, assurent la continuité de cette conception messianique de la politique. Les promoteurs de ces réformes, qui se rattachent manifestement à des genres très différents, considèrent qu’en les favorisant ils participent à l’identité de la France elle-même. Pour eux, l’identité de la France comprend en effet cette idée de progrès. Je ne suis pas en train de vous donner mon opinion personnelle sur le Pacs : le point important, c’est de voir qu’il existe a priori deux catégories de réformes.
Certes, en pratique, beaucoup de situations sont intermédiaires. En voici deux exemples : les 35 heures et la retraite à 60 ans. Dans un cas comme dans l’autre, il y a un jugement par rapport à l’idée que l’on se fait des fondements de la compétitivité de l’unité politique France, et donc par rapport à cette notion de conservation comme lutte contre la dégradation ou l’entropie. De nombreux économistes estiment en l’occurrence que ces réformes telles qu’elles ont été mises en œuvre initialement allaient plutôt à l’inverse du but poursuivi. Mais, du point de vue idéologique, leurs promoteurs les ont présentées comme un progrès fondamental de l’humanité. Le gouvernement Raffarin s’est donné pour tâche d’essayer de trouver un compromis entre les deux visions, en adaptant les adaptations, en réformant les réformes. Cet exemple montre que le classement des réformes en deux catégories est trop grossier. On pourrait aussi prendre le cas, tout aussi actuel, de la décentralisation : la notion de décentralisation répond à la fois à une préoccupation relative à l’efficacité de l’État, donc à l’aspect défensif préservation de l’être pour éviter sa dégradation et l’adapter à la concurrence , et elle a aussi une souche idéologique (vision « girondine » par opposition à la vision « jacobine »).
Il faut introduire dans l’ordre des réformes progressistes une sous-catégorie représentée par les adaptations conçues non comme des réalisations au service d’une parousie du progrès mais comme des moyens subordonnés à un objectif de conservation. Bismarck, auteur de la célèbre formule « Réprimer d’abord, réformer ensuite », offre un bel exemple d’intelligence des évolutions en politique. Il avait compris que, pour conserver, il faut être prêt à des renoncements, fussent-ils douloureux. De même que, face à la gangrène, il est parfois nécessaire de faire le choix de l’amputation, pour sauver un certain ordre social et politique, il faut accepter d’adapter l’Organisation que l’on dirige. Cela suppose, pour filer la métaphore médicale, d’intervenir avant que les fonctions vitales de l’organisme ne soient touchées. Tel est le sens de l’action du chancelier Bismarck lorsque, à partir de 1883, il met en place une législation sociale. Ce système d’assurances, unique en Europe, est une réponse à la social-démocratie qui s’est structurée au congrès de Gotha en 1875. En rivalisant avec les socialistes sur le terrain de la protection des salariés, le vieux chancelier prussien également animé par l’idéologie entend les priver de leur pouvoir d’attraction. Il fait le pari de la réforme pour pérenniser le régime impérial. Il a manqué à Louis XVI un Bismarck. Encore eût-il fallu qu’il le soutînt. Il avait eu un Turgot, mais sa pusillanimité l’a conduit à le disgracier en juillet 1789.
À ce stade de l’analyse, plusieurs questions se posent. Tout d’abord, qui établit le diagnostic, et comment ? Dans la vision maurassienne de l’histoire de France, le roi était inspiré : la grâce qui agissait sur lui du seul fait de sa condition de monarque devait lui permettre de trouver les bonnes réponses aux défis de l’adaptation. J’avoue que, tout en ayant été éduqué dans une famille plutôt ouverte à ces idées, ce raisonnement médiéval ne m’a jamais paru très convaincant. Mais, quand j’observe les débats dans les démocraties contemporaines, les modes de décision relatifs aux choix publics me laissent également sceptique. Derrière cela, naturellement, il y a le vieux problème de la notion d’intérêt national ou d’intérêt général. L’intérêt national peut-il se définir d’une manière objective, ou est-il une réponse plus ou moins aléatoire à des questions elles-mêmes plus ou moins aléatoires ? Comment les questions, comment les réponses émergent-elles ? Qui établit le diagnostic et formule la thérapie ? Qui la met en œuvre ? Du point de vue de l’action – celui auquel je me place –, c’est l’Organisation de l’unité active, c’est-à-dire le gouvernement dans le cas des États ; et cette Organisation, je l’appelle une « usine de production de décisions ». On peut de moins en moins se permettre de simplifier les choses en considérant le gouvernement comme un tout. Les politologues ont aujourd’hui tendance à examiner avec précision comment les décisions se prennent effectivement, quelles sont les structures décisionnelles, quelles sont les influences extérieures ou intérieures qui s’exercent. On s’efforce d’identifier les unités et sous-unités actives qui entrent en jeu de diverses manières : les bureaucraties, les groupes de pression, les syndicats, les médias, et toute autre forme de groupes organisés au sens que j’ai défini précédemment. De cette combinaison, de cette lutte de volontés, voire de ces combats entre les différentes unités et sous-unités actives impliquées, émerge quelque chose qui va être un programme de réformes. Et ensuite, qui l’appliquera ? En principe, sur le plan juridique, c’est le gouvernement dans le cas des États, mais là encore les décisions peuvent être prises mais jamais mises en œuvre. Par exemple, une question particulièrement fascinante à suivre de près est celle de l’évolution de la Russie postsoviétique : sous Eltsine, on ne compte pas le nombre de décrets, oukases, etc., qui ont été signés, mais jamais appliqués.
Une fois que des réformes sont décidées, la question de leur application s’analyse exactement dans les mêmes termes : quelles sont les sous-unités actives qui ont intérêt à les mettre en œuvre, quelles sont celles qui s’y opposent ? Et dans tous les cas, c’est avec tous les outils de la pensée stratégique que l’on doit approcher les problèmes de lutte et de combat qui se posent alors. Là est le point clé : il n’y a pas de réforme – aussi bien pour la décision, c’est-à-dire la formulation, que pour la mise en œuvre – qui ne repose sur un principe stratégique ; il faut un acteur dominant, qui ait une vision claire non seulement de l’objectif à atteindre, mais aussi des obstacles à surmonter, et de la façon d’y parvenir en combinant les deux ingrédients de base de la stratégie que sont la cooptation et la destruction, auxquels correspondent les figures symboliques du diplomate et du soldat. Ou bien on élimine les adversaires si on le peut, ou bien on les « coopte », comme on dit en théorie des jeux, c’est-à-dire que l’on recherche un compromis avec eux. La question de la réussite ou de l’échec des réformes est aussi intéressante à étudier que celle de l’identification du besoin de réforme. L’exemple de la chute de l’Ancien Régime en France est, à cet égard, toujours éclairant. Dans les années 1780, la tête de l’Organisation, c’est-à-dire Louis XVI, se révèle handicapée par sa formation, dont on a déjà parlé, et par son tempérament. Hésitant plutôt que faible, mal dans son « emploi » de souverain, sinon à contre-emploi, il présente tous les signes de ce que l’on appellerait aujourd’hui une dépression. Cela explique la translation du pouvoir qui s’effectue en 1787-1788 au profit de Marie-Antoinette à un moment clé pour la survie du régime. Or cette dernière n’était nullement préparée à prendre en charge les affaires publiques ; en outre, elle n’avait pas de légitimité pour le faire. La question de la légitimité est au cœur de la problématique de la réforme.
Il y a une légitimité interne et une légitimité externe. Par exemple, dans les années 1970, voyageant en Afrique du Sud, j’avais été frappé par le fait que, du point de vue interne, c’est-à-dire du point de vue des Blancs d’Afrique du Sud, l’apartheid était légitime. Pour autant, cette situation ne l’était absolument pas du point de vue externe . Aussi bien du point de vue interne que du point de vue externe, la question de la légitimité ne se rapporte pas à l’unité active elle-même, mais à son Organisation. Le cas de la monarchie de Juillet est intéressant. Tocqueville, dans ses souvenirs, explique admirablement comment le régime s’est effondré en quarante-huit heures, non sans de nombreuses et très évidentes prémisses – il les décrit longuement –, précisément liées à l’absence de légitimité : il n’avait plus la légitimité royale, mais n’avait pas non plus la légitimité démocratique. Il est bien évident qu’un régime qui a une faible légitimité interne est très fragile devant les chocs intérieurs comme extérieurs.
Les historiens doivent étudier les réformes comme ils approchent les guerres, en identifiant leurs causes fondamentales et immédiates, en analysant les campagnes, les batailles, les victoires et les défaites. Sur le plan de la méthode, on perçoit une réelle unité. De ce point de vue, je reste fasciné par le Japon : le succès de la réforme à l’ère Meiji reste encore aujourd’hui quelque chose d’extraordinaire. Incidemment, on ne saurait exclure que, dans les prochaines années, le Japon connaisse une refondation comparable à l’ère Meiji. Cela fait une décennie que ce pays stagne, mais il n’est pas impossible qu’un consensus suffisant finisse par apparaître, permettant de réaliser, alors très rapidement, les réformes majeures déjà bien identifiées.
Quelques mots maintenant sur le thème « réformes versus non-réformes », c’est-à-dire absence de réformes. Que se passe-t-il, dans le cadre des réformes « conservatrices », en cas d’échec ? Il y a toute une panoplie de possibilités, bien entendu .
Une possibilité, sans doute la plus courante, est tout simplement la stagnation et le recul, ce que j’appelle le déclin. Telle est à mon avis la question qui se pose aujourd’hui pour notre pays. Quand on parle de la France, ou même de l’Europe, il faut toujours raisonner par comparaison avec d’autres, et non pas dans l’absolu, à cause de la concurrence. Si les États-Unis continuent de manifester leur remarquable capacité d’adaptation – je vous rappelle que, dans les années 1980, paraissaient des livres sur le thème du déclin américain, c’était le thème à la mode –, si donc les États-Unis continuent de manifester leur extraordinaire vitalité – le travail d’adaptation et de réforme accompli dans les années 1980 et 1990 a été impressionnant –, s’ils continuent sur cette lancée-là tandis que nous persistons à bouger comme des tortues, il est clair que nous reculerons dans la compétition, et c’est un aspect du déclin. On peut préférer d’autres mots. Il s’agit en tous cas d’un problème comparatif.
Un autre cas extrême, c’est la révolution, c’est-à-dire la rupture plus ou moins violente de l’Organisation, l’éclatement du système et son remplacement temporaire par une phase chaotique . Une révolution peut se produire lorsque les contradictions, les incompatibilités entre les unités actives impliquées, sont tellement inextricables que le système lui-même entre en crise. Une révolution est donc une crise systémique à l’intérieur de l’unité. Et s’il est un thème important c’est celui des réformes conçues comme moyen d’éviter une révolution. Mais l’absence de réforme ne conduit pas nécessairement à une révolution (on peut couler en douceur), alors qu’une révolution conduit généralement à un nouveau système, à travers des réformes radicales – généralement fondées sur une idéologie (Révolution française, révolution d’Octobre, révolution islamiste en Iran, etc.) –, et s’accompagne d’immenses souffrances . Marx avait bien vu que la logique d’un système social pouvait conduire à sa propre ruine, mais il avait tort de croire à un déterminisme absolu. Une question fort intéressante, liée à la Révolution française et plus particulièrement à l’épisode de la Terreur – on pense aussi à la révolution d’Octobre –, est que les révolutions peuvent déraper. À partir du moment où il y a crise systémique, les pires horreurs peuvent se produire.
Je rappellerai ici l’une des « lois » de Tocqueville. Il y a deux manières de concevoir la force pour un régime politique : la notion de force peut s’appliquer à la capacité de mise en œuvre des réformes. Et, en effet, pour faire de grandes réformes il faut des régimes forts (Bismarck, Atatürk, Deng Xiaoping). Les régimes faibles sont par définition impuissants. Mais il y a également des régimes forts qui utilisent leur force pour empêcher les réformes, parce que leur force suppose précisément l’absence de mouvement. Ces régimes-là sont potentiellement condamnés, à cause du phénomène entropique. Quand un tel régime fort s’arc-boute pour éviter tout changement – comme le système soviétique qui n’était fort que superficiellement –, vient nécessairement un moment de contradiction absolue. C’est alors que tout risque d’éclater. Le régime « fort » n’est jamais aussi vulnérable que lorsqu’il tente de se réformer : c’est la « loi » de Tocqueville. L’auteur de L’Ancien Régime et la Révolution (1856) avait justement été frappé par la rapidité avec laquelle les régimes apparemment les plus solides peuvent s’effondrer. Donc, quand un régime fort et immobile dans le sens « crispé sur le non-changement » commence à vouloir changer, il risque de lâcher prise, et alors tout s’effondre. La révolution russe de 1917 peut s’analyser en ces termes – c’est la thèse de Richard Pipes dans son grand livre sur la question –, mais aussi naturellement la chute de l’Union soviétique. Plus précisément dans ce dernier cas, Gorbatchev était un homme faible ; il n’a jamais eu les idées claires sur les réformes à accomplir, ni l’autorité nécessaire pour mener à terme celles qu’il avait vaguement entreprises. La chute du shah d’Iran s’explique également de cette manière, ainsi que bien d’autres épisodes douloureux de l’histoire.
La révolution, donc, est une crise systémique, un conflit pour ou moins violent entre des sous-unités actives de l’unité politique, et ce conflit aboutit à la destruction ou à la paralysie temporaire de l’Organisation, c’est-à-dire ici de l’État. Une révolution, en ce sens, n’est pas nécessairement une guerre de sécession, c’est-à-dire que l’unité politique en tant que telle n’est pas nécessairement menacée. Il se peut cependant qu’elle le soit, et même qu’elle disparaisse sans guerre proprement dite : l’unité politique URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, a disparu avec la crise du tournant des années 1990, parce qu’elle était fragile comme tous les empires. Cet éclatement a conduit à celui du système international dans son ensemble, et donc à une phase que certains considèrent comme chaotique . Observons incidemment que le concept de révolution est également pertinent pour l’analyse du système international dans son ensemble, et là aussi on peut s’interroger sur la problématique de la réforme comme moyen d’empêcher la révolution. Pour gérer les mutations à venir d’un système, il est indispensable, tout en s’inscrivant dans la durée, d’imaginer et de mettre en place les conditions du changement. À l’échelle des États, les plus grands actes diplomatiques opèrent sur le long terme. En l’occurrence, le cas de la réunification allemande est riche d’enseignements. Les diplomates du gouvernement de Bonn ont toujours soigneusement veillé à maintenir vivante l’hypothèse de la réunification, inscrite dans le préambule de la Grundgesetz (8 mai 1949), la Loi fondamentale, qui stipule que « le peuple allemand dans son ensemble, disposant librement de lui-même, reste convié à parachever l’unité et la liberté de l’Allemagne ». Avec une constance sans faille, la RFA s’est attachée à faire reconnaître cet objectif dans tous les actes qui la liaient à ses partenaires et alliés, quitte à faire douter parfois de la sincérité de son engagement européen. En pratique, le cadre juridique était prêt, dès la création de la République fédérale, pour permettre l’unification en douceur, avec les articles 23 et 146 de la Loi fondamentale. Le premier prévoyait en quelque sorte l’adhésion de la RDA à l’Allemagne fédérale, sans modification constitutionnelle préalable, l’entérinement populaire tenant lieu d’acte unificateur. Ainsi, au-delà des pulsions du moment, le rôle et la grandeur d’une politique digne de ce nom sont-ils de penser l’avenir en termes dynamiques.
Les révolutions ne sont pas inéluctables. Il arrive même qu’elles s’annoncent bruyamment à qui sait écouter et observer. Plus de trente ans avant la Révolution, le marquis d’Argenson en consignait les prémisses : « L’anarchie marche à grands pas. Bientôt le roi ne sera plus que le soliveau de la fable. Si cela dure, on se hasardera à sauter sur lui, à ne faire aucun cas de ses ordres, qui ne sont que des volontés empruntées. […] Il souffle d’Angleterre un vent philosophique ; on entend murmurer ces mots de liberté, de république ; déjà les esprits en sont pénétrés, et l’on sait à quel point l’opinion gouverne le monde. Le temps de l’adoration est passé ; ce nom de maître, si doux à nos aïeux, sonne mal à nos oreilles. Il se peut qu’une nouvelle forme de gouvernement soit déjà conçue en de certaines têtes, pour sortir, à la première occasion, armée de toutes pièces. Peut-être la révolution s’opérera-t-elle avec moins de contestation que l’on ne le pense… D’une émeute on peut passer à la révolte, de la révolte à une totale révolution : élire de vrais tribuns du peuple, des consuls, des comices ; priver le roi et ses ministres de leur excessif pouvoir de nuire . »
On mesure, en relisant ces lignes prémonitoires, la pertinence des conseils dispensés par Malesherbes à Louis XVI à l’été 1788 : « Concevez la Constitution de votre siècle, prenez-y votre place et ne craignez pas de la fonder sur les droits du peuple. Votre nation, vous voyant à la hauteur de ses vœux, n’aura plus qu’à perfectionner votre ouvrage avant de la sanctionner. C’est ainsi que vous maîtriserez un grand événement, en l’accomplissant vous-même . »
Des réformes bien conçues et bien menées auraient pu prévenir le grand bouleversement de 1789. Mais le roi de France ne put s’y résoudre. Dans la plupart des cas, toutefois, les non-réformes n’aboutissent pas à des révolutions mais simplement à des situations de recul ou de déclin. Je répète qu’il n’y a aucun déterminisme dans cette question. Mais, quand on y réfléchit en France, on a inévitablement en tête la Révolution de 1789. François Furet disait que l’objet « Révolution française » n’était toujours pas refroidi . Je pense que cela reste vrai au début du XXIe siècle, et que le souvenir de la Révolution française continue, peut-être à l’excès, de colorer la réflexion en France sur la notion de réforme. Il vaut la peine d’approfondir le concept de réforme en tant que tel, c’est-à-dire en oubliant la révolution, ou plutôt en la considérant pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un cas pathologique extrême d’une unité ou d’un système d’unités politiques dont la capacité d’adaptation se trouve anéantie.