Comment en est-on
arrivé là ?
Au début de ce siècle, les Occidentaux ont voulu croire à la mondialisation heureuse grâce à l’expansion de la démocratie et de l’économie de marché.
Un quart de siècle a passé, et la planète est engagée dans une Deuxième guerre froide, voire dans les prémices d’une Troisième Guerre mondiale. Le djihadisme s’est étendu dans une aire arabo-musulmane en effervescence. La guerre d’Ukraine a bouleversé le continent eurasiatique. Face à la Chine, les États-Unis se mobilisent pour garder leur primauté. La guerre économique se répand. Menacée de déclassement, l’Union européenne doit se réformer en profondeur pour survivre.
Comment en est-on arrivé là ? C’est à cette question que répond ce livre de façon à la fois précise et vivante, tout en s’interdisant, face à la complexité de la réalité, de réduire l’histoire à un combat entre les « bons démocrates » et les « méchants autocrates ».
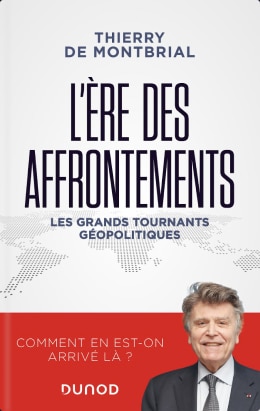
Partager
La guerre d’Ukraine a bouleversé le continent eurasiatique. Face à la Chine, les Etats-Unis se mobilisent pour garder leur primauté. La guerre économique se répand. Menacée de déclassement, l’Union européenne doit se réformer en profondeur pour survivre. Comment en est-on arrivé là ? Il ne faut pas réduire l’histoire à un combat entre les « bons démocrates » et « méchants autocrates ».
01 avril 2025
Entretien dans le Figaro Histoire n° 79 de avril - mai 2025 avec Michel de Jeaghere...

30 mars 2025
Interview le 30 mars 2025 dans l'émission Géopilitique de Marie-France Chatin sur RFI...

28 mars 2025
Dans diplomatie magazine de mars 2025 : 3 questions autour du livre "L'ère des affronteme...

20 mars 2025
Interview par Pascal Boniface le 14 mars 2025 dans la série « Entretiens géopo » de sa...

14 mars 2025
Interview le 14 mars 2025 sur Radio Notre Dame dans la matinale...

12 mars 2025
Interview le 12 mars 2025 sur BFM Business dans la matinale Le Monde qui bouge de Caroline...

28 février 2025
Grand entretien dans La croix Hebdo le 28 février 2025, par Julie Connan et Jean-Christop...

07 mars 2025
Samedi 8 mars 2025 à l’occasion de la parution du livre L’ère des affrontements, les...

27 février 2025
Chronique d'Alain Frachon dans Le Monde, le 27 février 2025, suite à la conférence de p...
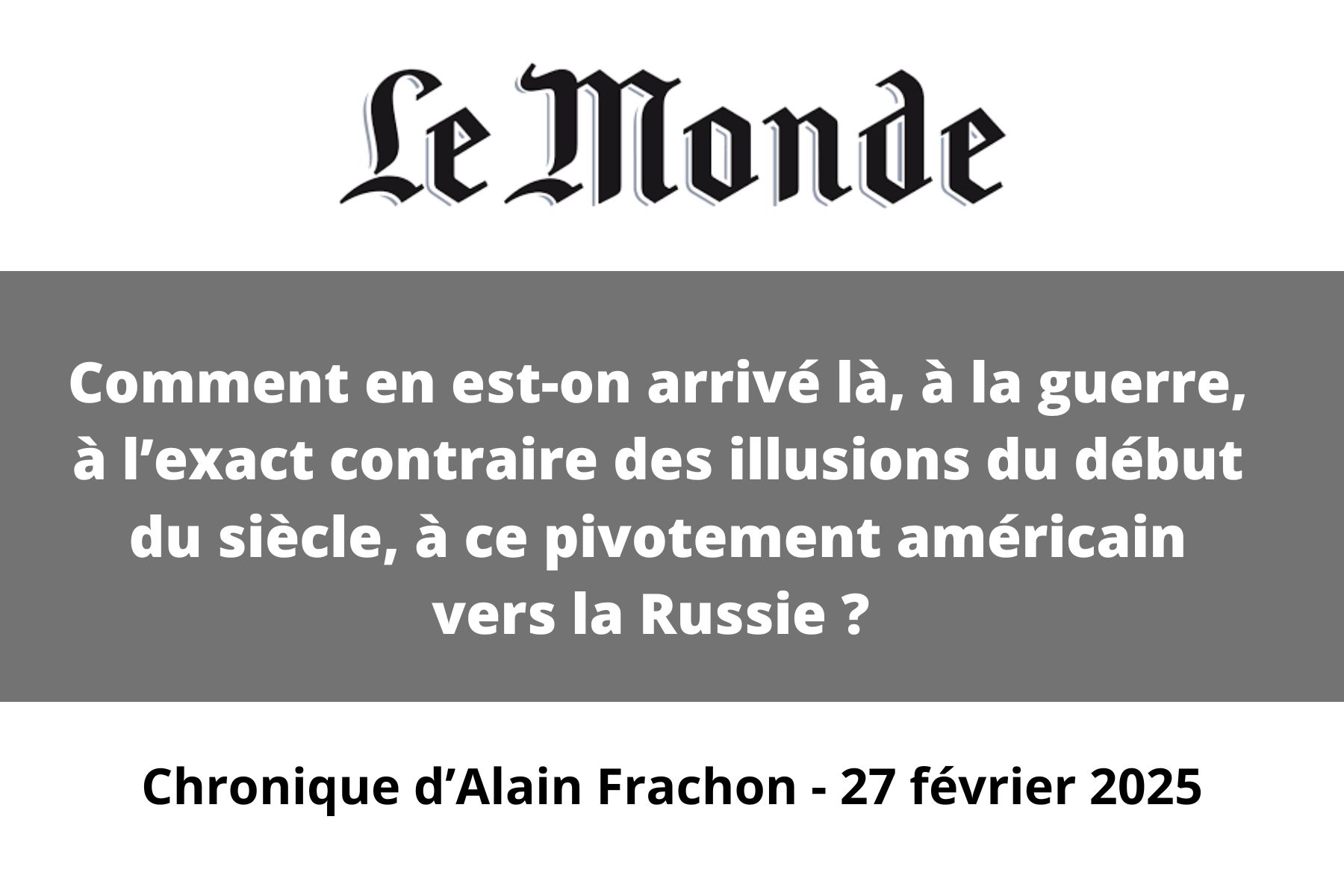
25 février 2025
Interview par Mister Géopolitix dans une vidéo sur l'OTAN le 25 février 2025...

24 février 2025
Entretien le 24 février 2025, Le Point, à l'occasion de la parution du livre "L'ère des...

20 février 2025
Interview sur LCI dans l'émission 24h Pujadas jeudi 20 février 2025...

20 février 2025
Interview dans l'émission Géopolitique le Mag sur Radio J par Steve Nadjar le 20 févrie...

14 février 2025
Interview pour Le Figaro Live, dans l'émission Points de Vue de Vincent Roux le 14 févri...

14 février 2025
Interview dans le journal Les Echos, le 14 février 2025 à l'occasion de la parution du l...

13 février 2025
Conférence de présentation livre L'ère des affrontements à paraître le 12 février 20...

12 février 2025
Mercredi 12 février à 18 heures. A l'occasion de la parution du livre L'ère des affront...

20 décembre 2024
Interview dans le magazine Forbes, hiver 2024...

Thierry de Montbrial est le Président exécutif de l’Institut français des relations internationales qu’il a fondé en 1979. En 2008, il a lancé la World Policy Conference. Il est membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques de l’Institut de France depuis 1992 et membre associé de nombreuses académies étrangères.
Il a dirigé le département de sciences économiques de l’Ecole Polytechnique de 1974 à 1992. Il a mis sur pied le Centre d’analyse et de prévision (actuellement Centre d’analyse, de prévision et de stratégie) du ministère des Affaires étrangères et en a été le premier directeur (1973-1979). Il est l’auteur de plus de vingt livres.
Thierry de Montbrial est X 63, docteur en économie mathématique de l’Université de Berkeley (Californie). Il est ancien ingénieur général au Corps des Mines.

©Crédit photo : Dominik BUTZMANN/LAIF-REA