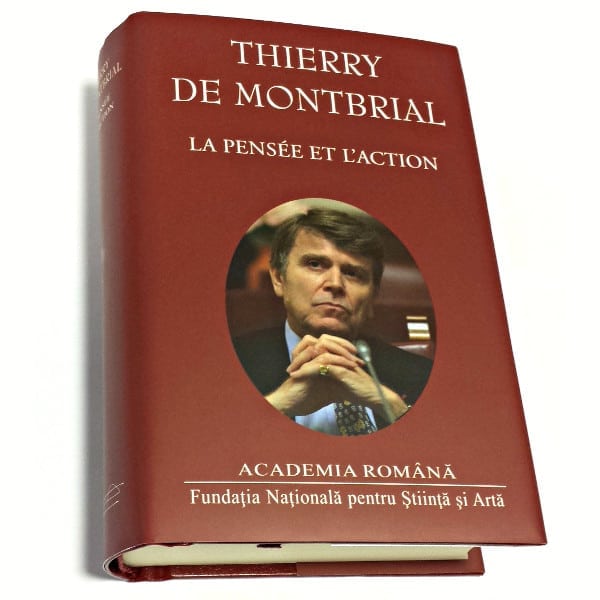Mario Monti
Discours d’installation de Monsieur Mario MONTI comme membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques lundi 5 mai 2014, au fauteuil laissé vacant par le décès de Václav Havel
Sous la présidence de M. Bernard BOURGEOIS, Allocution de M. Bernard BOURGEOIS, Président de l’Académie, Discours d’installation par M. Thierry de MONTBRIAL, membre de l’Académie, Réponse et éloge de Václav Havel par M. Mario MONTI, membre associé étranger de l’Académie, Sénateur de la République italienne, ancien Président du Conseil des ministres.
Vous êtes italo-européen. Vous êtes italien. Vous êtes lombard. Vous êtes économiste. Vous êtes un universitaire avec ce que cela suppose d’esprit critique et d’indépendance. Vous êtes un Européen ouvert sur le monde.
Né le 19 mars 1943 à Varèse, vous provenez du cœur historique de l’Europe industrieuse et financière, c’est-à-dire que vous en avez les gènes. Vous fûtes, seize jours après celui qui s’adresse à vous aujourd’hui sous la Coupole de l’Institut de France, un bébé de la guerre. Un enfant de l’après-guerre. Comme beaucoup d’Italiens, vous comptez des ancêtres qui ont franchi l’Atlantique à la fin du XIXe siècle, pour construire une vie qu’ils espéraient meilleure . C’est en Argentine que votre grand-père fonda une petite entreprise. C’est là aussi qu’est né votre père. Vous avez grandi dans la capitale lombarde au sein d’une « famille de la bourgeoisie ordinaire italienne », selon vos propres termes . C’est alors que vous êtes devenu un supporter, un tifoso du Milan AC. Comme toute une génération, vous gardez le souvenir de ce 4 mai 1949, jour funeste où l’une des plus brillantes équipes du calcio, le Torino, périt dans un accident d’avion . Un véritable drame national. Élève des jésuites, il vous en reste une belle élégance intellectuelle, mais aussi une manière d’être qui fait partie de votre personnalité et à laquelle on peut sans doute rattacher une forme d’humour au second degré qu’apprécient vos amis et grâce à laquelle votre image ne se réduit certes pas à la caricature du professeur austère et bardé d’assurance. Il ne faut pas davantage confondre intégrité et austérité que convictions et certitudes. La propension à l’humour et la capacité de recul, voilà des traits que vous aurez partagés avec notre confrère de l’Institut Raymond Barre, auquel on vous a souvent comparé, ce qui n’est pas pour vous déplaire. Étudiant à la célèbre Université Bocconi de Milan, dont vous deviez plus tard devenir le recteur puis le président, vous défendez en 1965 une thèse sur « le budget prévisionnel de la Communauté européenne ». Le choix du sujet révèle que, très jeune, vous vous êtes passionné pour la construction européenne. Ce qui vous intéresse au départ, c’est la politique économique, et vous avez vite compris que, de plus en plus, le cadre approprié à cette fin serait la Communauté, rebaptisée Union depuis le traité de Maastricht. Progressivement, vous avez aussi développé votre réflexion sur l’organisation politique de l’Europe. Il faut lire le beau livre que vous avez publié avec Sylvie Goulard en 2012, alors que vous résidiez au palais Chigi. Ce livre est intitulé De la démocratie en Europe . Un joli clin d’œil. Avant de vous investir à fond dans l’économie politique, vous avez voulu consolider vos bases en passant l’année 1968 à Yale, auprès du futur prix Nobel (1981) James Tobin, l’un des grands architectes de la synthèse macroéconomique néoclassique et l’un des pionniers de la théorie de la finance, beaucoup plus proche cependant de Keynes que de Friedman. Ce faisant, comme et en même temps que celui qui vous reçoit, vous avez fait d’une pierre trois coups : vous avez effectivement approfondi votre connaissance de l’économie en restant fidèle, vous, à la tradition italienne ; vous avez fait une sorte de long voyage de noces, puisque vous vous étiez marié l’année d’avant avec Elsa ; et vous vous êtes immergé dans la société américaine à un moment particulièrement riche. Comme tous ceux de notre génération qui ont eu la chance de partager une telle expérience, vous en avez été marqué pour la vie.
À ce stade, je voudrais rappeler que votre pays a une magnifique tradition dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie politique et financière. Dans le champ de la recherche universitaire, chacun connaît le nom de Franco Modigliani, né à Rome en 1918. Ses études commencées en Italie se poursuivirent à la Sorbonne, à partir de 1939. En effet, Modigliani décida de fuir le régime fasciste, devenu antisémite en 1938. Les États-Unis devinrent finalement sa nouvelle patrie. Il obtint le prix Nobel en 1985 pour l’élaboration et le développement de la théorie du cycle de vie sur l’épargne des ménages ainsi que pour la formulation des théorèmes de Modigliani-Miller sur l’évaluation des entreprises et le coût du capital. La nationalité américaine et le prix Nobel favorisent la gloire. Certainement davantage que le travail méticuleux au sein des banques centrales. Or, la Banque d’Italie a donné des économistes politiques de premier plan, comme le regretté Tommaso Padoa-Schioppa, une grande figure de l’Europe. La notoriété de plusieurs de ses dirigeants a largement débordé les frontières du pays. Je me souviens d’avoir été impressionné par la distinction personnelle et intellectuelle de Guido Carli, ancien gouverneur de la Banque d’Italie, avec lequel je siégeais au début des années 1980 au conseil international d’IBM Europe. Vous lui avez succédé au conseil de Fiat. Plus récemment, des personnalités comme Lamberto Dini ou Carlo Azeglio Ciampi ont connu des destins nationaux, dans des phases comme il s’en produit régulièrement où le système politique italien prend ses distances avec ses propres jeux. Et chacun connaît l’autre super Mario, Mario Draghi, le brillant successeur de notre confrère Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale européenne (BCE). Votre nom a plus d’une fois été cité pour diriger la prestigieuse Banque d’Italie. Le sort en a décidé autrement et vous avez accédé aux plus hautes responsabilités politiques sans passer par cette étape.
Le temps manque pour évoquer davantage la richesse de l’école italienne d’économie. Je mentionnerai Luigi Spaventa, connu entre autres pour avoir présidé un comité sur la dette publique dont vous fîtes partie en 1988. Je me souviens de mon étonnement à l’occasion d’une conversation avec lui en 1980 sur les marges de manœuvre possibles pour la politique économique de l’Italie. Pour lui, comme pour vous ou pour Raymond Barre, ces marges n’embrassaient que des variantes limitées autour du modèle de l’économie sociale de marché. Mon étonnement tenait à ce qu’il s’était fait élire comme indépendant sur une liste du Parti communiste italien, alors dirigé par Enrico Berlinguer. L’écart béant entre le PCI et le PCF était difficilement saisissable pour un Français non averti. Plus généralement d’ailleurs, ce que l’on appelait alors l’eurocommunisme faisait l’objet de spéculations intenses. On peut en rire aujourd’hui, mais un homme de pensée et d’action aussi avisé que notre ami commun Henry Kissinger a pensé, après la mort du général Franco, que l’Espagne allait devenir communiste. Et je ne parle pas de sa frayeur au lendemain de l’élection de François Mitterrand en 1981, heureusement vite dissipée après une invitation à Latché.
Aujourd’hui comme hier, nos deux pays ne partagent pas les mêmes clivages idéologiques, et ce n’est pas un hasard si les économistes ne constituent pas en France, comme c’est le cas en Italie, un vivier important de dirigeants publics. De ce point de vue, la comparaison entre Raymond Barre et Mario Monti fait ressortir une différence essentielle. Notre ancien confrère reste à ce jour une singularité dans l’histoire politique de la France. Notre nouveau confrère s’inscrit dans une tradition propre à ce que l’on appelle désormais, quoiqu’abusivement, « la deuxième république ». Cette tradition est incarnée par une sorte de microcosme pénétré de l’intérêt général, qui se perçoit comme un recours quand la conjoncture politique devient trop confuse. Un microcosme, peut-être mieux vaudrait-il dire un club, qui vient donc parfois compenser, temporairement bien sûr, la faiblesse de l’État, le poids des clientélismes. Tout se passe comme si les jeux politiques se calmaient par intermittence. Mais quand la vraie politique, celles des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à « aimer les gens », comme ils se plaisent souvent à se définir, quand donc la politique reprend le dessus, les différences entre nos deux pays s’estompent. Le moment de la société civile et des professeurs est passé. En 1988, Raymond Barre a été battu à l’élection présidentielle. En 2013, vos efforts pour trouver une place à votre mesure dans le jeu traditionnel ont été déçus.
Mais revenons à votre histoire. De retour de Yale, en 1969, vous vous épanouissez dans une brillante carrière universitaire autour de votre base lombarde, successivement à Trente, à Turin, et enfin, comme votre propre père mais aussi votre fils, à la Bocconi. Vous enseignez l’économie politique, en particulier l’économie monétaire et financière, et parallèlement vous commencez à vous faire connaître du public comme éditorialiste au Corriere della Sera. En 1981, vous voilà appelé au conseil d’administration d’IBM Italia. Vous faites ainsi votre entrée dans le cercle très distingué des administrateurs indépendants, à travers lequel vous devenez un acteur de la vie économique concrète. Comment ne pas relever incidemment qu’en France, à la même époque, le statut général de la fonction publique interdisait aux professeurs d’université d’exercer des responsabilités dans le secteur privé. Les conseils d’administration vous immergent dans le secteur productif, mais la passion de l’intérêt général ne vous a pas quitté, et l’on vous sollicite souvent pour participer à des commissions comme celle présidée par Luigi Spaventa.
Très tôt, vous avez été repéré par l’une des figures dominantes de l’Italie du second XXe siècle, je veux dire Giovanni Agnelli, dont j’ai plaisir à rappeler qu’il fut correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques, où il lui arrivait de passer de bons moments, comme certains d’entre nous s’en souviennent. La mémoire collective s’efface vite et il peut être difficile aujourd’hui de se représenter à quel point l’Avvocato, comme on l’appelait, a incarné la modernisation de l’Italie d’après guerre. Longtemps, Fiat est resté le symbole de la renaissance industrielle du pays, plus encore que Renault en France, avec cette différence parfaitement symptomatique que l’une était personnalisée par une famille et en fait par un homme, et l’autre par l’État. Comme les plus grands hommes d’action, Giovanni Agnelli resta toujours à l’affût des talents, et l’on ne compte pas ceux à qui il a mis le pied à l’étrier. Parmi les voies qu’il utilisait à cette fin, il y avait les grandes associations internationales à la création desquelles il avait contribué. Je pense par exemple au Bilderberg et plus tard à la Commission trilatérale qui, aujourd’hui, font encore fantasmer dans le monde entier les adeptes de la théorie du complot. Le Bilderberg a été créé en 1954 sous la présidence du prince Bernhard des Pays-Bas, dans le contexte de la guerre froide, avec une idée simple : les pays de l’Alliance atlantique, en tant que club de démocraties adeptes de l’économie de marché, ne pouvaient que l’emporter face à l’idéologie soviétique. Du point de vue européen, l’esprit originel du Bilderberg se confond avec celui des pères fondateurs de la Communauté européenne, très marqué par la démocratie chrétienne. À ce sujet, on évoque toujours le trio Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Robert Schuman, trois hommes d’État auxquels on adjoint immanquablement un Français d’influence, unique dans son genre, et parfaitement emblématique de la notion de club, Jean Monnet.
Le point que je veux souligner ici est que l’Italie est depuis le début au cœur de la construction atlantique et européenne, qu’il s’agisse de ses institutions officielles ou des émanations de la société civile comme le Bilderberg, grâce à des personnalités comme Giovanni Agnelli. Pour la France, les choses ont été plus compliquées, en raison de l’immense parenthèse du général de Gaulle, entre 1958 et 1969 sans compter les ombres portées. Ayant fait mon entrée au Bilderberg en 1974 et à la Trilatérale deux ans plus tard, je peux témoigner de la marginalisation de la France avant l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, même dans les moins officielles des institutions euro-atlantiques. Ces différences ne sont évidemment pas que des avatars. La France incarne l’idée de l’État-nation forgé à travers les siècles. Comme l’a montré Pierre Nora dans son œuvre, les Français ont longtemps eu une conception sans pareil de leur histoire et de leur identité nationale. L’État, la langue et le dogme d’un peuple indivisible y jouent des rôles essentiels et ce sont justement ces trois attributs qui sont mis à mal par les mouvements migratoires et par la mondialisation. Au contraire, l’Italie apparaît comme une construction nationale à la fois récente et inachevée. Le roi de Sardaigne Charles-Albert pouvait dire Italia fara da se – l’Italie se construira par elle-même c’est-à-dire sans concours extérieur –, mais il s’est trompé. Quant à l’inachèvement, il se manifeste toujours, si l’on suit certains spécialistes de l’administration italienne, par la faiblesse de l’État et de ses institutions. Par comparaison, dans la France d’aujourd’hui, l’État souffre moins de sa force que de son obésité. Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale et plus généralement de ce que l’on a appelé la guerre civile européenne, la France n’a cessé d’osciller entre la tentation de retourner aux sources de son identité et celle du dépassement dans la construction, avec d’autres, d’un nouveau type d’unité politique. Pour l’Italie, c’est justement dans cette construction que l’identité devait trouver son parachèvement. Nul ne songera à nier l’importance, dans l’aventure de la Communauté puis de l’Union européenne, de la réconciliation franco-allemande. Mais il y a beaucoup plus et si l’Italie est aujourd’hui comme naguère un pilier de l’euro-atlantisme – et au-delà d’une certaine idée de l’ouverture au monde – c’est grâce à son élan vital en vue d’un accomplissement à venir. Voilà pourquoi j’ai commencé avec ces paroles : vous êtes italo-européen, vous êtes un Européen ouvert sur le monde.
On ne répétera jamais assez que chacun des six pays fondateurs a apporté sa marque au lancement de l’Union européenne. Je ne dirais pas à son code génétique, car notre construction est de nature fondamentalement épigénétique, comme toute l’histoire des hommes. Il n’empêche que les conditions initiales ont une importance particulière. Et d’abord, les trois grands fondateurs : la France et l’Allemagne, bien sûr, mais aussi l’Italie que vous incarnez ce jour à l’Institut de France. Voilà pourquoi, dans les réunions du Bilderberg, nous étions particulièrement attentifs aux nouvelles têtes italiennes, sélectionnées par l’Avvocato. Deux d’entre elles devaient connaître un destin national et européen. Dans l’ordre de leur apparition à la fin des années 1970 et au début des années 1980 : Romano Prodi et vous, Mario Monti. Vous vous êtes aussitôt trouvé dans cette institution puis dans d’autres semblables comme un poisson dans l’eau et avez ainsi continué de tisser votre toile, de partager, d’approfondir et de faire rayonner vos idées, dans l’ordre de l’économie et de la politique, cependant que grâce à vous, vos interlocuteurs recevaient le meilleur de l’Italie.
Lorsque Silvio Berlusconi, président du Conseil, vous a désigné pour rejoindre la Commission européenne en 1995, personne n’en a été surpris. Sur un plan personnel, vous étiez amplement préparé à l’exercice d’une telle mission, tant sur le fond que par vos réseaux. Du point de vue collectif, on en revient à cette idée que dans votre pays, les jeux politiques ont des limites. Là où ailleurs on a parfois cédé à la tentation d’envoyer à Bruxelles des hommes ou des femmes d’envergure limitée, mais que l’on voulait rétribuer, la nomination d’un commissaire européen est considérée à Rome comme un acte aussi important que la nomination d’un gouverneur de la Banque d’Italie. J’imagine que le Cavaliere, comme on l’appelait alors, a dû par la suite regretter sa décision. Plus souvent qu’on ne le croit, la petite histoire rejoint la grande. Comment ne pas relever aussi, une fois de plus, le parallèle avec Raymond Barre. Celui-ci, poussé par Jean-Marcel Jeanneney dont il avait été le directeur de cabinet, avait été nommé par le général de Gaulle en 1967, il est vrai en un temps où la fonction de commissaire européen, plus modeste, n’attirait pas les étoiles de la politique. Du moins le Général était-il sensible à la compétence, ce qui n’était pas la moindre de ses qualités.
Vous avez accompli deux mandats à Bruxelles où vous avez été en charge successivement des portefeuilles complémentaires du marché intérieur et de la concurrence. Pendant cette décennie, vous auriez pu vous contenter de labourer consciencieusement mais prudemment votre terrain, au mieux de votre savoir et de vos convictions. Mais vous avez surpris votre monde. Comme commissaire à la concurrence, en effet, vous avez manifesté une autorité et une fermeté insoupçonnées, telles qu’à la simple écoute de votre nom, plus d’un industriel ou d’un homme politique aguerri a pu se mettre à trembler. La Commission européenne ne donne pas souvent l’occasion d’accéder à la grande notoriété. À votre manière, vous y êtes parvenu, et je pense vous connaître suffisamment pour affirmer que ce succès ne fut pas le résultat d’une simple stratégie de communication. Il est vrai que le domaine de la concurrence se prête à des actions d’éclat, puisque l’on est conduit à s’opposer à de très grands responsables. Votre conflit avec le patron de Coca-Cola est resté dans les mémoires et, ce qui n’est qu’apparemment paradoxal, après avoir quitté la Commission, vous êtes devenu conseiller de cette entreprise pour l’international. Les Français se souviennent bien de votre bras de fer autour d’Alstom avec Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances. L’ancien président de la République ne vous en a d’ailleurs pas voulu, comme on a pu le constater au début 2012 après votre entrée au palais Chigi. Dans les deux cas, vos interlocuteurs ont admiré leur adversaire d’un moment. Naturellement, ces grands combats ont beaucoup contribué à vous faire connaître au-delà des cercles d’initiés.
Votre action à Bruxelles a reposé sur des bases que je tenterai de résumer. Depuis presque aussi longtemps qu’ils s’intéressent à l’abstraction de la concurrence pure et parfaite, les économistes ont cherché à comprendre la concurrence réelle, imparfaite, et à réfléchir aux moyens de remédier à ses défauts. Ceci a donné naissance à une branche très active de la science économique, que l’on appelle parfois, en traduisant de l’anglais, l’économie ou l’organisation industrielle. Le principe le plus ancien de cette discipline énonce que les monopoles enrichissent leurs détenteurs au détriment du bien-être total de la collectivité, mesurable en théorie par une quantité appelée « surplus ». En fait, aux États-Unis, le droit de la concurrence avait précédé la théorie économique, avec le Sherman Act, de 1890, dont la première application majeure, restée célèbre, fut le démantèlement de la Standard Oil of New Jersey en 1911. De manière évidente, la lutte contre les monopoles doit s’étendre aux ententes et aux cartels. Si l’on reconnaît que la puissance américaine repose en dernière instance sur le dynamisme de son économie concurrentielle, et si l’on admet que la constitution d’un grand marché intérieur est une poutre maîtresse de la construction européenne, on ne peut être, comme vous, que favorable à une politique rigoureuse en matière de concurrence. En vous illustrant dans ce domaine, vous n’avez pas seulement démontré votre talent en tant qu’économiste d’action. Vous vous êtes montré cohérent avec la vision italienne de la construction européenne, avec ses deux piliers complémentaires, la démocratie et l’économie sociale de marché, complétés par l’ouverture sur le monde. Votre interprétation exigeante a contribué à muscler le marché européen en poussant les entreprises à ne pas s’endormir sur leurs lauriers ou sur leurs rentes. À noter cependant, vous êtes le premier à le reconnaître, que, dans le domaine de la concurrence, l’absence de recours face à la Commission est une anomalie regrettable.
Vous admettez d’ailleurs que d’autres problèmes ouverts demeurent, y compris sur le plan de l’analyse théorique. Par exemple, jusqu’à quel point la distinction entre les entreprises « intérieures » et « extérieures » est-elle pertinente sur un espace donné ? Derrière cette interrogation se trouvent des questions comme la nationalité des entreprises et donc leur éventuel contenu partiel en biens publics ; l’identification des secteurs stratégiques pour une nation, avec des implications en termes de politiques publiques ; et finalement, la définition et la légitimité des politiques industrielles, en particulier des aides de l’État. L’orthodoxie libérale n’admet, et encore seulement dans certains cas, que les interventions visant à corriger les externalités, en matière d’environnement par exemple, mais d’une manière générale regarde, avec beaucoup de méfiance, la notion de bien public. Toute une école de pensée a acquis ses lettres de noblesse – concrètement des prix Nobel – autour de l’idée que la correction des externalités et la production des biens publics pouvaient se passer de l’État. Et pourtant, les États demeurent encore de nos jours les principaux sujets du système international et les plus puissants d’entre eux, comme les États-Unis, continuent d’intervenir souverainement dans leurs économies. C’est là que l’on retrouve toute l’ambiguïté de la construction européenne dans sa phase actuelle. Je reviens sur les aides de l’État. La Commission les pourchasse au juste motif qu’elles faussent souvent la concurrence. Mais le droit américain ne connaît rien d’équivalent, parce qu’à l’intérieur des États-Unis la question de la concurrence entre les États ne se pose pas de la même manière. On voit bien où le bât blesse : de l’autre côté de l’Atlantique, l’État fédéral définit l’intérêt national et le défend bec et ongles ; rien d’équivalent n’existe de ce côté-ci. On en revient au point de départ. La France voit « l’Europe européenne » comme une extension de son propre modèle dans ce qu’il a pu avoir de plus réussi. Cette vision est critiquée par ses partenaires comme l’Italie, dont l’histoire et la culture sont fort différentes. Il y a là une vraie question avec de fortes implications, certes économiques mais aussi politiques, pour la future division internationale du travail, dans un monde où l’on voit bien que la puissance au sens le plus traditionnel du terme conservera ô combien un sens, avec des États comme les États-Unis et la Chine. Pour clore ce chapitre, je mentionnerai aussi d’un trait la question difficile – et manifestement liée à tout ce qui précède – des rapports entre la conception du grand marché intérieur et la conduite de négociations comme celle du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP).
Si je m’exprime ainsi, ici et devant vous, c’est qu’à mon sens l’immense majorité des citoyens européens perçoivent plus ou moins confusément qu’ils risquent de devenir sujets d’un vaste ensemble euro-atlantique, sans notion claire d’un bien public réellement partagé, et dont les centres de décision stratégiques échapperaient de plus en plus à leur contrôle démocratique. Face à cette angoisse diffuse qui se manifeste un peu partout dans des mouvements, dits d’extrême gauche ou d’extrême droite, n’est-il pas vrai que le discours convenu sur le marché unique ou sur l’euro est tragiquement insuffisant, malgré sa pertinence à bien des égards ? N’est-il pas urgent de démonter le piège où un nombre croissant de citoyens risque d’enfermer les leaders de l’Europe, en les présentant comme des émanations du grand capital ou de la finance apatrides ? Peu d’hommes autant que vous ont l’intégrité et la légitimité nécessaires pour contribuer à l’élaboration d’un nouveau discours audible, pour que le projet européen ne se dissolve pas dans une marée de scepticisme et de découragement, ou que nos descendants ne nous accusent pas d’avoir en fait vidé de son identité profonde l’Europe que nous prétendions construire pour eux.
Votre intégrité, chacun la reconnaît, et vous assumez pleinement vos liens avec les classes dirigeantes à différents niveaux. D’autant mieux que vous êtes farouchement indépendant par nature ce qui, convenons-en, n’est pas nécessairement le cas des hommes de pouvoir, même moins connectés que vous avec les grands du monde de l’économie. Votre légitimité, vous la tenez de l’ensemble de votre parcours, mais particulièrement de ces quelques mois où vous avez incarné la résurrection de l’Italie. Tous les pays européens ont individuellement à s’adapter au formidable défi posé par l’émergence de ce que l’on appelait jadis le Tiers Monde. Le problème n’est pas tant d’identifier les réformes nécessaires pour éviter le déclin. On les connaît depuis longtemps, et c’est déjà beaucoup. Mais l’efficacité des réformes implique de franchir des étapes où, dans un premier temps, les choses peuvent paraître empirer. Leur légitimité implique donc un effort de pédagogie, au-delà de l’idéologie, mais surtout une volonté de justice sociale. Le vrai problème est donc politique. J’en reviens ainsi à votre pays.
Juste réponse à vingt ans de dictature, la Constitution très progressiste de l’Italie républicaine n’a pas réussi à prévenir de nouvelles atteintes à la démocratie telles que la partitocratie, le clientélisme, ou ce que résume l’oxymore « crise politique permanente ». L’opération « Mani Pulite » au début des années 1990 est loin d’avoir suffi à établir un système politique plus satisfaisant. Quant à la justice sociale, elle se heurte au mur de la corruption et de l’air du temps. L’air du temps nous ramène à la révolution des technologies de l’information et donc à la mondialisation, à l’accroissement des inégalités, aux fortunes souvent aberrantes dans la sphère financière, aux rémunérations indécentes de certains dirigeants, y compris d’ailleurs, dans le cas italien, au sein même de la fonction publique. Nous avons fait l’euro mais, au moins dans un premier temps, même la France et l’Allemagne ont pris des libertés avec les critères de Maastricht cédant, au profit du court terme, à la facilité des déficits budgétaires et d’un endettement toujours plus grand. Seule l’Allemagne a ensuite corrigé le tir et pour cela Gerhard Schröder a acquis la dimension d’un homme d’État. En dehors du petit cercle des économistes d’action et des banquiers centraux, on semblait avoir oublié qu’un endettement non maîtrisé entraîne inéluctablement, mais à un moment imprévisible, une crise de confiance. Comme le reste du monde, l’Europe a été frappée par la crise financière d’origine américaine en 2007-2008, laquelle a amplifié les déséquilibres antérieurs, provoquant, pour la première fois depuis l’entre-deux-guerres, une crise de confiance généralisée sur les dettes souveraines. Un événement inouï quand on le situe dans l’ensemble de l’histoire économique de l’après-guerre.
Où en était l’Italie à la veille de votre finest hour ? Le quatrième gouvernement de Silvio Berlusconi vivait sa troisième année. L’action n’était pas à la hauteur de la nécessité. L’Italie s’enfonçait dans la crise. Surtout, ce gouvernement n’avait pas bonne réputation. L’image projetée par son chef choquait de plus en plus en particulier à l’extérieur. De manière générale, on attend d’un leader qu’il se consacre fondamentalement au bien commun, et ce plus encore par gros temps. On attend aussi que son comportement soit en adéquation avec les épreuves traversées par le peuple. L’âpreté au gain, l’ostentation et la vulgarité étaient certes assez répandues, pas seulement dans votre pays. Mais en 2010-2011, ces vents mauvais ont contribué à alimenter la défiance qui, dans le monde contemporain, quand le grand public a l’impression que plus personne ne tient les rênes, se mesure froidement par les écarts de taux d’intérêt communément appelés spreads et par les verdicts des agences de notation. Mois après mois, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, mais surtout l’Italie, en attendant la France, affolaient les marchés qui voyaient dans un possible dérapage incontrôlé à Rome l’équivalent économique d’une explosion atomique. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne, dirigée d’une main ferme par Jean-Claude Trichet, faisait tout son possible pour éviter le drame, mais en pleine lucidité sur les limites légales, politiques mais aussi économiques de son action. J’ai parlé de votre finest hour et chacun aura reconnu l’allusion à Churchill. Par égard pour votre modestie je ne pousserai pas davantage la comparaison. Vous fûtes pressenti secrètement dès l’été 2011. Après le G20 particulièrement difficile d’octobre, votre nom était sur toutes les lèvres comme l’homme de la situation. Vous aviez une idée claire des actions à conduire. Vous aviez démontré votre force de caractère. Les grands dirigeants internationaux étaient disposés à vous accueillir les bras ouverts. Et naturellement vous inspiriez confiance aux marchés. La classe politique italienne entrait dans l’une de ces phases dont j’ai parlé, où elle était prête à se mettre en recul. Le chef de l’État s’est montré à la hauteur des circonstances. Dans la Constitution actuelle de l’Italie, le président de la République a peu de pouvoirs, sauf dans les cas où le système ne fonctionne plus. De fait, depuis deux décennies, les présidents ont reconquis un rôle essentiel. Avec une belle détermination, le président Giorgio Napolitano a procédé en deux temps. D’abord, le 9 novembre, en vous nommant sénateur à vie ce qui, avouez-le, est une façon inhabituelle de faire son entrée en politique. Quatre jours plus tard, en vous chargeant de former le gouvernement. Le Parlement ne pouvait que vous confirmer et vous donner carte blanche pour le choix de vos ministres. La logique de la situation vous a conduit à les choisir dans la société civile.
Vous avez espéré que davantage de temps vous serait donné pour changer le cap du navire italien. Ce n’a pas été le cas puisque, à peine une année s’était-elle écoulée, votre prédécesseur a tiré le tapis sous vos pieds. Votre gouvernement n’a alors pu que gérer les affaires courantes jusqu’aux élections de février 2013. Pour autant, je crois que l’histoire retiendra votre passage au palais Chigi pour au moins trois raisons. En premier lieu, vous avez rétabli l’image de l’Italie, qui a aussitôt retrouvé sa place éminente au sein de l’Union européenne et au-delà. Le trio d’un moment que vous avez formé avec Angela Merkel et, pour la France, avec Nicolas Sarkozy puis avec François Hollande, a remarquablement fonctionné et on peut dire qu’il a sauvé l’euro. Il fallait en effet que l’Italie redevienne crédible pour que puissent être adoptées les décisions institutionnelles nécessaires pour faire face aux crises du futur. Pendant le sommet européen du 29 juin 2012, vous avez surpris vos partenaires, surtout la chancelière, en manifestant un sens politique peu commun. En l’occurrence, vous avez provoqué un choc vertueux, dont les effets se sont étendus à la BCE elle-même, en exigeant de coupler les décisions portant sur le sauvetage de la zone euro d’une part et un paquet de relance économique au sein de l’Union d’autre part. Certains ont pu dire que la première décision avait plus de substance que la seconde, mais en réalité ce couplage revêt une signification stratégique. Avec des réformes de structure crédibles, on peut se permettre un peu de relance, et même on le doit pour éviter un contrecoup social. En deuxième lieu, fort de votre état de préparation, vous avez entrepris de lutter de toutes vos forces contre les déficits. D’abord, par l’impôt, quitte à assumer l’impopularité de certains d’entre eux, comme la taxation de la maison principale. Ensuite et surtout, vous avez mis en chantier plusieurs réformes, avec une célérité tellement remarquable pour accomplir la réforme des retraites que le président Sarkozy lui-même vous a exprimé sa stupéfaction et son admiration tout en vous demandant votre recette. En fait, vous avez su profiter au moment opportun de la dynamique créée par votre nomination pour ouvrir des chantiers difficiles. Dans d’autres cas, comme l’assouplissement du marché du travail, vous n’avez pu que lancer le processus. Parallèlement, vous avez pris des initiatives importantes en matière de lutte contre la corruption et contre l’évasion fiscale. Dans votre action, vous avez manifesté cette indépendance dont j’ai déjà parlé, notamment vis-à-vis des milieux d’affaires. En troisième lieu, enfin, même si vous n’avez pas eu suffisamment de temps, il semble que « le moment Monti » a effectivement marqué un changement de cap durable pour votre pays et pour l’Europe. Pour votre pays, car même si l’on manque encore de recul, les gouvernements qui ont suivi paraissent déterminés à ce que l’Italie ne perde pas le crédit retrouvé. Pour l’Europe, parce qu’aujourd’hui, dans les grands pays de la zone euro à commencer par l’Allemagne, l’engagement politique pour la monnaie unique paraît enfin consubstantiel à la volonté de poursuivre la construction européenne contre vents et marées. Pour autant, je n’y reviens pas, et vous en convenez, il reste à recaler le projet européen sur des bases plus solides sur le plan politique.
Sans doute est-il encore trop tôt pour que vos compatriotes reconnaissent pleinement l’importance de votre présidence. Il existe dans l’histoire des situations où de fortes personnalités ont laissé leur empreinte par leur exemple et leur intégrité, même si les circonstances ne leur ont pas permis d’accomplir leurs projets ou d’atteindre leur idéal. Je pense à un homme comme Pierre Mendès France qui, une soixantaine d’années après son bref passage à l’hôtel Matignon, marque encore des hommes comme Manuel Valls, notre nouveau Premier ministre. Je pense aussi à Raymond Barre. Dans votre cas, l’essentiel n’est-il pas que vous ayez redonné l’espoir à l’Italie et à l’Europe ?
Vous appartenez à une noble tradition, très développée en l’Italie, celle des intellectuels-experts , forts différents des intellectuels à la française qui se présentent comme des maîtres à penser dans tous les domaines. Intellectuels-experts ou, comme disait Altiero Spinelli, « intellectuels-politiques ». Des intellectuels dont les compétences les qualifient pour fréquenter les politiques tout en gardant leurs distances avec le pouvoir. Un pouvoir que vous avez fini par exercer.
D’où une dernière question. Êtes-vous un homme politique ? Oui, si l’on reconnaît que votre vie entière a été vouée au bien public, avec au moins deux temps forts dans le domaine de l’action, où vous avez laissé votre marque bien plus profondément que tant d’élus qui ont failli devant leurs responsabilités. Non, si l’on refuse la qualité d’homme politique à ceux qui n’ont pas consacré leur carrière à courtiser les gens pour obtenir leurs suffrages, quitte à suivre leurs troupes au lieu de les diriger. Ceux qui vous connaissent savent que vous n’avez jamais eu le goût de l’élection, et se demandent pourquoi, à l’issue de votre expérience à la tête du gouvernement, vous avez pris le risque de vous lancer dans ce territoire inconnu. Vous dites que cette aventure a permis à l’Italie d’éviter un retour en arrière. En tous cas, vous avez réussi à effectuer au moins une incursion dans la politique électorale sans d’aucune manière vous trahir vous-même.
 Je crois qu’il y a bien des manières de faire de la politique. L’essentiel, c’est d’être vrai et en adéquation avec les circonstances et leurs exigences. Sans la défaite de 1940, Charles de Gaulle aurait terminé une carrière militaire sans grand relief et le nom de Winston Churchill serait resté davantage pour ses erreurs que pour ses succès. Nelson Mandela, une des plus grandes figures du second XXe siècle, n’aurait pas marqué son pays et le monde comme il l’a fait s’il n’avait eu le génie, après des années de militance et de prison, de prôner et de pratiquer la réconciliation. Dans l’Europe qui se reconstruit cahin-caha depuis une soixantaine d’années, il y a peu de place pour la gloire. Et si les pères fondateurs dont j’ai rappelé les noms, les Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet – je sais que vous admirez particulièrement ce dernier – restent dans notre panthéon, ce n’est pas pour des actions éclatantes. Leur grandeur est d’avoir partagé une vision essentiellement juste de l’avenir de notre continent et d’avoir su faire les premiers pas pour la traduire en action. Ces pionniers étaient intègres et animés de la volonté de servir, chacun à sa façon, selon ses talents, ses capacités et les circonstances. Ils connaissaient les poisons du nationalisme et les dangers de l’exaltation. Ils comprenaient que les grandes réalisations émergent d’une accumulation de petits succès, d’une lutte permanente contre des forces centrifuges. Voilà le type humain dont l’Europe a besoin pour continuer d’aller de l’avant. Votre succès dans l’exercice du pouvoir, unique et paradoxal, est d’avoir formé un gouvernement technique qui a redonné foi dans la politique, ce dont vos successeurs ont bénéficié. Vous êtes de ces hommes dont l’Europe a besoin pour progresser. C’est pourquoi notre compagnie est fière de vous avoir coopté.
Je crois qu’il y a bien des manières de faire de la politique. L’essentiel, c’est d’être vrai et en adéquation avec les circonstances et leurs exigences. Sans la défaite de 1940, Charles de Gaulle aurait terminé une carrière militaire sans grand relief et le nom de Winston Churchill serait resté davantage pour ses erreurs que pour ses succès. Nelson Mandela, une des plus grandes figures du second XXe siècle, n’aurait pas marqué son pays et le monde comme il l’a fait s’il n’avait eu le génie, après des années de militance et de prison, de prôner et de pratiquer la réconciliation. Dans l’Europe qui se reconstruit cahin-caha depuis une soixantaine d’années, il y a peu de place pour la gloire. Et si les pères fondateurs dont j’ai rappelé les noms, les Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet – je sais que vous admirez particulièrement ce dernier – restent dans notre panthéon, ce n’est pas pour des actions éclatantes. Leur grandeur est d’avoir partagé une vision essentiellement juste de l’avenir de notre continent et d’avoir su faire les premiers pas pour la traduire en action. Ces pionniers étaient intègres et animés de la volonté de servir, chacun à sa façon, selon ses talents, ses capacités et les circonstances. Ils connaissaient les poisons du nationalisme et les dangers de l’exaltation. Ils comprenaient que les grandes réalisations émergent d’une accumulation de petits succès, d’une lutte permanente contre des forces centrifuges. Voilà le type humain dont l’Europe a besoin pour continuer d’aller de l’avant. Votre succès dans l’exercice du pouvoir, unique et paradoxal, est d’avoir formé un gouvernement technique qui a redonné foi dans la politique, ce dont vos successeurs ont bénéficié. Vous êtes de ces hommes dont l’Europe a besoin pour progresser. C’est pourquoi notre compagnie est fière de vous avoir coopté.