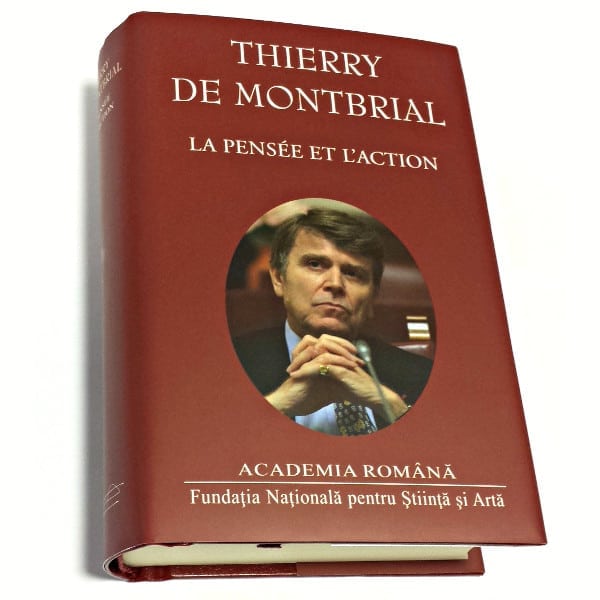L’œuvre de Michel Crozier
Allocution prononcée à l’occasion de la remise à Michel Crozier de son épée d’académicien des sciences morales et politiques le 24 mai 2000
J’ai l’agréable tâche, après Georges Vedel, d’évoquer votre beau parcours devant vos amis ici rassemblés et devant nos confrères. Vous êtes issu d’une famille, m’avez-vous dit, unie, modeste et sympathique. Votre père a fait partie de ces héroïques malheureux qui, en raison de la Grande Guerre, ont passé huit ans sous les drapeaux. Du moins s’en est-il bien sorti et a-t-il pu bâtir et faire vivre sa petite entreprise commerciale. Vous êtes né le 6 novembre 1922, avez passé l’essentiel de votre enfance à Clamart, fait de bonnes études au lycée Michelet ; et peut-être votre entrée à l’École des hautes études commerciales (HEC) – qui n’était pas encore la grande école qu’elle est devenue – correspondit-elle plus aux aspirations de votre père qu’aux vôtres. Du moins avez-vous complété votre bagage initial par une licence de lettres qui vous a permis, le moment venu, de faire une thèse. Mais à l’époque vous n’envisagiez pas une évolution de type universitaire et vous n’imaginiez pas que vous deviendriez un sociologue. C’est le hasard, selon vous, qui en a décidé ainsi. Mais, dans pareilles matières, le hasard est-il vraiment le maître ? Quoi qu’il en soit, c’est votre approche bien personnelle de la sociologie – vous n’êtes ni normalien ni philosophe – qui fera de vous un chercheur original, un « chercheur de terrain » comme vous aimez à vous définir. Original, vous l’êtes en effet complètement, et vous le resterez. Vous vous moulerez dans une situation d’exception, un rôle de maverick, et vous occuperez une place à part dans l’Université et dans la société française. En France, on classe les gens de façon impitoyable et définitive. Mais on tolère tout de même quelques exceptions, quelques personnalités « bizarres », jusqu’à les admettre, parfois, à l’Institut de France !
Le premier tournant de votre vie se situe en 1947. Vous bénéficiez d’une bourse du ministère des Affaires étrangères pour passer une année aux États-Unis. Vous êtes alors, disons-le, un petit peu gauchiste sinon trotskiste. Vous choisissez d’étudier sur place les syndicats ouvriers américains. Ainsi entreprenez-vous une sorte de pèlerinage à travers l’Amérique, dont sortira une thèse de droit. Vous apprenez beaucoup. D’abord, bien sûr, vous découvrez l’Amérique elle-même, et dans sa profondeur. Vous vous passionnez pour la technique des interviews, et vous vous forgerez progressivement une sorte de devise qui résume bien votre philosophie : écouter, comprendre, agir. Vous devenez sociologue par la pratique. L’apprentissage dans les livres suivra.
De retour en France, vous voilà engagé pour une année comme « rédacteur » par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), une organisation marquée notamment par la Belgique et par l’Allemagne, et qui se rattache à la gauche non communiste dans laquelle vous vous situez résolument. C’est à cette époque que vous rencontrez Daniel Bell, un intellectuel américain dont les idées vous attirent et qui se rendra célèbre par un livre sur la fin des idéologies . Il jouera un rôle important dans la détermination de votre trajectoire.
En 1950, vous postulez au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à un moment où cette organisation est encore très ouverte, du moins dans le domaine des sciences sociales, et donc accessible à des personnalités un peu marginales. On pouvait y entrer assez facilement, pourvu que l’on eût un programme. Votre sujet était réellement iconoclaste, puisque vous vous proposiez de comprendre pourquoi une catégorie sociale fort importante, les employés de bureau, était apparemment dépourvue d’une « conscience de classe ». Selon les dogmes marxistes dominants à l’époque (et encore aujourd’hui, chez beaucoup de nos intellectuels, quoique sous une forme édulcorée), ils auraient dû en avoir une. Votre penchant pour la réalité, votre expérience américaine, la maturité commençant à venir, tout cela vous conduisit à explorer concrètement les difficultés du marxisme.
Vous décidez donc d’aborder la question, comme vous dites, avec la méthode américaine reprise par une tête française. Vous vous proposez d’« aller sur le terrain » et de vous entretenir individuellement avec de nombreux employés de bureau, en fait essentiellement des femmes. Pour effectuer votre enquête, il faut évidemment surmonter maints obstacles et de multiples réticences sinon résistances. Vous y parvenez, et découvrez avec joie que vos interlocuteurs ou plutôt interlocutrices sont ravies d’être traitées comme des personnes. Vous cultiviez la passion de l’écoute, et elles aimaient que l’on s’intéressât à elles. Vous commencez alors à entrevoir la solution de votre problème. La clé du comportement des employés de bureau, c’est l’organisation où se déploie leur activité. Vous découvrez que le système est articulé autour de chefs intermédiaires qui ont intérêt à fausser les informations pour que tout le monde reste tranquille, au-dessus et au-dessous. Ainsi s’établit un équilibre effectivement tranquille, mais agressif en ce sens que tout le monde est également frustré. Vous démontrez que l’organisation est plus importante que la classe. Cette idée fondamentale, vous allez la poursuivre, en creusant l’importante littérature, principalement américaine, sur les organisations, mais surtout en approfondissant votre propre pensée, toujours nourrie de travaux empiriques constamment actualisés. Beaucoup d’intellectuels français, marxistes et déterministes, peu respectueux des faits, ne vous pardonneront pas cette liberté d’esprit qui fait aussi votre grandeur.
Votre enquête sur les employés de bureau déclenche un processus qui aboutira, en 1963, à la thèse sur Le Phénomène bureaucratique dont le rapporteur – bien évidemment critique – sera Raymond Aron. Cette thèse sera rapidement prolongée par un livre publié sous ce titre . Cet ouvrage connaîtra le succès. Vous aimez rappeler que sa première version a été rédigée en anglais, ce qui a eu une importance considérable sur sa carrière. Grâce à Daniel Bell, en effet, vous avez passé l’année 1959-1960 au Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences, de l’université de Stanford. Vous y ferez plus tard, en 1973-1974, un second séjour. Je me souviens précisément de la visite que mon épouse et moi vous fîmes, à Stanford, au mois d’août 1974, alors que nous nous trouvions nous-mêmes pour un bref séjour à l’université voisine et rivale de Berkeley. Le jeune directeur du Centre d’analyse et de prévision (CAP) du Quai d’Orsay que j’étais alors brûlait d’envie de faire votre connaissance et de bénéficier de vos lumières. C’était au moment de la démission du président Nixon, victime de l’affaire du Watergate qu’il avait imprudemment enclenchée. Comme au célèbre Institute for Advanced Studies de Princeton, qui abrita des personnalités aussi éminentes qu’Einstein, Oppenheimer, Gödel ou même un « politologue » comme George Kennan, les chercheurs invités à Stanford y bénéficient – mais seulement pour une période limitée – de conditions de vie et de travail confortables. Ils ne sont assujettis à aucune obligation. Ils bénéficient de l’assistance d’un « éditeur » à demeure, un atout considérable, particulièrement pour un étranger, même lorsqu’il maîtrise bien l’anglais. Le fait que votre livre ait été rédigé directement dans cette langue (en fait, vous l’avez écrit deux fois, une fois en français, une fois en anglais), et non pas traduit, a constitué une différence sensible, tant il est vrai que la langue influe sur la pensée. En outre, sa publication aux États-Unis lui a permis d’être immédiatement accessible aux chercheurs américains parmi lesquels votre réputation prenait déjà de l’ampleur. En fait, la notoriété américaine et bien évidemment française du Phénomène bureaucratique se prolonge jusqu’à nos jours. Pareille longévité est la marque d’une grande œuvre. Vous aimez rappeler que l’« organisation » est une invention essentielle et évidemment très ancienne de l’espèce humaine. Elle se manifeste typiquement dans les armées. Au Moyen Âge, le système des Templiers et de la Hanse a reposé sur une remarquable organisation. On pourrait aussi citer l’Église catholique romaine. Vous démontrez que l’organisation est inséparable du phénomène du pouvoir. Selon vous, le pouvoir consiste dans le contrôle d’une source d’incertitude sur le résultat des actions de ceux qui le subissent. Vous vous attachez à tirer toutes les conséquences de cette définition.
À partir de là, vous décidez de devenir vous-même un organisateur. Vous allez bâtir – au sein du CNRS – un institut de recherche, le Centre de sociologie des organisations (CSO), que vous dirigerez de 1961 à 1993. À cette date, vous passerez la main au successeur de votre choix, Erhard Friedberg, avec qui vous avez publié en 1977 un livre important, L’Acteur et le Système . C’est à lui que l’on doit la cérémonie d’aujourd’hui. Vous êtes, légitimement, fier de cette expérience institutionnelle, et ce, à plusieurs titres. D’abord, parce que vous formez ainsi une petite équipe – pour ne pas dire des disciples – qui démultiplie votre capacité créative. Vous y parvenez malgré la modicité de vos moyens. Cette équipe – qui associe des doctorants à demeure et des non-chercheurs en leur procurant un environnement favorable – travaille aussi bien sur la théorie que sur les applications. Vous parvenez à intéresser certaines administrations à vos travaux, en vous intéressant à elles. Le temps me manque pour évoquer par exemple votre diagnostic du ministère de l’Équipement à propos d’une question aussi fondamentale que celle de savoir s’il est possible de réformer une organisation de l’intérieur. Il faut souligner, au passage, qu’une des constantes de votre vie a été de chercher à faire œuvre utile pour la Cité. Non pas à la façon de ces philosophes-idéologues qui, à l’instar de Marx, Sartre ou, de nos jours, Bourdieu, prétendent faire de la résistance contre une modernité qu’ils exècrent, et rêvent de changer le monde. Mais, plus modestement, dans la lignée de vos premières études sur les employés de bureau, en vous efforçant de traiter des problèmes concrets bien délimités. Ce qui ne vous empêche pas de procéder par induction – une méthode que vous préférez à la pratique trop française de la déduction – et d’émettre par exemple sur la société française dans sa totalité d’impressionnantes vues d’ensemble. J’y reviendrai dans un instant.
Dans les années suivantes, cet aspect « utile » de vos recherches – vous n’avez pas honte de ce mot – se conjugua harmonieusement avec votre activité au sein de la revue Esprit dont vous étiez proche, et surtout dans le Club Jean-Moulin, auquel vous avez participé dès sa création en 1958. Vous faisiez alors partie de ceux qui craignaient – à tort, comme la suite l’a montré – que le général de Gaulle n’entamât, malgré son âge, une carrière de dictateur… Une troisième raison pour laquelle vous êtes attaché à votre centre est qu’il a constitué, pour vous-même, une sorte de terrain d’expérimentation sur les relations de pouvoir au sein d’une organisation. Vous avez appris combien il est difficile de « gouverner » une équipe de chercheurs, particulièrement dans le domaine des sciences sociales, où aucun grand équipement n’exerce de contraintes naturelles sur le comportement des individus. Vous avez eu à faire face à des situations de conflits, et nous devrions tous savoir qu’une chose est de parler théoriquement de ces questions, ou même d’analyser les conflits des autres, une autre est de les vivre. Rares sont les personnes qui gardent la tête froide et donc leur faculté de juger quand les conflits les atteignent personnellement. Voilà pourquoi les meilleurs analystes font rarement de grands chefs, les meilleurs stratégistes rarement de grands stratèges. Cela dit, comme vous l’enseignez, il n’y a pas d’organisation sans conflits, ni conflits vivables sans organisation. L’organisation crée le conflit, et le conflit crée l’organisation. Le succès, expliquez-vous, consiste à comprendre et à orienter les énergies afin que les conflits deviennent vivables. En vous frottant vous-même à l’action, vous avez donné à vos travaux un surcroît d’épaisseur humaine et de rayonnement. Ce n’est pas le moindre de vos accomplissements.
Cette sorte de « mixité » qui fait votre originalité, on la retrouve encore dans la façon dont vous avez vécu les fameux « événements » de 1968. Cette année-là, l’université Harvard – où vous aviez donné des cours dès 1966 – vous proposa une chaire de sociologie. Vous auriez pu accepter une offre aussi confortable que prestigieuse, et vous auriez alors coulé des jours protégés dans ce temple du savoir mondial. Mais vous n’entendiez pas céder à la facilité et vous ne vouliez pas renoncer à l’aiguillon de l’incessant parcours du combattant d’une vie professionnelle en France. Vous enseignez à Harvard, et dans d’autres universités américaines, mais par intermittence. En tout cas, c’est aux États-Unis que vous faites, sur le tard, vos premières expériences de professeur. Je vais y revenir. En 1968, le hasard, qui parfois fait bien les choses, vous ramène à Paris au mois de mai. Vous aurez donc vécu à la fois l’agitation américaine et la nouvelle révolution française. À cette époque, je me trouvais moi-même à Berkeley. Je me souviens de la couverture d’un numéro du magazine Newsweek. On pouvait lire : « French Revolution, 1789-1968 ». Quel extraordinaire épisode que celui de 1968 ! Trente ans après – on a pu le constater –, toute la lumière était loin d’être faite, et les interprétations en restaient multiples et contradictoires. Fidèle à votre méthode – observation minutieuse du terrain et généralisation par induction –, vous en tirez des enseignements dont la pertinence demeure intacte. En 1970, vous publiez votre best-seller, La Société bloquée (soixante-dix mille exemplaires !) qui a notamment inspiré Alain Peyrefitte dans son fameux ouvrage sur Le Mal français . Alain Peyrefitte fut l’un de vos admirateurs et l’un de ceux qui vous ont permis de rejoindre enfin notre Compagnie. De votre côté, vous avez admiré sa passion politico-sociale et son respect pour l’activité intellectuelle, sa formidable capacité de travail.
La Société bloquée est en fait une reprise de travaux antérieurs, sous un titre fort heureux que vous avez emprunté, avec bien sûr son accord, à votre ami Stanley Hoffmann (dans un livre de 1963 qu’il a dirigé et intitulé In Search of France ). Ces travaux avaient d’ailleurs eu un grand impact, avant même la publication de l’ouvrage. Bien des avancées de l’époque y ont puisé en partie leur inspiration. La plus célèbre est certainement le discours de Jacques Chaban-Delmas du 16 septembre 1969 . « Le malaise que notre mutation accélérée suscite, disait Chaban, tient pour une large part au fait multiple que nous vivons dans une société bloquée. […] Nous supportons aujourd’hui le poids d’un long passé. […] L’État est tentaculaire et en même temps inefficace. Par l’extension indéfinie de ses responsabilités, il a peu à peu mis en tutelle la société française tout entière. […] Le renouveau de la France après la Libération a consolidé une vieille tradition colbertiste et jacobine, faisant de l’État une nouvelle Providence. […] Ces déformations et ces malfaçons sont le reflet de structures sociales, voire mentales, encore archaïques ou trop conservatrices. […] Nous ne parvenons pas à accomplir des réformes, autrement qu’en faisant semblant de faire des révolutions. […] Il y a peu de moments dans l’existence d’un peuple où il puisse, autrement qu’en rêve, se dire : quelle est la société dans laquelle je veux vivre ? J’ai le sentiment que nous abordons un de ces moments. Nous pouvons entreprendre de construire une nouvelle société, prospère, jeune, généreuse et libérée. » Ainsi parlait Chaban. Et il a été remercié. Son discours reste actuel, comme, dans un style moins lyrique, le rapport Rueff-Armand de 1960 . Ce discours était imprégné de vos travaux. La France, expliquez-vous dans votre ouvrage de 1970, dispose de ressources considérables, mais elle ne parvient pas à en tirer complètement parti. Son système éducatif est bloqué « à gauche » (c’est l’Éducation nationale) et « à droite » (les grandes écoles). La haute administration dispose d’un pouvoir (au sens précis que vous donnez à ce terme) tout à fait excessif, c’est-à-dire que toutes les décisions lui « remontent » (vous vous montrerez ultérieurement fort critique de la décentralisation des années 1980). En même temps, la base syndicale dispose d’une extraordinaire capacité de résistance. Encore une fois, ce qui fait l’originalité de vos analyses, c’est votre regard objectif, dépourvu autant qu’il est possible de biais idéologiques. Rien de ce que vous – et Chaban – dénonciez n’a fondamentalement changé, malgré la pression de l’Europe et de la mondialisation. Ce qui a changé, c’est le monde des entreprises. Mais cela ne suffit pas.
Comme chercheur, comme « militant civique » dans les années 1960, vous avez toujours préféré le débat pour convaincre. En ce sens, vous avez enseigné toute votre vie. Mais ce n’est qu’en 1967, donc à l’âge de quarante-cinq ans, que vous avez fait, à Harvard, votre première expérience de professeur au sens propre. C’est donc à travers les lunettes américaines que vous avez découvert ce beau métier, en enseignant le fruit de vos propres recherches, en engageant avec vos étudiants un véritable dialogue, en les aidant à « accoucher » de leurs propres idées, en les jugeant sur des travaux originaux qui vous ont de fait beaucoup apporté. Ainsi vos élèves vous ont-ils convaincu que le phénomène bureaucratique n’était pas l’apanage de la France et que les États-Unis n’en étaient pas exempts. En retournant à Harvard en 1980, vous serez d’ailleurs déçu par l’évolution de l’Amérique et vous publierez, en français, un livre intitulé Le Mal américain – malheureusement traduit seulement en 1985, au moment du formidable réveil de l’esprit d’entreprise (à travers notamment l’impressionnante révolution du management) commencé dans les années Reagan. Vous avez analysé ultérieurement ce phénomène qui doit beaucoup à la flexibilité du système américain de l’enseignement et de la recherche. Pour revenir à votre propre enseignement, vous avez essayé de le transposer en France, à Nanterre où vous aviez été élu, initialement sans succès. Vous parviendrez cependant à faire bouger les choses dans le cadre du DEA de sociologie des organisations de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris auquel vous consacrerez beaucoup de vos efforts à partir de 1972.
J’aurais aimé évoquer plus en détail vos articles et vos nombreux livres aux titres éloquents tels que On ne change pas la société par décret, État modeste, État moderne, plusieurs fois réédité, L’Entreprise à l’écoute : apprendre le management post-industriel, ou, tout récemment, Quand la France s’ouvrira . Les années n’ont en rien altéré votre ardeur pour l’innovation et la réforme. Le changement, dites-vous, est fait d’une bonne utilisation du hasard. Comme les mutations génétiques, en quelque sorte, avec le facteur humain en plus. Pour saisir les occasions, il faut être préparé. Lors d’une communication devant notre académie, le 10 janvier 2000, vous nous avez démontré que le changement de raisonnement était la clé de la réforme de l’État. À une époque où l’on affirme volontiers qu’une formation « tout au long de la vie » est nécessaire, chaque individu doit régulièrement remettre en question ses modes de raisonnement et réfléchir de façon critique sur ses propres échecs. Il faut, selon vous, faire travailler les gens sur leurs responsabilités antérieures. L’oeuvrAinsi en revenons-nous toujours à la question fondamentale de l’enseignement.
Vous donnez l’image même du regard vers l’avant, du mouvement, et donc de la jeunesse. Dans votre allocution de remerciement pour le prix Tocqueville, qui vous a été décerné en 1997, vous osiez dire : « Dans la conjoncture morale si difficile que nous traversons, des premières lueurs d’espoir apparaissent qui viennent non pas de choix et de décisions politiques volontaires mais de la marche même de cette mondialisation que nous craignons si fort. » Je partage votre optimisme raisonné. Et puisqu’il faut conclure, je dirai simplement combien nous sommes heureux de vous compter parmi nous et combien je suis heureux de vous dire ce soir mon admiration et mon affection.