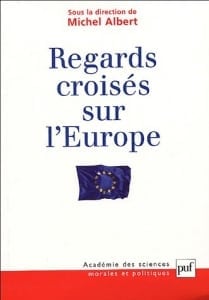La question turque
Communication à l’Académie des Sciences Morales et Politiques le 4 juin 2004
La dernière vague d’élargissement de l’Union européenne, célébrée le 1er mai 2004, a porté de quinze à vingt-cinq le nombre des Etats-membres. Elle a été largement saluée par les peuples concernés comme un grand pas vers la reconstruction de ce que géographes et historiens appellent vaguement notre « continent ». Avec l’adjonction de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007, nous serons bientôt vingt-sept, sans compter vraisemblablement plus tard la Croatie, puisque la Commission de Bruxelles a émis un avis favorable à l’ouverture des négociations et qu’il ne s’agit pas d’un gros morceau. Après la Croatie, la Macédoine se profile déjà à l’horizon et, derrière elle, d’autres pays issus de l’éclatement de la Yougoslavie jadis soumis à la domination ottomane. Pour caractériser ce vaste ensemble en voie de formation, le mot hétérogénéité me paraît actuellement plus juste que celui, certainement plus rassurant et pour cela fréquemment employé : diversité. C’est que l’hétérogénéité peut diviser, alors que la diversité peut unifier. Géographes, historiens et poètes ne chantent pas l’hétérogénéité mais la diversité de la France, par exemple de ses paysages. L’Union européenne qui se forme sous nos yeux a, certes, le charme de la diversité. Mais en accroissant la sphère culturelle de l’orthodoxie et en continuant d’internaliser les Balkans – cela a commencé avec la Grèce — on a bel et bien introduit une redoutable hétérogénéité. Le défi le plus immédiat est l’adoption d’une Constitution. Le terme est controversé chez les juristes, mais il explicite la volonté de bâtir une unité politique d’un type nouveau, qu’aucun des concepts classiques, tels que Etat-nation, fédération ou confédération, ne saurait proprement qualifier. Cette Constitution doit fixer clairement le rôle comme le fonctionnement des institutions, ainsi que la répartition des compétences entre l’Union et les Etats-membres. Trois questions hantent les esprits : le compromis qui résultera des tractations en cours permettra-t-il en pratique et sur la durée une gouvernance efficace ? Quelles sont les chances d’une ratification de ce texte à l’unanimité ? Que se passerait-il dans l’hypothèse où ce résultat se révèlerait hors d’atteinte dans un laps de temps raisonnable ?
Tel est le contexte dans lequel se pose aujourd’hui la question turque. Non, certes, qu’elle ait surgie brusquement du néant. L’énumération des engagements réciproques entre la Turquie d’une part, la Communauté puis l’Union européenne de l’autre, serait longue et fastidieuse. Il suffit de rappeler que, depuis le traité d’association de 1963, les deux parties se sont toujours placées dans la perspective d’une adhésion. Il est permis de louer les capacités de la tradition diplomatique issue de l’Empire ottoman ou, au contraire, d’incriminer la médiocrité des négociateurs européens, mais le fait est là. Dans la vie des nations, on ne peut sans risque majeur faire table rase des conventions ou des traités. Pour s’en tenir au passé récent, la candidature de la Turquie a fait l’objet au moins une fois par an, depuis décembre 1997 à Luxembourg, de déclarations précises du Conseil européen, l’instance la plus élevée de l’Union. Le contenu de ces déclarations est toujours le même : la demande de la Turquie sera jugée à l’aune de critères objectifs, comme pour les autres candidats. Ces critères, formulés à Copenhague en 1993, portent essentiellement sur la démocratie et l’Etat de droit, les droits de l’homme, le respect et la protection des minorités, mais aussi sur les structures économiques. C’est à partir du Conseil d’Helsinki, en décembre 1999, que la Turquie est entrée dans la phase dite de « pré-accession ». Le Conseil de Copenhague, trois ans plus tard — au lendemain des élections législatives qui ont chassé les formations traditionnelles disqualifiées et porté au pouvoir le « parti de la justice et du développement » (AKP) de Recep Tayyip Erdogan —, a rappelé ses positions antérieures et encouragé Ankara à poursuivre vigoureusement ses réformes pour satisfaire aux fameux critères. Étant donné que ce parti se réclame des valeurs de l’Islam, la position du Conseil européen n’était pas innocente. Depuis lors, l’AKP a tout fait pour se présenter comme une sorte de « démocratie musulmane », comme on parle de la « démocratie chrétienne » et, au grand étonnement de nombreux observateurs, son gouvernement a accéléré le rythme des réformes — prenant ainsi à revers le « parti républicain du peuple » (CHP) héritier d’Atatürk — en acceptant sans sourciller les missions intrusives des escouades d’inspecteurs issues de la Commission. Grande aussi fut la surprise de voir Ankara soutenir avec succès le plan onusien de réunification de Chypre, finalement rejeté par les Grecs. Le calendrier est clair : fin septembre, sous la responsabilité de Günter Verheugen, la Commission fera connaître son évaluation des progrès accomplis. Elle l’a fait récemment pour la Croatie en émettant des réserves tout en donnant un avis favorable. Au Conseil européen de décembre à Dublin, sur la base de ce rapport, la Commission se prononcera sur l’ouverture des négociations d’adhésion. A ce stade de l’exposé, il convient de souligner que pareilles négociations sont par nature longues et extrêmement détaillées, puisqu’au-delà des critères de Copenhague elles portent sur l’ensemble de l’acquis communautaire, réparti en trente et un chapitres. S’agissant d’un pays aussi grand et complexe que la Turquie, il est évident que la durée et même l’issue du processus ne sont pas déterminées à l’avance.
Comment dans ces conditions expliquer que, depuis bientôt deux ans, élites et opinions publiques européennes, particulièrement en France, soient entrées en guerre contre et beaucoup plus rarement pour la Turquie, comme s’il s’agissait de se prononcer sur un prochain référendum pour rejeter ou ratifier un traité d’adhésion déjà négocié et signé par les Etats-membres ? La réponse se rattache directement à ce par quoi j’ai commencé : la peur. L’effondrement de l’Empire soviétique et, avec lui, celui de l’Empire russe, ont provoqué un énorme déséquilibre que l’élargissement de l’Union européenne et celui de l’OTAN ont visé à réduire au risque d’affaiblir ces deux institutions, surtout la première qui n’a pas de leader. Peur donc de ne pas digérer le passage, non pas de 15 à 25, mais de 12 à 27, et de voir ainsi sombrer l’aventure commencée avec la CECA et l’Euratom. Jusque-là, la question turque était effectivement posée mais, sauf pour une infime minorité, elle restait abstraite. Ce n’est plus le cas depuis le 1e mai 2004 et avec la perspective rapprochée de l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. En 2007, à l’Est de l’Union, les pays limitrophes seront, du Nord au Sud : la Russie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie et la Turquie. Seule la dernière a fait acte de candidature et, comme on l’a vu, depuis longtemps. Notons incidemment que, du côté occidental, il ne manquera plus que la Confédération helvétique, laquelle n’est pas encore disposée à se jeter à l’eau, ainsi que la Norvège, dont la population a par deux fois rejeté l’adhésion. Tout cela explique pourquoi et comment des observateurs ou des parties impliquées, passablement inattentifs ou distraits dans le passé, ont brusquement pris conscience de la réalité de la candidature turque. Or la Turquie elle-même fait peur. L’évocation des Turcs renvoie à un passé lointain, et confus sinon pour quelques poignées d’érudits et pour une fine couche de lecteurs de René Grousset, de Jean-Paul Roux ou de Robert Mantran. Pour beaucoup, les Turcs font penser à Attila et à ses équivalents du côté de la Chine ou, après quelques siècles, à Gengis Khan, plus tard encore à Tamerlan ; à des empires bâtis par la force ici et là sur l’ensemble du continent eurasiatique, aux croisades et aux Seldjoukides, à l’Empire ottoman, la prise de Constantinople, la grandeur terrifiante d’un Soliman le Magnifique qui voulait conquérir l’Europe; à cet « homme malade » dont avait parlé le tsar Nicolas Ier, au panturkisme; enfin à la République autoritaire construite par Atatürk au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ce qui domine, dans cet album, c’est l’image d’un adversaire redoutable, engloutisseur de civilisations (ce qui est historiquement caricatural mais peu importe) et ce, en ce qui concerne la France, malgré l’alliance de revers audacieusement conclue par François Ier. La Turquie fait peur parce qu’aujourd’hui, avec une population de l’ordre de 70 millions d’habitants et une démographie en expansion, elle aurait vocation à disposer du groupe le plus nombreux au Parlement européen. Surtout, elle est de religion musulmane. Et, plus encore depuis le 11 septembre 2001, l’Islam fait peur. On voit bien, dans notre France qui ne jure que par la laïcité, au point de s’être opposée à toute référence chrétienne dans le préambule du projet constitutionnel, combien il est difficile de concevoir une laïcité qui, si l’on ose dire, ne soit pas chrétienne. Enfin, on a peur des effets combinés des disparités économiques et de la libre circulation, sans toujours comprendre que l’intégration économique selon des règles précises est un puissant réducteur des inégalités de développement, et que de longues périodes de transition sont possibles en ce qui concerne les mouvements de personnes ou de biens. Face à ces peurs où tout se mélange, on en revient inéluctablement à l’interrogation la plus fondamentale : qu’est-ce que l’Europe ?
Avec son sens aigu du moment opportun, Valéry Giscard d’Estaing, alors président de la Convention sur l’avenir de l’Europe, a lancé le débat en jetant un pavé dans la mare le 7 novembre 2002, à l’occasion d’un entretien avec des journalistes. Ramené à l’essentiel, son propos tient en une phrase lapidaire : « La Turquie est un pays proche de l’Europe, un pays important, qui a une véritable élite, mais ce n’est pas un pays européen ». En conséquence, en la faisant entrer, ce serait « la fin de l’Union ». Pour l’ancien président de la République française, qui visait implicitement la Grande-Bretagne : « ceux qui ont le plus poussé à l’élargissement en direction de la Turquie sont les adversaires de l’Union européenne ».
Impossible, donc, d’échapper à une réflexion sur l’identité de l’Europe. Mais avant de formuler quelques remarques à ce sujet, je voudrais m’arrêter un instant sur l’histoire du projet de l’Union européenne. Celui-ci n’a jamais été explicitement formulé d’une manière commune à tous les Etats-membres. Dans la mesure où il l’a été implicitement, par exemple à travers les critères de Copenhague de 1993, cela n’a jamais été pour exclure a priori tel ou tel pays. Sans doute peut-on identifier une vision – inspirée par la démocratie chrétienne — chez les pères fondateurs de l’Europe des Six. Les pères fondateurs ont eu des disciples. Leur vision a fait école. Mais un homme d’État comme le général de Gaulle n’y a pas souscrit, et elle n’a jamais été traduite dans un traité. Paradoxalement en apparence, de Gaulle s’est opposé par deux fois à l’entrée de la Grande-Bretagne, qui ne pouvait selon lui que dénaturer la Communauté. L’interdit a été levé par Georges Pompidou, et bien malin celui qui aurait pu décrire le projet commun de l’Europe des Neuf. Puis il y eut l’élargissement des années 1980, à la Grèce, à l’Espagne et au Portugal. Avec la péninsule ibérique, on n’a pas altéré la nature du processus d’intégration, contrairement au cas de la Grande Bretagne. Avec la Grèce, on a introduit un nouveau changement, même si on en a peu parlé à l’époque, en raison de la modestie du poids relatif de ce pays selon les critères quantitatifs habituels (superficie, démographie, PIB, etc.). En l’acceptant en 1981, la Communauté s’est scindée en deux morceaux, séparés par un ruban d’États alors communistes. Surtout, elle a débordé de la souche culturelle issue de la Chrétienté d’Occident. Non seulement la porte a été ouverte à un univers culturel très différent, celui de l’autre Chrétienté, mais encore et peut-être surtout à l’univers, à la fois plus vaste et plus flou, de l’Orient en général. Malgré la langue, ce n’est pas la Grèce de Périclès qui a rejoint la Communauté, mais une unité politique marquée par quatre siècles de domination ottomane, et qui n’avait acquis son indépendance que cent cinquante ans plus tôt. On dira qu’une partie de l’Espagne a été musulmane pendant plusieurs siècles. Mais la Reconquista, commencée au XIe siècle et largement accomplie au XIIIe, était complètement achevée à la fin du XVe, il y a donc plus de cinq cents ans. En termes d’effets résiduels, la différence est immense. À une échelle de temps encore nettement supérieure, la civilisation musulmane a presqu’entièrement effacé la civilisation de l’Égypte ancienne. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que c’est l’adhésion de la Grèce, voulue par Valéry Giscard d’Estaing, qui a ouvert la possibilité de celle de la Turquie.
Au lendemain de la disparition de l’URSS, une nouvelle vague d’élargissement a étendu l’Union à l’Autriche, la Finlande et la Suède, trois pays neutres. Pour celle-ci, la neutralité reste quasiment constitutive d’une identité nationale forte. L’entrée de la Suède a renforcé le camp de ceux, comme le Royaume-Uni et le Danemark, qui voient dans l’Union une organisation internationale somme toute comme une autre. La neutralité de la Finlande et de l’Autriche était directement liée aux circonstances de la Guerre froide. Celle de la Suède a des fondements plus anciens. Dans ces conditions, la diversité de l’Europe a augmenté, mais aussi peut-être son hétérogénéité, compliquant a priori encore un peu plus le problème de la défense commune.
Pour compléter l’analyse, il faut répéter que, parmi les pays qui composent la nouvelle frontière orientale de l’Union, seule la Turquie est candidate. La Russie ne l’est pas, pour au moins trois raisons essentielles. Tout d’abord, elle se considère comme une puissance à la fois européenne (depuis Pierre le Grand) et asiatique (depuis toujours), ce qu’elle ne manque jamais de rappeler dans ses rapports avec les États de l’Asie. Ensuite, elle estime, certainement à juste titre, que sa liberté de manœuvre est plus grande en agissant comme un partenaire, aussi bien de l’Union européenne que de l’Alliance atlantique. Enfin, et c’est une différence majeure avec la Turquie : à l’exception sans doute d’une minuscule couche au sein de ses élites, elle n’est nullement disposée à se soumettre aux disciplines draconniennes imposées pour la pré-candidature. Quant aux autres pays, la Biélorussie, l’Ukraine et bientôt la Moldavie, aucun n’est actuellement en mesure de se porter candidat, même si beaucoup d’Ukrainiens, en particulier, se sentent fortement attirés par l’Occident.
Il est temps de revenir à la question de l’identité de l’Europe. Je crois qu’il n’existe aucune façon objective ou, si l’on préfère, universelle, d’y répondre. Cette question est en effet par essence géopolitique. Ici, il importe de donner aux mots une valeur précise. Je définis la géopolitique comme la partie de la géographie politique qui s’occupe des idéologies relatives aux territoires (1) . Le propre d’une idéologie est d’être temporairement partagée par un groupe, d’étendue limitée.
Ainsi toute tentative de donner à l’Europe des « frontières naturelles » est-elle vouée à l’échec. L’Oural et même le Caucase, les détroits du Bosphore et des Dardanelles ne constituent des limites que par le regard qu’on leur porte. À la fin du XIXe siècle, Anatole Leroy-Beaulieu remarquait que l’Oural n’est en rien une barrière. Pourquoi les Ossètes du Nord (Russes) seraient-ils européens, et ceux du Sud (Géorgiens) asiatiques ? En quoi l’Anatolie occidentale serait-elle physiquement moins européenne que la Grèce, et pourquoi trouverait-on naturel de rattacher Chypre, sous prétexte qu’elle est une île, à l’Europe, alors qu’à la même longitude Ankara appartiendrait à l’Asie ? De même, un bornage fondé sur des considérations historiques et culturelles peut être pour certains subjectivement décisif — comme pour ceux qui voulurent l’entrée de la Grèce dans la Communauté après la chute du régime des Colonels —, mais jamais objectivement, pour deux raisons complémentaires : d’abord, par définition, un tel bornage se réfère au passé et plus précisément à des discours sur le passé ; ensuite, ces discours s’appuient sur des raisonnements ad hoc et donc non falsifiables au sens de Karl Popper, ou alors s’ils sont falsifiables ils sont aisément falsifiés. Sur ce point comme sur tant d’autres, je me range résolument à l’opinion de Paul Valéry. L’histoire justifie tout et son contraire. Ce qui ne réduit en rien son importance. Il ne s’agit pas en effet de sous-estimer le poids du passé sur le présent et sur l’avenir. Ce qui est en cause, c’est le déterminisme qui ferait dépendre le futur du passé, comme si les innovations et la liberté humaine n’avaient pas d’influence sur la construction du futur. Or les générations actuelles vivent une transformation du monde dont l’intensité et l’étendue sont sans précédent. Pour s’en tenir au cas de la seule France, nos repères ont déjà volé en éclat avec la déstructuration de la famille et de l’école, ou encore la disparition du service militaire obligatoire. Qu’on le veuille ou non, que la Turquie entre ou non dans l’Union européenne ne changera pas le fait qu’avec 8 % de musulmans nous sommes déjà devenus un pays multi-ethnique ou multi-communautaire. Tôt ou tard, il faudra bien reconnaître que le modèle « républicain » du peuple français un et indivisible a vécu. D’où, à mon sens, la vraie question : comment la France peut-elle changer, tout en restant elle-même, et comment l’Europe, qui la contient, peut-elle s’inventer en tirant le meilleur parti, non pas de l’Europe, mais des Europes du passé.
Si l’on veut se placer sur un terrain solide, il faut regarder non pas l’histoire de l’Europe, mais celle de l’idée d’Europe. Jean-Baptiste Duroselle l’a fait dans un texte intitulé « la genèse de l’idée européenne » (2). On y voit flotter le mot « Europe » depuis son apparition, dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ, dans le sens d’une simple péninsule de l’Asie aux limites orientales arbitraires, jusqu’au chaos du premier XXe siècle dont est issu le dernier des grands projets géopolitiques européens, celui que nous regardons tous avec un mélange d’espérance et de scepticisme et qui, à l’exception notable des Etats-Unis entièrement tournés vers eux-mêmes, exerce une fascination croissante sur le reste du monde.
À défaut de trouver une réponse incontestable à la question de l’identité de l’Europe, peut-on au moins caractériser le projet géopolitique actuel de l’Union européenne ? Il me semble que la réponse est positive et tient dans quelques concepts interdépendants au point de former un système : réconciliation ; démocratie, droits de l’homme, Etat de droit, respect et protection des minorités ; laïcité ; sécurité ; solidarité ; économie de marché.
Je me limiterai ici à quelques brèves remarques sur trois points particulièrement importants pour la question turque : le lien entre démocratie et minorités, la laïcité et la réconciliation.
À l’époque de l’Empire ottoman, fonctionnait le système des millets, par lequel les minorités disposaient d’une large autonomie, en contrepartie de quoi leurs chefs étaient personnellement responsables devant le Sultan. Ce système a été miné, dans le sillage de la Révolution française, par la montée de la conscience nationale au XIXe siècle, laquelle a également sapé les fondements de l’Empire austro-hongrois. L’éclosion des nationalités et les rivalités coloniales sont les causes géopolitiques les plus fondamentales de la Première Guerre mondiale, et l’histoire européenne, depuis celle-ci jusqu’à la guerre de sécession yougoslave à la fin du XXe siècle, a été marquée par une série dramatique d’« épurations ethniques ». C’est dire l’échec des Européens, jusqu’ici incapables de régler leurs problèmes de minorités, à l’exception, si j’ose dire, de ceux qui n’en ont pas, et qui donnent des leçons aux autres. Maintien des frontières, principe des nationalités, droit des hommes à vivre sur leurs terres ancestrales et démocratie, paraissent radicalement incompatibles. L’immense espoir de demain est de rendre ces problèmes solubles dans l’Union européenne. C’est ainsi qu’en application des critères de Copenhague, la Turquie a pris, notamment dans le domaine linguistique, des initiatives vis-à-vis de l’importante minorité kurde dont elle niait auparavant l’existence au nom du principe kémaliste, directement importé de France, de l’indivisibilité de la Nation. Il faut dire, plus généralement, que nul dans le monde — pas seulement en Europe — n’a encore inventé de bonnes formules pour concilier en pratique démocratie et minorités. L’expérience des Etats-Unis, peuple d’immigrants, n’est pas transposable, et s’il est vrai que l’Inde est la plus grande démocratie du monde, les structures profondes de sa société n’en restent pas moins traditionnelles et inégalitaires, fort éloignées des conceptions démocratiques occidentales. S’il se confirmait donc, dans les dix à vingt ans à venir, qu’un pays comme la Turquie parvenait, du point de vue des conceptions occidentales, à des solutions viables pour ses minorités, principalement pour les Kurdes, il faudrait savoir y reconnaître une innovation d’une portée considérable.
J’en viens à la laïcité. Ce concept politique est français dans sa genèse, et aussi dans la mesure où il se veut universel dans sa portée, même si en pratique les Français réagissent souvent comme les autres, c’est-à-dire de façon ethnocentrique. Ramenée à l’essentiel, la laïcité traduit dans les institutions politiques la séparation des affaires temporelles et des affaires spirituelles, une question posée depuis le temps du Christ (« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », Matthieu 22,21) et formulée au Moyen Age comme la » théorie des deux glaives « . La laïcité marque aussi une rupture au moins intellectuelle avec le principe Cujus regio ejus religio, principe d’ailleurs réversible [telle la religion du pays, telle celle du prince], qui a dominé jusqu’à ce jour l’histoire politique des religions. Ce sont ainsi des raisons purement politiques qui expliquent qu’à la fin du Xe siècle la Pologne se soit convertie à l’Église chrétienne d’Occident, cependant qu’un peu plus tard la Russie kiévienne se rattachait à celle d’Orient. Sur le plan spirituel, la laïcité contient une autre idée, également issue des Lumières mais cette fois du côté allemand (Kant), à savoir qu’il est possible de formuler une morale pratique universelle, sans références explicites aux religions. Personnellement, je crois que les grandes religions, celles qui ont été éprouvées au cours des siècles à travers des témoignages crédibles, partagent un même socle de valeurs. C’est cela qui permet d’envisager une morale réellement universelle, avec des principes comme ceux recouverts sous le vocable « droits de l’homme ». Sur le plan politique, la possibilité d’une morale laïque universelle — que certains postulent indépendamment même de toute référence transcendantale et rattachent à l’instinct de survie — a l’immense avantage d’assurer la compatibilité de tous les concepts à la base du projet géopolitique de l’Union européenne. Ce qui nous ramène à la République fondée par Atatürk, puisque celle-ci se veut laïque au sens le plus français du terme. La difficulté, c’est que la révolution kémaliste a ses gardiens — comme en Iran la révolution khomeyniste a les siens —, à savoir l’Armée, jusqu’ici maîtresse du Conseil national de sécurité. Pour satisfaire aux critères de Copenhague, la Turquie a modifié sa Constitution de façon à abolir les pouvoirs exécutifs, anti-démocratiques, de ce Conseil, lequel en particulier pourra désormais être dirigé par un civil. Reste à tester cette réforme, ce qui prendra plusieurs années. Au nom de l’Europe, la Turquie court le risque, si ses espoirs étaient déçus, d’ouvrir ainsi démocratiquement un espace sinon la voie aux islamistes durs. Il est possible d’ailleurs qu’un certain nombre d’entre eux attendent leur heure en spéculant sur un rejet prochain de la candidature.
Reste la réconciliation. Voici un demi-siècle, le Parlement enterrait le projet de Communauté Européenne de Défense (CED) que le gouvernement français avait lui-même suscité, par méfiance de l’Allemagne. Trois ans après, avec les traités de Rome, commençait l’œuvre de réconciliation, et aujourd’hui l’entrée de la Pologne en apparaît un complément majeur. Lorsqu’on bâtit des projets, on a le droit et même le devoir de rêver. Les grands hommes d’action, qui sont aussi des grands aléateurs comme disait Jean Guitton, se caractérisent justement par l’accomplissement, certes temporaire comme toute œuvre humaine, mais a priori peu probable, de rêves qui les taraudaient. Pourquoi donc ne pas rêver à une réconciliation entre Grecs et Turcs, entre les descendants de Byzance et ceux des Ottomans et, pour monter encore d’un cran dans l’ambition, entre les trois monothéismes ? Le propre des vrais rêves est de rester irréalistes tant qu’ils ne sont pas réalisés. À supposer qu’il existe aujourd’hui une chance, c’est par la Turquie qu’elle peut être saisie, et les musulmans arabes, en particulier, le savent.
Face à ces considérations, je reviens sur l’extension future de l’Union. L’essence du projet européen est donc la construction progressive d’un ensemble reposant sur l’adhésion à des principes ou à des valeurs, dérivées des concepts dont j’ai parlé. Cette construction est un processus, dont l’accomplissement suppose la soumission à trois exigences. Il y a d’abord une condition d’absorption. Pour ne pas provoquer l’écroulement de l’ensemble, chaque phase d’élargissement doit être digérée. En particulier le système institutionnel de l’Union doit être adapté et testé. Les difficultés actuelles proviennent en grande partie, je l’ai déjà dit, d’une impression de fuite en avant. Ne serait-ce que pour cette raison, l’adhésion effective d’un pays aussi important que la Turquie est inconcevable avant des années. Deuxième condition : les pays candidats doivent démontrer, dans le détail et de façon objectivement vérifiable, leur disposition à adhérer effectivement aux concepts précédemment énoncés, formulés par les diplomates dans les « critères de Copenhague ». De ce point de vue, ceux qui redoutent que les États arabes se bousculent immédiatement à la porte se trompent. On aurait envie d’ajouter : malheureusement. Troisième condition : au terme des négociations d’adhésion, aucun État candidat ne peut être finalement accepté sans l’accord unanime des pays membres. À cet égard, la difficulté croît évidemment avec le nombre, et personne ne doute que, s’il s’agissait de ratifier maintenant un traité d’adhésion déjà signé avec la Turquie, les chances seraient à peu près nulles.
En fait, en spéculant à l’horizon d’une génération, ce qui est déjà beaucoup dans un monde aussi bouleversé que le nôtre, l’ensemble de ces conditions rend à peu près impensable tout nouvel élargissement massif. Au-delà, il faut d’autant moins se risquer à prévoir que l’espoir est un puissant moteur de progrès. À court terme, en tout cas, j’ai essayé de montrer que ce serait une faute grave de ne pas commencer les négociations, si le rapport de la Commission concluait positivement pour la Turquie sur la base des critères que nous avons nous-mêmes fixés. Nul ne peut prédire les conséquences de la crise politique majeure qui s’ensuivrait inéluctablement à l’intérieur de ce pays. Nationalistes anti-européens et islamistes relèveraient immédiatement la tête. Et puis, il faut le répéter : commencer n’est pas conclure.
Je terminerai avec quelques brèves considérations géopolitiques complémentaires. La réponse qui sera finalement donnée à la Turquie commandera dans une certaine mesure l’évolution à long terme de la Transcaucasie, historiquement enjeu des rivalités entre Turcs, Perses et Russes, dont l’importance géostratégique est comparable à celle des détroits avec, de nos jours, la dimension additionnelle du pétrole et du gaz, et celle des trafics en tous genres. Culturellement, l’Azerbaïdjan se rattache en partie à la Turquie, la Géorgie quoique multiethnique et surtout l’Arménie à la Chrétienté. On peut évidemment rêver d’une réconciliation entre Turcs et Arméniens, actuellement difficilement concevable, à travers le projet européen. Mais en toute hypothèse le destin de ces confins orientaux ne se décidera certainement pas sur la seule géopolitique de l’Union européenne dans les diverses hypothèses. Il dépendra de son articulation avec la géopolitique de la Russie et avec celle des Etats-Unis. À supposer qu’il existe un dessein russe identifiable, la clef de voûte en est certainement l’Ukraine. On peut penser que là se jouera pour l’essentiel l’avenir de la relation entre la Russie et l’Union européenne, en fonction aussi de la capacité de la première à poursuivre un redressement intérieur encore bien indécis. Plus généralement, si l’on envisage le continent eurasiatique dans son ensemble, comme il convient de le faire en bonne méthode, on voit que ses mouvements principaux résulteront de l’articulation entre quatre grandes plaques géopolitiques, si je puis employer cette métaphore tectonique : la plaque européenne, plastique ; la plaque russe, dure mais fragile ; la plaque chinoise, en expansion et incertaine ; et, de l’extérieur, la plaque américaine, maîtresse. L’examen de cette articulation nous entraînerait trop loin. Il me suffira de remarquer que la position qu’occupera la Turquie entre ces plaques importera, car la Turquie est et restera un acteur asiatique non négligeable à travers le Caucase, l’Asie Centrale, le Proche et le Moyen-Orient. Cela aussi, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ne devront pas l’oublier.