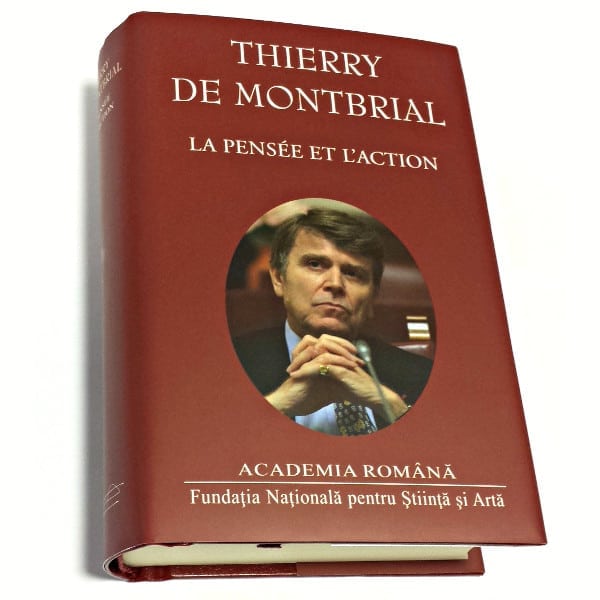Du principe de modération
Adapté d’un texte publié dans Le Débat, n° 128, janvier-février 2004, dans le cadre d’un dossier consacré à L’Action et le système du monde et composé des articles suivants : Jean-Pierre Dupuy, « Une science de l’action est-elle possible ? » ; Zaki Laïdi, « L’État et la mondialisation » ; Noël de Saint-Pulgent, « L’action et la réflexion » ; Christian Schmidt, « La praxéologie en question »
Faisant écho à une remarque de Pierre Hassner , Jean-Pierre Dupuy juge que « la forme ne détermine pas le contenu et que le même style de pensée peut produire des thèses divergentes ». Plus précisément, lui comme moi pensons « par modèles », ce qui est le propre de l’activité scientifique. Mais, argumente-t-il, l’opposition entre nos « tempéraments intellectuels » nous conduit à des façons différentes de voir le monde.
En fait, je ne crois pas que l’aspect intellectuel soit en cause. Sur ce point, notre accord me paraît au contraire presque parfait. La véritable opposition vient de nos « tempéraments » tout court. Et encore n’aurais-je pas, si j’avais pris l’initiative du débat sur ce thème, choisi ce substantif. Je suis en effet convaincu que, dans l’interprétation des phénomènes sociaux un peu complexes, le « point de vue » de l’observateur – en un sens très profond – est capital, même s’il peut exister des concepts, voire des théories de caractère universel. Ainsi parle-t-on, en termes bien peu scientifiques, d’optimisme ou de pessimisme. Je me vois moi-même souvent qualifié d’optimiste. Pierre Hassner, ou Jean-Pierre Dupuy, sont des pessimistes. Le « point de vue » résulte d’une combinaison de l’histoire personnelle du sujet – donc les expériences de toute nature qui l’ont marqué, y compris, bien entendu, sa culture – et de sa personnalité, au sens que les psychologues donnent à ce terme. On retrouve le débat majeur de la critique littéraire, dont le point de départ fut le Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust : dans l’intelligence d’une œuvre, jusqu’à quel point peut-on faire abstraction de l’auteur ?
Jean-Pierre Dupuy conteste mon « principe de modération » comme moteur universel − mais certes non déterminant à lui seul − de la régulation : « Pour des catastrophes de l’ampleur du 11 Septembre [2001] ou, pire encore, pour celles qui se profilent à notre horizon, liées aux problèmes de l’environnement, au développement incontrôlé des techniques et aux dérèglements du “système du monde”, une autre démarche à l’évidence s’impose : si l’instrument de l’autorégulation “modératrice” est la survenue de la tragédie, ce n’est pas un jeu auquel nous pourrons jouer très longtemps ! Il faut donc vaincre l’obstacle majeur que constitue le caractère non crédible de la catastrophe. C’est un problème que Montbrial analyse par ailleurs admirablement dans ses développements sur la dissuasion nucléaire. » Cette citation me permettra de préciser la différence de nos tempéraments. Pour Dupuy, comme il est vrai pour bien d’autres, le 11 Septembre est un événement apocalyptique. Mais en quoi cette catastrophe dépasse-t-elle – en horreur – tant d’autres ? Quels sont les critères de comparaison ? Si l’on s’en tient à des indicateurs objectifs comme le nombre de morts, la valeur des destructions en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), etc., on pourrait noircir des pages avec des catastrophes plus ou beaucoup plus grandes, au fil des siècles, y compris bien sûr, le XXe. Et quel est le sens de l’allusion aux catastrophes encore pires qui « se profilent à notre horizon » ? Quelles raisons permettent de juger objectivement que « le TGV est devenu fou » ? En matière de santé, par exemple, l’épidémie du sida, quand on la rapporte aux fléaux du passé (la Grande Peste du XIVe siècle a décimé le tiers de la population de l’Europe, etc.), n’a rien d’unique, et les épisodes du type vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine – ESB) ou syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont certes été mal gérés (d’où l’intérêt de l’expérience pour apprendre à mieux s’organiser), du moins sont-ils restés contenus. Autre exemple : s’agissant de l’évolution du climat, les études scientifiques ne sont pas encore suffisamment précises pour permettre un consensus relatif à un plan d’action à l’échelle mondiale. Édouard Bard, titulaire de la chaire « Évolution du climat et de l’océan » au Collège de France, observe avec bon sens, dans sa leçon inaugurale : « Le risque est qu’en attendant d’avoir davantage de preuves du réchauffement mondial et davantage de précision sur ces prévisions, nous soyons engagés de manière irréversible vers un changement climatique majeur comparable à ceux des derniers milliers d’années . » Bernard Tissot tire lui aussi la sonnette d’alarme . Mais en quel sens exactement faut-il penser ce risque en termes de « catastrophe » ? Édouard Bard écrit aussi, avec non moins de pertinence : « Le genre humain a toujours été confronté à des changements climatiques majeurs. C’est même probablement son adaptabilité à tous les climats qui le singularise . » Avec ou sans les excès de l’homme, où en sera la France physique dans quelques milliers d’années ? Nous avons tendance à penser nos États-nations géographiques comme s’ils étaient éternels, alors qu’ils sont de toute façon condamnés par la respiration de la Terre. J’ajouterai que, du point de vue praxéologique, une transition étalée sur quelques siècles, voire sur quelques décennies, n’a pas la même signification qu’une transition étalée sur quelques années ou a fortiori sur quelques mois.
Il est évident, d’une manière générale, que des modèles mathématiques producteurs de « catastrophe » sont aujourd’hui au point et même à la mode. Je m’y réfère moi-même abondamment dans mon livre. Il est facile, sur le papier, de créer des systèmes complexes incontrôlables. L’imagination peut nous porter à en déduire que les systèmes réels le sont. Mais un modèle non validé empiriquement n’autorise à aucune conclusion. Une forme possible ne crée pas les événements réels. Les dysfonctionnements – comme la gigantesque panne d’électricité qui a frappé une partie des États-Unis le 14 août 2003 – ne sont pas forcément tragiques. On sait aujourd’hui que le Gulf Stream pourrait bifurquer – indépendamment de toute cause anthropique –, ce qui changerait radicalement le climat de l’Europe occidentale. Cela était non moins vrai au XIXe siècle, mais on avait le bonheur de l’ignorer, alors que le fait de le savoir peut accroître notre anxiété : c’est une affaire de tempérament. Il est difficile de tirer de tout cela une conclusion précise en termes stratégiques. S’agissant des actions humaines, c’est l’une des tâches selon moi majeures de la praxéologie de se préoccuper des institutions sociales, par nature de plus en plus internationales, susceptibles d’influencer notre destin, sans pour autant prétendre le déterminer complètement.
Nous voilà ramenés au principe de modération. Jean-Pierre Dupuy me conseille de le compléter par un « principe d’emballement » – de même, précise-t-il, que « Freud eut besoin de flanquer le principe de plaisir d’une pulsion de mort ». Cette observation rejoint celle d’Hassner, me reprochant de ne pas m’intéresser suffisamment aux « processus à la Richardson ». J’ajouterai deux remarques complémentaires. La première concerne l’affirmation de Dupuy : « Le principe de modération ne vaut que pour autant que jouent les rétroactions négatives que la théorie économique attribue généreusement au marché, comme Montesquieu au système politique. » Je vois les choses autrement, par rapport au temps. Par exemple, le capitalisme « sauvage » du XIXe siècle a engendré le marxisme, lui-même à l’origine d’unités actives qui ont conduit à l’URSS, laquelle par réaction a engendré à son tour d’autres unités actives, porteuses de sa disparition et du retour à une nouvelle forme de capitalisme « sauvage ». Ou encore : la « mondialisation » provoque, par réaction, les mouvements « altermondialistes », dont il est encore trop tôt pour apprécier la portée. Naturellement, ces divers mouvements d’action-réaction se nouent à différentes échelles de temps, ce qui contribue à leur complexité. Dans mon esprit, le principe de modération n’est pas incompatible avec le phénomène de la « dépendance par rapport au chemin », en effet à certains égards aux antipodes de la mécanique rationnelle, sur lequel Dupuy insiste à juste titre. Car le principe de modération bien compris n’est nullement de nature déterministe. Il ne fait que restreindre le champ des trajectoires possibles. Mais il y a toute la place, pour les unités actives que j’ai mises à la base de ma construction, pour la liberté et même pour le destin. Et donc pour la singularité de l’Histoire. C’est pourquoi ceux qui me reprochent d’avoir négligé « la dimension temporelle ou historique » (Hassner) ne m’ont pas compris. J’y reviendrai un peu plus loin.
La seconde remarque a trait à la notion de réforme. Comme Dupuy et la plupart des hommes, j’aimerais prévenir les catastrophes, au sens le plus large du terme. J’ai de la sympathie pour son concept de « catastrophisme éclairé ». Mais, si l’histoire de l’Humanité n’est pas très encourageante sur ce point, ce n’est pas une question d’insuffisante capacité prévisionnelle ou de mauvaise volonté de x ou de y. En règle générale, la prévention est ce que j’appelle un problème praxéologique, qui par définition met en jeu les intérêts des unités actives concernées, parmi lesquelles celles dont la raison d’être est justement de tirer la sonnette d’alarme et dont les membres individuels illustrent la liberté humaine. Mais il est bien rare (le nucléaire civil est un contre-exemple – discutable – dans de nombreux pays) que ces dernières l’emportent, en l’absence d’une catastrophe actualisée, au moins à l’état embryonnaire. Il y a place, en praxéologie, pour une théorie de la vaccination.
La clef de l’opposition entre nos deux tempéraments, on la devine, me semble-t-il, dans les toutes dernières lignes de l’article de Jean-Pierre Dupuy : « Je crois que le mal radical existe dans le monde, et qu’il a un pouvoir causal sur celui-ci dont nulle démarche de ce type [c’est-à-dire ressortissant à la pensée rationaliste] ne saura jamais rendre compte. Mais c’est là une autre histoire qui, comme dirait Borges, nous écrit plus que nous ne l’écrivons. » Mon désaccord porte sur les sous-entendus de cette déclaration. On dirait en effet que Dupuy croit à la victoire du mal. Moi, je veux croire à la victoire du bien. Nous ne sommes plus là, comme il le dit, dans le champ de la pensée rationaliste, mais dans l’ordre le plus intime de la pensée métaphysique. Le livre de Job, pas plus que la Bible dans son ensemble, ne prétend dissiper le mystère du mal. Son message, dont chacun peut faire l’expérience dans sa vie à condition de le vouloir, est que du mal peut sortir du bien. Encore une application du principe de modération ! Mais qui l’emporte au bout du compte ? Là est la véritable question de tempérament, pour ne pas dire de foi.
Sans m’engager sur le terrain théologique, je ferai deux remarques complémentaires aux confins de la praxéologie. D’abord, toutes les actions humaines sont enfermées dans une cellule finie d’espace-temps, ce qui interdit aux « décideurs » de connaître et même d’appréhender les conséquences ultimes de leurs actes. D’où la nécessité d’inscrire l’action dans un code moral ou éthique. C’est l’objet du chapitre XI de mon livre. En second lieu – on rejoint la philosophie de l’Histoire –, le local ne détermine pas le global. Par définition, nous agissons localement, et comme des êtres libres. Libres, en particulier, de créer des unités actives ou d’œuvrer à travers elles, pour ce que nous croyons être le bien. Mais les « conditions aux limites », qui affectent la trajectoire humaine dans son ensemble, nous échappent radicalement, d’où le mystère de la destinée humaine. Et ce n’est pas tout à fait un hasard si, dans son avant-dernier paragraphe, Dupuy s’exprime ainsi : « Tel un TGV devenu fou, [la technique] nous emporte Dieu seul sait où. » Je ne crois pas que le TGV soit devenu fou, mais, qu’il en soit ou non ainsi, il n’est pas neutre de dire que « Dieu seul sait » où nous allons.
Pour conclure sur les rapports entre la praxéologie et le problème du mal, encore un commentaire d’ordre pratique. Exerçant les fonctions de directeur du Centre d’analyse et de prévision (CAP) au Quai d’Orsay, je fus impliqué, à l’époque de la présidence Carter, dans les débats transatlantiques sur la prolifération des armes nucléaires. L’Administration de Washington prévoyait déjà le pire en la matière. Nous n’étions pas encore à l’époque d’Internet, mais les rayons des libraires étaient encombrés de livres du genre : Comment fabriquer une bombe atomique dans votre cuisine ou Comment décimer une population en saupoudrant du plutonium dans une rivière. Ce qui m’étonnait et m’étonne toujours, c’était qu’aucune catastrophe de ce genre n’ait eu lieu. Je m’étonnais de la même manière que le terrorisme restât aussi longtemps absent du territoire américain. Je m’étonne aujourd’hui qu’aucune attaque comparable à celle du métro de Tokyo en 1995 (attentat au gaz sarin) ne se soit encore reproduite. En un mot, tout esprit ancré dans le réel doit se demander non pas seulement pourquoi le monde n’est pas plus stable, mais pourquoi il n’est pas plus instable − les adjectifs « stable » et « instable » étant pris ici dans leurs acceptions les plus générales. De la même manière, lorsque je travaillais autrefois sur les fondements de la théorie économique, j’étais intrigué non pas par les multiples et plus ou moins évidentes faiblesses de la théorie de l’optimum et de l’équilibre général issue de Walras et de Pareto, mais par la puissance explicative du réel qu’elle possède malgré tout. Par exemple, la théorie ricardienne des avantages comparatifs complétée par les courbes de demande réciproque de Stuart Mill, ou encore le modèle néoclassique de Hecksher, Ohlin et Samuelson, restent les meilleurs modèles pour l’explication et l’interprétation en première approximation du commerce entre des unités politiques différentes.
Pour en rester aux pathologies du système international, la réponse à mon étonnement paradoxal tient dans la combinaison de deux facteurs principaux. Premièrement, les pathologies mentales qui nourrissent les comportements de type kamikaze, comme toutes les pathologies, affectent des fractions limitées des populations, et seule une faible proportion des individus atteints est susceptible de se lancer dans les « actes insensés » dont parle Dupuy dans Avions-nous oublié le mal ? Le ressentiment, l’envie, la jalousie, la haine ne s’expriment que rarement par des crimes. Sinon, aucune société ne résisterait et on le saurait depuis longtemps. Deuxièmement, tout attentat d’une certaine ampleur suppose une organisation et une tête rationnelles, qui laissent des traces repérables dès la phase de préparation. Tout le problème, du côté de la défense, est de tirer les enseignements de ces réalités pour prévenir les crimes. Les dimensions internationales nouvelles de la criminalité posent des problèmes praxéologiques ardus de choix politiques ainsi que d’organisation sur lesquels je ne dirai rien ici, si ce n’est que, conformément au principe de modération, des attentats comme ceux du 11 septembre 2001 ont stimulé toutes sortes d’initiatives pour les traiter.
Je citerai Dupuy une dernière fois : « L’optimisme de [Montbrial] résulte, me semble-t-il, de ce qu’il n’envisage pas que l’action puisse s’emballer, faire boule de neige, emportant sur son passage tous les remparts que les hommes ont dressés pour la contenir, sous la forme d’institutions, de régulations ou de systèmes d’interdits et d’obligations. » À quoi je réponds qu’à chaque instant les institutions, régulations ou systèmes d’interdictions et d’obligations permettent d’éviter la plupart des catastrophes virtuellement concevables. Mais il est vrai, hélas, que de temps à autre des orages déstabilisent même les hommes les plus raisonnables, que les remparts sont alors emportés. Je maintiens cependant que, lorsque ces catastrophes se produisent, le principe de modération continue de jouer pour réduire la probabilité du retour d’un drame de même espèce. Cela peut prendre du temps et, pour que la réaction soit durable, il faut encore que la mémoire des catastrophes ne soit pas effacée.
J’en viens maintenant au commentaire de Christian Schmidt. Je ne me sens nullement offusqué de me voir rattaché au positivisme logique, dans la mesure où, comme Dupuy, je tiens que toute science digne de ce nom se traduit par des concepts clairs, des propositions se rapportant à ces concepts, logiquement connectées et susceptibles, directement ou indirectement, d’une confrontation empirique. Telle est l’essence du raisonnement à travers des modèles. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi une grille d’analyse de ce type serait ahistorique et évacuerait la temporalité. Le traité de Raymond Aron est organisé en quatre parties, intitulées respectivement : « Théorie », « Sociologie », « Histoire » et « Praxéologie ». Grand admirateur de ce monument dont je me suis beaucoup nourri, j’ose dire que je ne me suis jamais senti à l’aise avec son plan. La distinction entre théorie et sociologie manque de clarté à mes yeux. Par exemple, la puissance est traitée dans la théorie, alors que les ressources, qui la conditionnent, viennent dans la sociologie. Pourquoi l’espace, le nombre et les ressources sont-ils abordés dans trois chapitres différents et sur le même plan, alors que les deux premiers sont des ressources particulières ? Il est vrai que Aron parle essentiellement des ressources économiques. On pourrait développer la critique. J’ai essayé, pour ma part, d’unifier tout cela d’une manière synthétique et logique, et d’élargir la notion de système international pour éviter les pièges de l’école réaliste à laquelle se rattache Aron, pièges devenus particulièrement redoutables à l’ère de la mondialisation. J’ai essayé aussi d’insérer les relations internationales dans un cadre plus général, et de ne pas tout centrer sur la dialectique de la guerre et de la paix.
Dans la troisième partie, consacrée, comme Aron l’écrit lui-même dans son introduction, à la « conjoncture actuelle », c’est-à-dire celle du moment de la rédaction, elle n’est ni plus ni moins qu’une « histoire du système planétaire à l’âge thermonucléaire », couvrant un peu plus de quinze années (de 1945 à 1962). Alors que, dans les autres parties, l’auteur multiplie les exemples historiques, souvent contemporains, celle consacrée à l’histoire comprend de nombreuses incrustations théoriques. Comme Aron, je reconnais pleinement l’importance de l’histoire, et ce, pour les raisons données par Schumpeter à propos de la science économique, discutées dans le chapitre VII de mon livre. Dans mon propre projet, j’avais initialement pensé faire un ouvrage qui, au lieu de deux parties, en eût contenu trois, la première consacrée à l’histoire du temps présent, correspondant donc à la troisième partie d’Aron. J’ai finalement opté pour des publications séparées. Mémoire du temps présent couvre essentiellement la période de la guerre froide . Vingt ans qui bouleversèrent le monde traite, année après année, du système international depuis la chute du mur de Berlin. Dans ces deux essais, je ne cesse de souligner la singularité du processus historique, malgré les régularités, avec le souci, comme Aron, « de distinguer à chaque instant et dans la suite des événements les données durables et les circonstances changeantes, sans postuler à l’avance que les changements sont toujours déclenchés par des faits de même espèce ». À quoi il convient d’ajouter que, dans le corps de L’Action et le système du monde, je me suis attaché à multiplier les références à l’Histoire, comme le relève de son côté Noël de Saint-Pulgent. Ainsi, je ne puis que récuser la thèse selon laquelle mon approche serait ahistorique.
Enfin, mon illustre prédécesseur confère à la praxéologie un statut quelque peu incertain. Il en fait le titre de la quatrième partie de son traité – signifiant ainsi que, pour lui, le reste de l’ouvrage n’est pas de la praxéologie, mais alors de quoi s’agit-il ? – qui comprend six chapitres. Les deux premiers, sous-titrés « En quête d’une morale », sont consacrés respectivement à la dialectique idéalisme-réalisme et au thème wébérien de la conviction et de la responsabilité. Pour moi, ces sujets appartiennent à la théorie : théorie des relations internationales, dans le premier cas ; de la décision, dans le second. Dans les deux suivants, Aron s’adresse aux « décideurs » et recherche une stratégie pertinente pour le contexte du début des années 1960. Dans les deux derniers, il s’interroge sur l’alternative classique de la paix par la loi ou de la paix par l’empire ce qui, de mon point de vue, relève encore une fois de la théorie des relations internationales. Au total, la distinction introduite dans Paix et guerre entre les nations entre les « niveaux de compréhension » ne me convainc guère.
Sur un tout autre plan, Christian Schmidt, auteur d’un excellent ouvrage sur la théorie des jeux où il remarque d’ailleurs qu’il serait plus exact de parler des théories des jeux , se demande si cette discipline ne constituerait pas, en définitive, la meilleure référence « pour asseoir la discipline praxéologique sur une base rigoureuse ». Cette question mériterait un examen détaillé et nécessairement technique. Pour ma part, je ne suis pas à la recherche d’une vaine théorie générale de l’action, et mon ambition s’est bornée à proposer une boîte à outils avec des éléments robustes et cohérents, mais également aussi simples que possible, en les empruntant sous leur forme originelle là où ils avaient fait leurs preuves. Ayant aussi essayé d’être moi-même un homme d’action au cours de ma vie professionnelle, j’ai sélectionné mes outils en tenant compte de l’aide qu’ils m’avaient apportée pour traiter les problèmes concrets qui s’étaient présentés à ma responsabilité ou à mon esprit. Ainsi ai-je l’espoir d’être utile aux praticiens et pas seulement aux intellectuels. De ce point de vue, le témoignage de Noël de Saint-Pulgent m’est particulièrement précieux. La théorie des jeux a d’éminents mérites que je ne méconnais pas. Mais je n’y retrouve pas, sous une forme adaptée à mes besoins, bien des concepts aussi importants à mes yeux que ceux de culture, de légitimité, de passage à l’acte, de vigilance et de coup d’œil (intuition), pour n’en citer que quelques-uns. Certes, les jeux évolutifs permettent de retrouver certains concepts comme l’image ou la réputation, mais il n’est pas sûr que l’ampleur de l’investissement intellectuel pour y parvenir soit récompensée par une compréhension plus profonde. Mon attitude est proche de celle de Howard Raiffa, l’un des maîtres de cette discipline, qui a bifurqué vers l’analyse de la négociation, laquelle est un aspect important de la résolution des conflits et donc de la praxéologie. Dans son dernier livre , il se réfère évidemment à la théorie des jeux, mais il la considère ni plus ni moins comme une théorie normative destinée à montrer « comment des groupes d’individus ultra-sophistiqués doivent prendre des décisions séparément, en interaction les unes avec les autres », et ne lui accorde en conséquence qu’une place limitée. Encore ces individus ultra-sophistiqués – que je vois plutôt comme des robots – opèrent-ils dans un environnement complètement spécifié, ce qui n’est jamais vrai dans la réalité, et leurs capacités supposées reposent-elles sur une hypertrophie du rationnel à l’exclusion de toute autre forme de psychologie.
Le texte de Zaki Laïdi dérive d’un aspect particulier de mon livre : le rapport entre l’État et la mondialisation. Je suis naturellement en accord avec sa notion d’État fractal : « un État qui deviendrait à la fois une partie d’un tout mondialisé, mais qui resterait en même temps le tout, compris au sens de représentant d’une collectivité politique nationale ». Au début du XXIe siècle, l’État (un territoire, une population, un gouvernement) demeure l’unité politique de base du « système international », même s’il participe, comme toutes les unités actives, à cette mondialisation dont Zaki Laïdi souligne justement que les centres nerveux restent extrêmement limités.
Lorsque je parle de « reconfiguration » de l’État, c’est tout le problème de l’adaptation et donc des réformes que je soulève. Mon livre est suffisamment explicite sur ce point et je n’y reviendrai pas ici. Peut-on dire que « la seule différence avec ce qui se passait au XIXe siècle, c’est qu’aujourd’hui les risques de conflits ne sont plus de nature interétatique » ? Pareille formulation me paraît ambiguë. En effet, toutes les unités actives de la planète, y compris les unités criminelles ou les mouvements antimondialisation, opèrent sur des territoires en principe soumis au contrôle des gouvernements. Pour traiter les nouveaux problèmes d’interdépendance, les États doivent apprendre à coopérer, ce qui est un aspect majeur de la « reconfiguration ». S’agissant de la sécurité au sens le plus classique, la difficulté réelle ne vient pas des États, mais des quasi-États ou des « États manqués » – entités où le gouvernement ne gouverne pas ou mal –, dont le nombre a augmenté avec la chute de l’empire russe et la réouverture consécutive de chantiers gelés au lendemain de la Première Guerre mondiale, après la décomposition de l’Empire austro-hongrois et de l’Empire ottoman. D’où la problématique du nation building ou, plus exactement, du state building, où l’on peut voir, à plus grande échelle, un retour aux préoccupations de l’entre-deux-guerres.
Zaki Laïdi soulève la question des limites de la mondialisation et esquisse un développement intéressant à propos de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Sur le plan théorique, la raison la plus fondamentale pour laquelle le processus de mondialisation rencontre – conformément au principe de modération – des obstacles qui l’empêcheront d’aller au terme de la logique purement libérale est à mon avis que, dans son état actuel et prévisible, le monde ne constitue pas une unité politique. Une telle unité supposerait à la fois une Culture et une Organisation de caractère universel. D’où il résulte, comme je le souligne au début du chapitre VI de mon livre, qu’« il n’existe pas de bien public mondial, en conséquence de quoi le noyau dur du champ des relations internationales est relatif aux problèmes de la coordination des biens publics (dans tous leurs aspects) entre différentes unités politiques ». Il est essentiel de rappeler que les biens publics concrets ne sont pas définis dans l’absolu, mais par l’intermédiaire d’« usines de production des décisions », sur lesquelles s’exercent toutes sortes d’influences, dont celles des groupes de pression . Notons incidemment que la fragilité actuelle de l’Union européenne, unité politique en devenir, tient à la faiblesse à la fois de sa Culture et de son Organisation, lesquelles – dans la meilleure des hypothèses – ne pourront se renforcer sans la durée . Pour le monde dans son ensemble, l’unification n’en est même pas au stade embryonnaire.
Dans ces conditions, je rejoins sans réserve Zaki Laïdi lorsqu’il affirme que les conflits commerciaux sont de moins en moins commerciaux, que ce sont de plus en plus des conflits de valeurs ou de choix publics. La mondialisation, ajoute-t-il, « n’est plus une simple affaire de compétition entre économies, mais de compétition entre systèmes sociaux ». Dans ma terminologie, j’irai encore plus loin en parlant de conflits culturels, au sens le plus large du terme et non pas seulement au sens restreint du débat habituel sur « l’exception (ou l’exemption) culturelle ». L’issue de ces conflits n’est pas déterminée a priori, et les chances de chacune des parties dépendent notamment de leur aptitude à se réformer pour augmenter leur efficacité et, donc, leur potentiel dans le cadre de leurs propres valeurs. Ce qui fait la difficulté mais aussi le charme du sujet, c’est justement que la frontière entre la protection de l’identité collective et le protectionnisme vulgaire n’est pas toujours facile à tracer. Le système de l’OMC étant dominé par les pays développés, les pays du Sud ont des raisons de se méfier, comme ils ont aussi des raisons de se méfier des « altermondialistes » dont les discours tiers-mondistes comme ceux d’un José Bové dissimulent mal des postures parfois très protectionnistes. Et comme c’est dans les liens entre les peuples et leurs terres que se forge largement l’identité collective, chacun peut comprendre pourquoi le secteur agricole manifeste le foyer de toutes les contradictions.
Pour terminer, je ferai quelques remarques sur les quatre questions posées par Noël de Saint-Pulgent. La première concerne ce que dans mon livre j’appelle les « usines de production des décisions », dans le fonctionnement des démocraties occidentales. Je ne crois pas que l’examen du temps présent confirme une tendance générale à leur paralysie du fait des opinions publiques. L’expérience américaine, par exemple sous les présidences de Ronald Reagan ou de George W. Bush, démontre le contraire. José Maria Aznar a conduit des réformes libérales audacieuses en Espagne et, au nord de l’Europe, des pays comme la Suède ou les Pays-Bas ont également manifesté une remarquable capacité d’adaptation avec des « modèles » très différents . Il est vrai qu’en France les gouvernements successifs semblent paralysés par la rue. Nous éprouvons encore plus de difficultés à nous réformer que l’Allemagne, elle aussi embourbée par son État-providence, mais du moins celle-ci a-t-elle l’excuse d’avoir dû faire face à l’énorme choc de la réunification. Dans l’un et l’autre cas, le problème est davantage politique que technique, c’est-à-dire qu’il se situe dans la relation psychologique entre gouvernants et gouvernés plutôt que dans l’usine de production des décisions (ou, pour employer un terme plus habituel, dans les institutions), même si cette usine ne saurait, elle non plus, échapper à la nécessité de l’adaptation. En fin de compte, le problème posé par Saint-Pulgent conduit à réfléchir à la notion de déclin, qu’il convient de distinguer soigneusement de celle de décadence. Le déclin d’une unité active, en particulier d’une unité politique, peut se définir d’une manière opératoire comme l’affaiblissement continu de sa capacité d’agir, et donc de son potentiel. Je ne crois pas que les démocraties occidentales en tant que telles soient en cause à cet égard. Le problème du déclin ne concerne que certaines d’entre elles et dans certaines situations. À quoi on ajoutera que le déclin n’est pas nécessairement irréversible et que, pour parler à la manière du général de Gaulle, il arrive que l’espoir succède à l’abîme et s’incarne dans le renouveau. On retrouve les thèmes indissociables de la liberté et du destin dans l’Histoire.
Seconde question : l’Union européenne. Son véritable enjeu, à mon sens, est la fabrication d’une nouvelle sorte d’unité politique, ce qui dépasse largement le cadre en effet très restreint, et moins significatif à l’heure de la mondialisation, de grand marché. Par nature, il s’agit d’une entreprise de longue durée, qu’il faut appréhender au moins à l’échelle du siècle. À court terme, c’est-à-dire à l’horizon de la première, voire de la deuxième décennie du XXIe siècle, nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés liées aux élargissements successifs, considérés à tort ou à raison comme inéluctables. Nous butons à la fois sur le problème de la légitimité et sur celui des institutions. Les deux sont évidemment liés. C’est pourquoi je maintiens que ce dont l’Europe souffre le plus aujourd’hui, c’est l’absence d’une Culture suffisamment commune. Il faut rappeler en effet qu’une unité politique, comme toute unité active, se définit par un couple : une Culture et une Organisation. Il peut y avoir un certain trade-off entre les deux, c’est-à-dire qu’un déficit culturel peut être au moins temporairement compensé par une Organisation plus forte et réciproquement. La Culture se forge dans le temps long, alors que l’Organisation opère à l’échelle, disons, de la génération. D’où l’importance de l’enjeu de la Constitution européenne ou du texte « simplifié » qui a remplacé le projet élaboré par la Convention présidée par Valéry Giscard d’Estaing. Nous risquons effectivement, comme le laisse entendre Saint-Pulgent, de cumuler les inconvénients d’une Culture trop faible et d’institutions trop floues. Mais, de même que le développement économique est soumis à des cycles, je ne crois pas que le progrès de la construction européenne puisse être continu. Peut-être connaîtrons-nous, dans les prochaines années, une phase d’indigestion . Pour autant, je maintiens que le projet européen est la plus belle aventure géopolitique du XXe siècle, et n’hésite pas à parier qu’elle se poursuivra au Ier siècle du IIIe millénaire.
Quelques mots, maintenant, sur le capitalisme – qui ramène au thème de la réforme et de l’adaptation. Tout d’abord, il fallait être naïf ou ignorant pour croire que 40 % de la population de la planète (ce que l’on appelle aujourd’hui les « pays émergents », selon une terminologie contestable) pourrait entrer dans la voie du développement sans perturber le train-train des vieilles nations. Le degré d’interdépendance est d’ailleurs aujourd’hui tel que tout recours massif au protectionnisme ne pourrait qu’engendrer davantage de malheurs. Comme Schumpeter – un auteur auquel je me réfère souvent dans mon livre et plus généralement dans mes travaux –, je pense que le capitalisme a par nature une immense capacité de survie parce qu’il a une remarquable capacité d’adaptation, à l’inverse des institutions publiques. Puisque les transformations sont inévitables, il faut apprendre à les gérer au mieux, ce qui ne veut pas dire sans douleur. Cela dit, je ne partage pas tout à fait la remarque de Noël de Saint-Pulgent sur « l’alignement progressif des différents systèmes économiques sur la forme la plus pure, mais aussi la plus dure, du capitalisme – à savoir, le modèle anglo-saxon » –, bien que cette observation soit en grande partie justifiée en matière financière. Conformément au bon principe de modération, on voit déjà, en Europe bien sûr mais aussi par exemple en Asie (je pense notamment à la Malaisie), des réactions salutaires. Le meilleur côté des mouvements altermondialistes, je l’ai déjà noté, est d’obliger les Américains eux-mêmes à s’interroger sur les modalités d’une nécessaire régulation . Du reste, ces derniers, chez qui le pragmatisme finit toujours par l’emporter sur l’idéologie, sont loin d’aller jusqu’au bout dans la logique du libéralisme sauvage. Il suffit de mentionner le cas de l’agriculture.
Pour terminer, une observation sur l’Irak. Là encore, je vois le principe de modération à l’œuvre. En décidant en 2003 de passer à l’acte et de renverser le régime de Saddam Hussein, George W. Bush a en effet voulu manifester la puissance des États-Unis, ce qui confirme, incidemment, que cette grande démocratie reste parfaitement capable d’agir. Mais l’« usine de production des décisions » n’a pas su appréhender convenablement la suite, grâce ou à cause de quoi l’Amérique redécouvre qu’aucune puissance n’est illimitée. Les États de l’Union européenne, de leur côté, peuvent s’interroger sur la nécessité de dépasser la dialectique simpliste du pour ou contre l’Amérique. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont même rapprochés sur la question de la défense. Et l’on pourrait ainsi faire le tour de la planète. Était-il nécessaire d’en passer par là pour retrouver la voie du bon sens ? Le monde en général et les Irakiens en particulier se porteraient-ils durablement mieux si Bush ne s’était pas lancé à l’assaut de Bagdad ? Du point de vue de la praxéologie, l’intérêt de questions de ce genre n’est pas de distribuer bons et mauvais points aux dirigeants – en démocratie, il revient aux électeurs de trancher : il est d’améliorer la capacité d’agir en tirant les enseignements des erreurs passées. Pour le reste, l’Histoire n’est pas écrite d’avance !