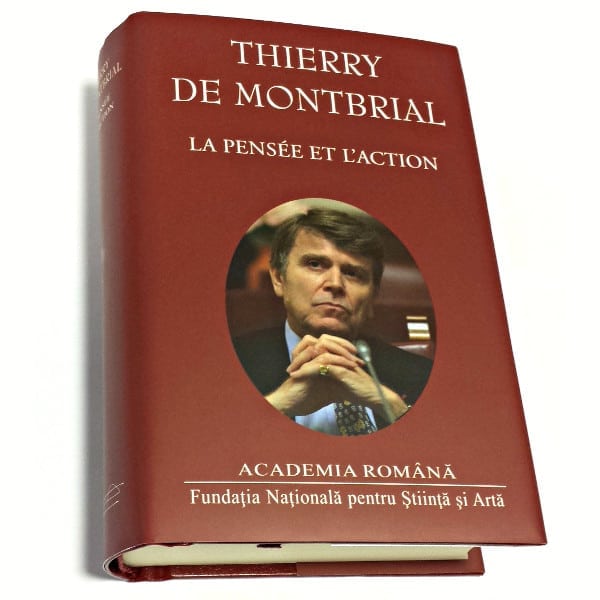De la négociation
Adapté du texte introductif du volume Pratiques de la négociation, sous la direction de Thierry de Montbrial et Sabine Jansen, Bruxelles, Bruylant, 2004
Nous passons notre vie à négocier, le plus souvent sans même nous en rendre compte. La vie est une suite de négociations. Il s’agit donc d’un thème universel. Il fait l’objet de toute une littérature théorique et s’enseigne aujourd’hui dans les écoles de commerce ou d’ingénieurs. Mais, en règle générale, les gens se préoccupent davantage du résultat que du processus qui y conduit. Ce qui leur importe, c’est l’accord signé, la décision prise ou le prix finalement payé. De même que, en matière de gastronomie, on juge de la qualité d’un plat avant tout sur ses saveurs, sur le plaisir qu’il procure et non sur son mode de confection à l’office. À cette relative indifférence générale à l’égard des moyens, vient s’ajouter la discrétion – qui, le plus souvent, entoure les chemins menant à la conclusion d’une affaire. Le secret constitue un obstacle à la connaissance et à l’étude des négociations par ceux qui écrivent l’histoire. Le problème des sources se pose particulièrement à l’époque contemporaine où la communication digitale occupe une grande place. Dans tous les cas, il est beaucoup de choses qui ne laissent pas de traces dans des archives bien stockées, au grand désespoir de l’historien… Mais peut-être est-ce aussi l’une des raisons pour lesquelles la négociation est un objet d’étude fascinant.
Il faut rappeler tout d’abord les quatre grands modes de résolution des conflits, d’une manière générale :
– Il y a la négociation, à laquelle on peut rattacher des formes diverses, y compris la notion de médiation .
– Une modalité très répandue, notamment dans le monde des affaires, est l’arbitrage, c’est-à-dire que les parties en conflit s’en remettent à un acteur extérieur, émotionnellement ou personnellement non engagé dans le conflit, pour rendre une sorte de justice de Salomon. C’est une pratique courante dans les affaires privées, chacune des parties craignant les hasards et les coûts de la procédure. Cela l’est beaucoup moins dans les affaires internationales (même si certains États acceptent parfois d’aller devant la Cour internationale de justice), pour des raisons tenant à la nature même de la réalité internationale, et d’abord au principe de souveraineté.
– Il y a la procédure, c’est-à-dire le recours à la justice. Volontairement ou par contrainte, on s’en remet, là encore, à des tiers, mais suivant un mécanisme radicalement différent de l’arbitrage. Rappelons, pour mémoire, la distinction de ce point de vue entre le droit interne et le droit international. Une bonne partie du droit international est considérée par certains juristes comme n’étant pas du droit, en raison de son ineffectivité. Contrairement à ce qui s’entend souvent, la Charte des Nations unies ne met pas en question l’axiome de la souveraineté des États. En dépit de son ambiguïté, celui-ci reste, dans l’état actuel des choses, la clef de voûte du système international. Dès le début de la Charte, il apparaît par exemple que le principe général est la prohibition de la guerre, mais ce principe fait aussitôt l’objet d’exceptions dont l’interprétation est ouverte. Certaines branches du droit international ont cependant un caractère « dur ». Par exemple, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’effectivité des procédures de règlement des différends est largement démontrée.
– Le quatrième mode de résolution des conflits est l’affrontement. L’affrontement est une épreuve de force plus ou moins violente qui, sous sa forme extrême prend la forme de la guerre dans le cas des relations internationales. Il est tellement important et tellement caractéristique de la réalité internationale, que beaucoup de penseurs (ainsi Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations) ont mis le phénomène de la guerre au centre même de la définition des relations internationales. C’est là que la notion de souveraineté prend toute sa signification. C’est effectivement le droit que s’octroient les États souverains de décider par eux-mêmes de la manière de trancher les conflits en recourant à la violence qui, historiquement, caractérise le plus la réalité internationale.
Le simple bon sens enseigne que, si possible, il vaut mieux régler un conflit par la négociation que par les autres méthodes. C’est mieux que la violence et la guerre, c’est mieux aussi que les hasards de la procédure dont la comédie de Racine, Les Plaideurs, nous rappelle les vices cachés.
Quel est le domaine de la négociation ? Ce domaine, c’est la recherche coopérative d’un accord entre deux ou plus de deux parties. Deux ou plus de deux, il y a là déjà une différence radicale. On pourrait même raisonner avec une seule partie, puisque dans certains cas on négocie avec soi-même. Comment soi-même négocie-t-il avec soi-même ? Ce sujet est plus sérieux qu’il n’y paraît. Admettons toutefois que, pour qu’il y ait négociation, il faille un minimum de deux parties. On rappellera d’emblée que le passage de deux à trois est un changement radical, plus radical qu’entre trois et un nombre supérieur. On a là une situation comparable à celle, bien connue des mathématiciens et en particulier des étudiants de la mécanique céleste, qui est le passage du problème des deux corps au problème des trois corps. L’addition de la Lune à la Terre et au Soleil modifie totalement le problème, en introduisant en germe la possibilité du chaos, un phénomène identifié par Henri Poincaré au début du XXe siècle. Pourquoi le passage de deux à trois ou plus, en négociation, est-il effectivement très fort ? Parce qu’il introduit la possibilité des coalitions et des alliances, avec leurs coûts de transaction et leurs degrés divers de réversibilité.
Ce qui est vrai en matière de mécanique céleste l’est donc aussi dans le domaine historique. Un bel exemple en est donné, au tournant du XXe siècle, pendant la période dite de la « paix armée » qui a précédé la Première Guerre mondiale. À l’origine, le système bismarckien d’équilibre européen se noue, en 1879, autour d’une alliance défensive secrète entre l’Allemagne et l’Autriche, la Duplice à laquelle vient s’agréger en 1882 l’Italie : la Triplice est née. Face à elle se constitue la Triple Entente à partir de la France et la Russie, lesquelles concluent, en 1892, une alliance défensive. Cette alliance s’ouvre ensuite à la Grande-Bretagne qui signe un accord avec la France en 1904 puis avec la Russie en 1907. Les enchaînements qui suivront, à l’été 1914, sont bien connus et sont, du reste, à l’origine du premier des Quatorze points énoncés par le président Wilson en janvier 1918 bannissant la diplomatie secrète.
Mais le plus intéressant, pour notre propos, réside dans la mise à l’épreuve des deux systèmes d’alliance entre 1890 et 1913. Que ce soit dans les deux crises marocaines (1904-1905 et 1911), dans la crise bosniaque de 1908-1909 ou dans les guerres balkaniques de 1912-1913, l’articulation des alliances en raison de leur dimension ternaire est particulièrement complexe. D’une certaine façon, ce sont les échecs et les dysfonctionnements internes des deux blocs durant cette période qui rendront possible l’embrasement de l’été 1914. Le passage de deux à trois est plus radical que le passage de trois à un chiffre supérieur. L’affirmation est à nuancer malgré tout, car, lorsque le nombre augmente, par exemple dans l’enceinte des Nations unies, le fait d’avoir un grand nombre de participants crée, sur le plan des modalités pratiques de la négociation, l’obligation de simplifier. La théorie des jeux permet d’éclaircir cette situation. En pratique, les meilleurs exemples de ce type de négociations sont donnés par l’Union européenne (Acte unique de 1985, passage à l’euro, Traité constitutionnel…) et par les « rounds » successifs du GATT puis, à partir de 1994, de l’OMC . Si le nombre des parties augmentait indéfiniment, on finirait par obtenir le type de simplification que montre la théorie du cœur ou noyau en théorie des jeux, ou encore la physique statistique. Mais les grands nombres ne se rencontrent pas vraiment dans les affaires de négociation ! L’ambassadeur Jacques Leprette, l’un des pionniers en France en matière de diplomatie multilatérale, soutenait d’une manière convaincante que la diplomatie multilatérale est un métier en soi, même si naturellement les fondements de la notion de négociation sont les mêmes.
Venons-en maintenant à quelques questions fondamentales concernant la négociation en général.
Première interrogation : De quoi s’agit-il ? Le maréchal Foch posait invariablement cette question. Dans chaque situation concrète il faut se demander : quel est le problème ? Celui-ci doit être défini d’une façon suffisamment objective pour que chacun sache de quoi l’on débat. Cela n’a rien d’évident. Il y a une trentaine d’années, j’avais eu une longue conversation avec Jean Monnet qui m’avait dit : « En politique, la plupart du temps, les problèmes sont insolubles. Que fait-on quand un problème est insoluble ? On change le problème. » Cette remarque m’avait plu, parce que le mathématicien que j’étais s’est retrouvé en terrain familier. En mathématiques, on procède constamment ainsi : si un problème est insoluble, on le change pour qu’il devienne soluble. Prenons le cas des nombres entiers positifs (1, 2, 3, 4…). Même les plus allergiques aux mathématiques verront que x – 1 = 0 a une solution, qui est x = 1. Mais, si l’on prend x + 1 = 0, il n’y a pas de solution en nombres entiers positifs. Alors on change le problème : on invente les nombres négatifs et, à ce moment-là, la solution est x = – 1. Au fond, en mathématiques comme dans les affaires humaines, au sens le plus large du terme, la méthode est la même. Ainsi comprend-on que la dynamique d’une négociation créative puisse conduire à modifier le problème initial. Le problème que l’on résout au bout du compte n’est donc plus exactement celui qui a été posé au départ.
Deuxième question : quels sont les intérêts en jeu ? Cela paraît aussi très simple. S’il s’agit d’une simple affaire d’argent, on conçoit aisément par exemple que plus l’on tire un prix élevé de son appartement, plus l’on est satisfait. Et pourtant, même dans un cas comme celui-ci, il peut y avoir des considérations annexes qui font que l’argent n’est pas forcément l’unique intérêt. Très souvent, la notion d’intérêt est complexe. Ce qui est vrai pour les personnes privées l’est encore plus pour les personnes morales. Comment définit-on l’intérêt général ou l’intérêt national ? Il y a certes la vision « maurasso-gaullienne » de l’intérêt national ou de l’intérêt général, qui le conçoit d’une manière univoque, mais tous ceux qui se sont penchés sérieusement sur la question savent que la notion d’intérêt général ou national est en fait extrêmement délicate à manier. Ainsi la notion d’intérêt national aujourd’hui pour la Russie se formule-t-elle d’une manière substantiellement différente de la manière dont les Soviétiques la concevaient naguère. Comment donc, dans une négociation, définir les intérêts des parties ? Surtout si l’on introduit le fait que les parties sont rarement, voire presque jamais, « insécables ». De façon générale, il n’y a pas unité des parties. Chaque partie qui négocie a elle-même souvent à engager un processus de négociation en son sein. Ces transactions en interne s’expliquent par la polyarchie inhérente à toute Organisation et à toute Direction d’une unité active. Tout négociateur est un Janus à deux faces. La réalité est loin de l’image courante, comme en diplomatie celle d’un fonctionnaire simple émanation d’un gouvernement lui dictant sa conduite. Le diplomate ou l’homme d’affaires qui s’engage dans des pourparlers doit souvent rédiger ses propres instructions. Il a non pas un mais plusieurs objectifs à atteindre, et ces objectifs peuvent ne pas être parfaitement clairs et/ou résulter d’un compromis plus ou moins cohérent entre divers organes de pouvoir n’ayant pas toujours les mêmes priorités. D’où un aspect essentiel du rôle du négociateur qui doit être en mesure de forcer l’accord entre différentes parties prenantes dans son propre camp. Les diplomates avec leur gouvernement, les gouvernants entre eux, avec leur opinion publique comme avec leurs administrations, etc. Le bras de fer entre la Russie et l’Ukraine sur les armes nucléaires, dont Iouri Doubinine a été le témoin privilégié, en est une parfaite illustration . Cela est aussi vrai à l’intérieur d’une famille ou d’une entreprise. On ne doit pas sous-estimer l’élément de complexité et d’incertitude ainsi introduit. Cette qualité « sécable » ou « insécable » renvoie évidemment à la définition de l’intérêt, puisque celui-ci est souvent défini par une procédure collective, à l’intérieur de l’unité en cause. Il faut ajouter que les intérêts mettent aussi en jeu des effets de miroir fort subtils. Peut-on définir son propre intérêt, indépendamment de l’idée qu’on se fait de l’intérêt des autres ? Quand on entre en négociation, il faut aussi avoir une vision claire de la représentation par les autres parties de ses propres intérêts, et il faut avoir une idée non seulement des intérêts des autres, mais encore de l’idée que les autres se font de leurs propres intérêts, et ainsi de suite. J’ai évoqué les intérêts de deux parties en discussion. Il faut aussi réfléchir sur les ressources ou les atouts, les vôtres, ceux de votre partenaire et ce que votre partenaire pense de vos atouts. Toute cette activité spéculative est sujette à erreurs. On la voit à l’œuvre, avec Hector et Ulysse, sous la plume de Jean Giraudoux, dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu.
Troisième question dans le prolongement de la précédente : celle des caractéristiques culturelles de la négociation – autrement dit, des styles qui varient beaucoup. Il y a en effet une importante composante culturelle dans l’art de la négociation. L’histoire des relations américano-soviétiques dans la seconde moitié du XXe siècle, pendant la guerre froide, illustre ces différences de comportement des uns et des autres. On peut parler du yankee deal comme d’une réalité américaine : il consiste dans la conclusion effective d’un accord qui satisfait les deux parties – chacune cherchant ensuite à convaincre son camp qu’elle a eu la meilleure part de l’accord. Dans cette façon de voir, l’absence d’accord est un échec. Les Soviétiques – à l’époque de la guerre froide – avaient une attitude différente. Pour eux, toute négociation avait un gagnant et un perdant. Il était donc légitime de renoncer à un accord et de rentrer à Moscou s’ils couraient le risque d’être les losers de la partie. Les diplomates américains, en revanche, se voyaient reprocher dans tous les cas de revenir bredouilles à Washington. Il y avait une obligation de résultat, et, du même coup, une pression très forte s’exerçait sur les « mandatés ».
Quatrième question, à laquelle j’ai déjà fait allusion : quelles sont les ressources des unités qui négocient, et leur pouvoir ? J’entends par « pouvoir » la capacité de mobiliser les ressources. Elles sont de toutes sortes : matérielles, notamment économiques, mais aussi idéologiques comme le soft power, qui a existé de tous temps mais n’a été théorisé que récemment sous cette appellation par le professeur américain Joseph Nye. L’Union soviétique avait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un immense pouvoir idéologique qu’elle a progressivement perdu. Après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont bénéficié d’un énorme pouvoir psychologique qu’ils ont en partie perdu sous l’administration de George W. Bush.
Cinquième question, le jeu des menaces. Est-il possible, dans les négociations sophistiquées, de ne pas avoir à jouer avec la peur ? Autrement dit, peut-on concevoir une négociation sans un minimum de menace implicite, suggérant la possibilité d’utiliser des ressources pour nuire au partenaire ou pour lui infliger des représailles (même si le mot n’est pas forcément employé) ? N’est-il pas inéluctable, dans toute négociation, de faire peser, même discrètement, une épée de Damoclès sur ses partenaires de manière à leur laisser entrevoir des dommages disproportionnés avec les enjeux estimés, s’ils n’inclinent pas dans le sens voulu ? Un négociateur totalement dépourvu de ressources, ou ayant des ressources et ne pouvant les mobiliser (ce qui revient au même), peut-il aller très loin dans une négociation ? En fait, me semble-t-il, il y a toujours quelque part des ressources. Le plus démuni peut avoir des ressources, au moins psychologiques, qui lui confèrent malgré tout un certain pouvoir. Le rôle de la menace et de la crédibilité, sur le plan international, est évident. S’il y a une négociation entre les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Iran sur la question de l’énergie nucléaire et du respect par Téhéran du traité de non-prolifération, quelles sont de part et d’autre les forces à l’ombre desquelles se déroule la négociation ? Le cas de la négociation sur les armes nucléaires entre la Russie et l’Ukraine est encore, à cet égard, éclairant. Quelle qu’ait été l’habileté de la diplomatie russe, l’ombre qui recouvrait la négociation était celle des États-Unis. La vraie force de levier pour faire plier l’Ukraine et la conduire à signer puis à se conformer au Protocole de Lisbonne, c’était son besoin de reconnaissance dans la « communauté des nations ». Cette reconnaissance était la meilleure des garanties de sécurité, y compris à l’égard du « grand frère » russe, et les États-Unis en détenaient la clef. Cela explique l’effet déterminant de la pression exercée à Lisbonne par le secrétaire d’État américain James Baker sur le gouvernement de l’Ukraine jusqu’à l’ultime signature. Cette notion est tout à fait fondamentale dans le domaine des relations internationales. Mais n’est-elle pas pertinente dans toute négociation ?
En théorie des jeux, on parle de jeux à somme positive ou à somme nulle. Les jeux à somme nulle, c’est le partage d’un gâteau donné : les tranches seront plus ou moins grosses pour chaque convive. On raisonne, dans ce premier cas, sur une quantité fixe où chacun tente par diverses manœuvres d’avoir, au détriment des autres, une part plus importante. Il y a le cas plus général où la dimension du gâteau n’est pas déterminée une fois pour toutes – autrement dit, une partie de la coopération consiste justement à l’accroître, mais l’accroissement ne peut pas être indéfini et il y a toujours un moment où la question du partage dudit gâteau se pose. Or, comme en réalité le problème se pose dès le départ, cela complique, par un jeu d’anticipation dans lequel interviennent les menaces, la suite du processus.
Sixième question, plus ou moins implicite dans tout ce qui précède, le problème du temps, au sens de chronos. Il comporte une dimension psychologique très forte. Il implique aussi une dimension de recherche d’information. Mais j’ajouterai, pour employer un terme familier aux économistes, un autre aspect problématique, celui du coût de transaction. Négocier, c’est avoir des échanges avec un certain nombre de partenaires ou adversaires, aussi est-ce une activité consommatrice de ressources. La négociation coûte. Pendant qu’on négocie, on n’est pas disponible pour autre chose. « Le temps, c’est de l’argent », selon l’adage populaire, mais cela comporte également, sur un champ de bataille, un coût en vies humaines. L’exemple de la guerre de Trente Ans fournit matière à réflexion sur l’interaction entre la durée, les campagnes militaires et l’activité diplomatique. À l’issue de vingt-deux ans de guerre, une négociation s’est engagée entre la France, l’Espagne, la Suède, l’empereur et les autres princes allemands à Münster et Osnabrück, mais il fallut huit longues années pour qu’elles aboutissent. Chaque victoire comme chaque défaite sur le terrain mettaient aux mains des négociateurs des cartes ou leur en enlevaient. Ce sont deux victoires des Français et des Suédois au début de 1648 qui scellèrent finalement le sort de la guerre et obligèrent l’empereur Ferdinand III à accepter des conditions qu’il avait toujours refusées. Quels sont donc les différents aspects de la temporalité dans la négociation, y compris la modification des perceptions, et éventuellement des intérêts eux-mêmes ? Cela renvoie à ma toute première remarque. Ainsi, à la fin de la Première Guerre mondiale qui n’a duré, si l’on ose dire, que quatre ans, les belligérants se demandaient comment ils avaient pu formuler au début du conflit leurs intérêts d’une façon qui, quatre ans plus tard, leur paraissait aussi absurde. C’est souvent le cas, d’une manière générale, au lendemain des grands affrontements armés. La diplomatie, pour détourner la célèbre phrase de Clausewitz, est la continuation de la guerre par d’autres moyens. Elle doit gérer des objectifs pluriels qui se modifient en permanence dans le processus de la négociation et dans la durée. Du reste, il est des cas où le processus de négociation est un objectif en soi indépendamment de l’accord et de son contenu. Il en a été ainsi des discussions sur le contrôle des armements entre les États-Unis et l’Union soviétique à partir des années 1960. Il s’agissait, avant tout, pour les deux Grands d’avoir un contact politique suivi. On retrouve là les vertus de cette négociation continuelle vantée par Richelieu : « J’ose dire hardiment que négocier sans cesse, ouvertement ou secrètement, en tous lieux, encore même qu’on n’en reçoive pas un fruit présent et que celui que l’on peut attendre à l’avenir ne soit pas apparent, est chose du tout nécessaire pour le bien des États . » Le dialogue permanent joue comme un réducteur d’incertitude. On notera ici l’une des limites de la théorie des jeux. Celle-ci suppose un degré de rationalité et de froideur qui est, par définition, absent de la réalité. La théorie des jeux est très utile pour clarifier de nombreux concepts, mais il ne faut pas trop en attendre dans la réalité.
Sur le plan des émotions, quelques remarques sont nécessaires. D’abord, il ne peut y avoir de négociations sans émotions. Mais jusqu’à quel point est-il possible de négocier en étant émotionnellement engagé dans la négociation ? Si l’on a souvent recours à des médiateurs ou à des arbitres, c’est en partie pour remédier à l’inconvénient que présente une implication irrationnelle trop forte. À vrai dire, même si l’on est peu engagé personnellement, on l’est nonobstant, puisque le succès ou l’échec de la négociation sera imputé au négociateur, en tout état de cause, d’une manière ou d’une autre. La neutralité totale est probablement impossible. On connaît des gens éminents ayant une grande lucidité pour analyser les situations extérieures, mais qui, s’agissant de leurs propres affaires, deviennent incapables au sens propre du terme. Le réalisme, c’est la capacité de rester objectif, en ne conservant qu’un faible degré d’engagement émotionnel, devant les situations les plus délicates. C’est extrêmement difficile, et conduit à évoquer une question capitale : quelles sont les qualités psychologiques nécessaires à un bon négociateur ? N’importe qui peut-il y parvenir ? Suffit-il d’être intelligent ? L’émotion peut même être à la source de la négociation. C’est après avoir parcouru le champ de bataille de Solferino jonché de 40 000 cadavres que Napoléon III, horrifié, a proposé un armistice à l’empereur François-Joseph. Napoléon III n’était pas du bois dont on fait les hommes de guerre .
Sur la question de l’intelligence du négociateur, il faut méditer cette délicieuse remarque de Richelieu : « Comme les sots ne sont pas bons à négocier, il y a des esprits si fins et si délicats qu’ils n’y sont pas beaucoup plus propres, parce que, subtilisant sur toutes choses, ils font comme ceux qui rompent la pointe des aiguilles les voulant affiler . » Une finesse extrême assortie d’une capacité d’abstraction et de réflexion hors pair peuvent se transformer en handicap. Quelle est la forme d’intelligence la plus appropriée ? Voilà encore un point qui échappe à la théorie des jeux, laquelle ne traite que d’individus par définition hyper-rationnels, c’est-à-dire des calculateurs purs, qui ne sont pas des êtres de chair et de sang.
Il y a une trentaine d’années, lorsque je dirigeais le Centre d’analyse et de prévision au Quai d’Orsay, Jean Laloy m’avait dit : « Il y a trois catégories de diplomates : les diplomates de charme, les diplomates de choc, et les diplomates de choc charmants. » Mais qu’est-ce que le charme ? C’est extrêmement important, puisque c’est la mise en confiance. Plus généralement, c’est la capacité de modifier les perceptions des autres. Le diplomate de charme va essayer d’influencer la perception qu’a l’autre de ses propres intérêts, mais cela fonctionne dans les deux sens. Par exemple, mon interlocuteur va essayer de modifier ma perception de ses intérêts à lui, mais il va également essayer de modifier ma perception de mes propres intérêts. Et, s’il est doué, il y réussira dans une certaine mesure. Le contrôle de soi est l’une des règles primordiales du jeu diplomatique. Le dévoilement ou le dérapage volontaires font eux aussi partie de l’arsenal tactique à disposition du diplomate dont La Bruyère fait un portrait qui transcende le Grand Siècle : « Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un Protée : semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre ni humeur ni complexion ; soit pour ne point donner lieu aux conjectures, ou se laisser pénétrer ; soit pour ne rien laisser échapper de son secret par passion, ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu’il a, et aux besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient qu’il est en effet . » Le négociateur doit appliquer la recette décrite par Denis Diderot dans son Paradoxe sur le comédien, et dont l’illustre Louis Jouvet avait fait un pilier de son enseignement : il doit rester intérieurement parfaitement maître de lui-même tout en étant capable de manifester extérieurement de l’émotion et d’en user éventuellement pour séduire ses partenaires. Typiquement, cette qualité n’est pas le propre des militaires. Pour cette raison, les hommes en uniforme ne sont pas forcément de bons diplomates. Cela dit, il existe des exceptions. D’où aussi le fait que les qualités des industriels ne sont pas celles des commerçants ou des banquiers. Quand un touriste se fait duper par un commerçant, les choses se passent ainsi : en quelques minutes, celui-ci parvient à créer une espèce de bulle magique qui fait que, temporairement, l’acheteur présumé a tout son système de perception agité, et va dans ce contexte faire ce qu’on appelle une mauvaise affaire. Il n’est pas rare non plus que l’homme de charme, pour reprendre la typologie de Jean Laloy, soit lui-même fort sensible au charme. Auquel cas, l’arroseur peut se trouver arrosé… Se connaître soi-même et connaître les autres, notamment leurs faiblesses, est d’une grande utilité. L’information dans toutes ses composantes est au cœur de la négociation et donc au centre des préoccupations du négociateur. Comme le souligne encore La Bruyère : « Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations avec qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes avec qui il négocie : toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de sa politique tendent à une seule fin, qui est de n’être point trompé, et de tromper les autres . » Il n’est pas fortuit que Cavour, Premier ministre du Royaume de Piémont, ait choisi d’expédier la belle comtesse de Castiglione à Paris en 1855 avec pour mission de préparer l’alliance de la France et du Piémont : il savait Napoléon III sensible au charme féminin et il y voyait l’un des moyens de réaliser l’Unité italienne. Petite histoire qui rejoint la grande – comme souvent en matière de négociation.
Il faut insister sur tous ces éléments psychologiques qui peuvent se révéler déterminants. Suivons, une fois encore, les observations de Richelieu ayant expérimenté, à ses dépens, l’excès de zèle de certains diplomates – notamment du P. Joseph à la Diète de Ratisbonne en 1630 – qui avaient le défaut d’ignorer la vertu de l’abstention (on rejoint ici nos propos antérieurs au sujet de la diplomatie américaine de la guerre froide et du dogme de l’accord à tout prix) : « Il est tout à fait nécessaire d’être expert au choix des ambassadeurs et des négociateurs, et qu’on ne saurait être trop sévère à punir ceux qui outrepassent leur pouvoir, puisque, par telle faute, ils mettent en compromis la réputation des princes et le bien des États tout ensemble. La facilité ou la corruption est quelquefois si grande et la démangeaison qu’ont quelques autres, qui ne sont ni faibles ni méchants, de faire quelque chose est souvent si extraordinaire que, s’ils ne sont retenus dans les bornes qui leur sont prescrites par la crainte de leur perte absolue, il s’en trouvera toujours qui se laisseront plutôt aller à faire de mauvais traités que de n’en point faire . »
Les qualités et les préoccupations du négociateur peuvent avoir un impact considérable sur la conduite des pourparlers et naturellement sur leurs résultats. Le diplomate avisé doit en avoir conscience. S’il est expérimenté, il n’engage jamais une négociation sans avoir préparé pour son adversaire ou son interlocuteur un « pont d’or » – autrement dit, une ligne de retraite. Il n’y a pas de meilleur moyen pour amener quelqu’un à quitter sa position que de lui proposer de franchir le « pont d’or ».
La notion de coup d’œil et d’intuition est essentielle. On la voit à l’œuvre dans la création artistique, littéraire et scientifique, mais aussi dans la stratégie (Clausewitz y a consacré de très longs développements). Dans la négociation et dans l’action en général, le coup d’œil, l’intuition, c’est la capacité peut-être la plus fondamentale. Certains hommes ont l’art de voir en une fraction de seconde ce que nul autre ne voit, et de prendre la bonne décision au bon moment, alors qu’il suffit d’un très léger déplacement pour passer de la bonne à la mauvaise décision. Dans tous les domaines, ce qui fait la différence entre le génie et le talent ordinaire tient sans doute à cet éclair inexplicable en l’état actuel de la science du cerveau. Comment ce phénomène opère-t-il dans la négociation ? Il faut se poser la question. On peut, sans aucun doute, s’imprégner des techniques de négociation en lisant des écrits théoriques et, plus sûrement encore, en en faisant l’apprentissage, au sens médiéval du terme, aux côtés de négociateurs chevronnés. Néanmoins les aptitudes naturelles jouent un rôle essentiel dans ce qui reste un art où l’imagination combinée au savoir-faire peut seule réaliser des prouesses. Tout être normalement constitué peut jouer du violon ou manier un pinceau ; il n’en est pas pour autant Yehudi Menuhin ou Van Gogh.
Cela dit, dans l’action le génie lui-même produit rarement des miracles. Et, puisqu’il faut conclure, je citerai cette réflexion de l’abbé de Mably : « Comme il serait bien plus flatteur pour l’orgueil des hommes de commander que de persuader, et qu’ainsi on ne négocie qu’autant qu’on sent une certaine impuissance à ce qu’on désire ; il en résulte que les négociations, faites par leur nature pour suppléer à la force, doivent l’aider dans ses entreprises, mais ne peuvent point en tenir la place ; c’est-à-dire, qu’une puissance ne négociera utilement, qu’autant qu’elle aura la sagesse de ne former que des entreprises au-dessous de ses forces . »