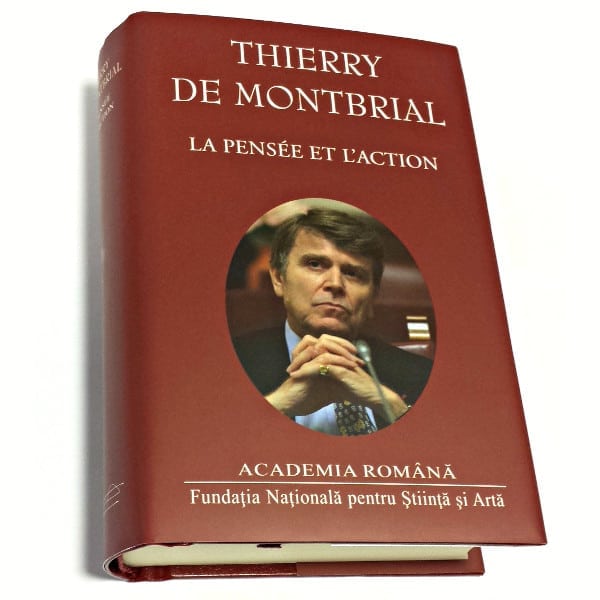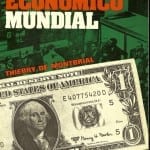A propos des Mémoires de Jean Monnet
Texte rédigé en juillet 1977. Les références entre parenthèses se rapportent à l’édition originale des Mémoires de Jean Monnet, Paris, Fayard, 1976
Jean Monnet fut assurément un homme exceptionnel. D’abord par l’intensité de sa motivation. Il n’avait qu’une idée à la fois et possédait, selon l’expression de Marcel Bleustein-Blanchet, la « rage de convaincre ». Il ne paraissait jamais saisi par le doute, jamais entravé par l’« angoisse métaphysique ». Il était de la race de ceux qui détiennent la vérité et l’énoncent avec solennité. Il évoquait la statue du Commandeur. Un peu comme Jacques Rueff. Monnet raconte (p. 610-611) qu’un de ses amis américains avait coutume de dire : « Il n’y a que deux catégories d’hommes : ceux qui veulent être quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque chose. » Il appartenait à la deuxième catégorie. Il rapporte aussi ce propos que lui adressait Léon Blum (p. 30) : « Je vous envie de pouvoir vous concentrer. Moi je ne peux pas m’empêcher de m’intéresser à tout ce qui passe. » Sur sa « rage de convaincre », Jacques Gascuel écrit dans un article par ailleurs féroce de sa revue Perspectives : « Il a de grandes qualités. La plus importante est sa capacité de persuasion. Il est dans ce domaine anormalement doué. AU point que l’on peut difficilement s’empêcher, pendant quelques instants au moins, d’être persuadé que ce qu’il dit est ce qui est, qu’il ne peut en être autrement. »
Ces qualités, Monnet les a sans doute d’abord développées comme voyageur de commerce au profit de l’affaire familiale de Cognac. Avant la Grande Guerre, il a déjà acquis une connaissance intime des Anglo-Saxons, qui sera l’un de ses plus grands atouts. Contrairement à la plupart des Français, il se met facilement sur leur longueur d’onde, et ce n’est évidemment pas seulement une affaire de langage. La modestie de son approche, la générosité de ses conceptions, son absence de ressentiments historiques, son orientation vers la solution des problèmes plutôt que vers les discussions théoriques et idéologiques, en un mot, son pragmatisme, et bien entendu aussi son sens peu commun des relations publiques, voilà à quoi tient la capacité de Jean Monnet à communiquer avec les Anglo-Saxons, et spécialement les Américains.
En 1914, à vingt-six ans, il se concentre sur le problème de la coordination de l’effort de guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Peu respectueux de la hiérarchie et non convaincu que tout a été prévu, ce qui est aussi l’une de ses forces, il trouve le moyen de se faire introduire chez René Viviani, alors président du Conseil. « Il faut, lui dit-il, mettre sur pied des organes communs capables de mesurer les ressources de l’Entente, de les répartir et d’équilibrer les charges. » (p. 56) Il se fait envoyer à Londres, où il jouera un rôle de premier plan pour la coordination du ravitaillement (Wheat Executive) et des transports. Après la guerre, il sera secrétaire général adjoint de la Société des Nations (SDN), qu’il quittera en 1923 pour retourner dans le monde des affaires. La menace de la guerre le ramènera à la chose publique. C’est le problème de l’insuffisance des moyens aéronautiques alliés par rapport à l’Allemagne qui mobilise d’abord toute son énergie. Après avoir tenté de faire réaliser l’incroyable projet d’union totale entre la France et la Grande-Bretagne, qui n’aura pas de suite à cause de l’armistice franco-allemand, il agira à Washington pour le compte de Londres et par conséquent, dans son esprit, de la société démocratique, afin de mettre la puissance américaine au service de la victoire. En 1943, il ira à Alger, d’abord comme envoyé de Roosevelt ; il y deviendra membre du Comité français de libération nationale (CFLN) où il jouera un rôle de médiateur dans la querelle Giraud/de Gaulle. À la Libération, il a l’idée de l’institution du Commissariat général du Plan dont il sera le premier commissaire. En 1950, il sera l’« inspirateur » du plan Schuman et, en 1951, deviendra le premier président de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). En 1955, il fondera le « Comité d’action pour les États-Unis d’Europe », tâche qui l’absorbera pendant les vingt années suivantes (le comité a été dissous en 1975).
Comment caractériser la « méthode » de Jean Monnet ? Il est d’abord convaincu que les individus, comme les nations, peuvent dépasser la poursuite de leurs intérêts à court terme pour se hisser au niveau de l’« intérêt général », pourvu que des hommes clairvoyants et de bonne volonté les y aident. La psychologie d’un groupe d’individus ou d’un groupe de nations qui s’apprête à négocier est radicalement différente quand le groupe part avec l’idée qu’il y a un problème à résoudre dans l’intérêt général. Si un individu ou une nation se retranche derrière sa souveraineté ou son « indépendance » et l’invoque pour refuser le problème tout en comptant bien pouvoir profiter de ce que les autres feront (problème du free rider ou passager clandestin en théorie des jeux), toute la psychologie du groupe en est affectée. La France gaulliste a trop souvent joué ce rôle. Pour donner un exemple contemporain, citons l’attitude de notre pays par rapport au problème de la prolifération nucléaire . Le go-between – le médiateur –, dont Monnet est évidemment le prototype, a pour rôle notamment de poser, et au besoin de transformer, l’énoncé des problèmes. Il faut prendre appui sur les difficultés, au lieu de se laisser bloquer par elles. Monnet cite (p. 468) cette remarque d’Ibn Séoud rapportée par Jacques Benoist-Méchin : « Pour moi, tout est un moyen, même l’obstacle. » Le médiateur doit être personnellement désintéressé, ne chercher aucun avantage pour lui, surtout ceux dont il jouirait aux dépens des autres. Sa seule ambition doit être le succès de l’action dont il s’est fixé les objectifs au terme d’une longue méditation. Il doit alors convaincre un petit nombre d’hommes charnières et savoir manœuvrer au sein des institutions existantes, dont il importe de bien connaître les rouages. Avant de résoudre les problèmes, il faut procéder à un inventaire. Monnet parle beaucoup de la méthode des balance-sheets , à laquelle il a eu souvent recours. Après, c’est l’affaire de discussions à l’ombre de l’intérêt général et de création d’institutions adéquates ; car rien ne dure sans les institutions.
C’est évidemment à propos de la construction européenne que Monnet a donné à ses analyses le maximum d’élaboration. Il s’est convaincu que la méthode des relations intergouvernementales de style classique était dépassée, et surtout devait l’être. D’où la méthode de la délégation de souveraineté partielle et progressive.
Au sein d’une communauté, les décisions doivent être prises à la majorité, et non pas à l’unanimité. Le droit de veto est archaïque et facteur d’immobilisme. Les unités qui constituent la communauté n’ont rien à craindre, car on ne prendra jamais une décision qui heurte de pain fouet leurs intérêts majeurs. Mais l’exclusion du droit de veto garantit en quelque sorte que le processus de décision débouchera positivement. C’est bien d’ailleurs ce qui se passe à l’intérieur d’une fédération déjà constituée (États-Unis ou Allemagne fédérale par exemple) ou bien à l’intérieur d’une nation entre les différents groupes d’intérêts.
Jean Monnet a toujours reproché à Charles de Gaulle (déjà en 1940) d’être inspiré par des temps révolus et de flatter par son comportement le nationalisme des Français tout en exacerbant celui des autres. Son projet de Confédération européenne, l’Europe des patries de l’« Atlantique à l’Oural », n’a jamais été défini avec précision et n’a fait que servir d’excuse à l’immobilisme. Après 1963, de Gaulle sera, dans les faits, résolument hostile à la communauté.
Toute œuvre humaine procède d’une idée. Qu’il s’agisse de relations interpersonnelles, de la création artistique, du travail de la matière ou de la conduite des nations, c’est dans le cerveau humain que naissent les œuvres. On ne peut vraiment juger une œuvre sans comprendre l’axiomatique consciente ou inconsciente dans laquelle elle s’inscrit, à sa phase « spirituelle ». Il est intéressant, de ce point de vue, de comparer les conceptions européennes chez de Gaulle et chez Monnet, en particulier en ce qui concerne les relations euro-américaines. Pour de Gaulle, la nation est l’unité politique intangible à la base de l’histoire. Les gaullistes peuvent trouver dans les faits des justifications de leurs thèses européennes, ce qu’illustre le fameux « Bonjour les traîtres » de Michel Jobert . Les « Européens » peuvent répondre que le comportement de la France gaulliste a contribué à susciter un comportement hostile chez les partenaires de la France. Il en est des relations internationales comme des relations interpersonnelles. Les gaullistes sont cohérents, dans leur axiomatique, lorsqu’ils dénoncent l’hégémonie américaine, opposent l’Europe européenne à l’Europe atlantique, affirment que la coopération politique au sein de la communauté doit précéder le dialogue transatlantique et insistent sur la nécessité d’une rigoureuse séparation des tâches entre les diverses instances de discussion pour éviter, par exemple, que l’hégémonie américaine ne déborde, par le biais des institutions atlantiques, le cadre de la Défense.
Mais les « monnetistes » ont raison, dans leur système de pensée, de dire que cette approche ne conduit qu’à un cercle vicieux, c’est-à-dire que l’on ne trouve à l’arrivée que ce que l’on a mis au départ : la rivalité des nations. Pour eux, l’approche gaulliste exacerbe l’orgueil des nations. Acteurs, spectateurs ou même « voyeurs » de l’histoire, comme l’a écrit un jour Raymond Aron, les Français sont flattés quand le général de Gaulle prononce le discours de Pnom Penh ou ordonne le rapatriement en France de notre part du stock d’or de Fort Knox. Les leaders du Tiers Monde sont excités de voir le président français s’en prendre à l’Amérique et faire mouche. Mais à quoi de constructif tout cela conduit-il ? Le prestige de la France, acquis dans ces conditions chez certains pays en développement, est-il autre chose qu’éphémère ? La politique gaulliste ne conduit-elle pas, finalement à la stérilité et, au sens plein du terme, à la vanité ?
Je suis tenté, quant à moi, et tout en reconnaissant l’indécidabilité logique entre les deux axiomatiques, de préférer celle de Monnet à celle du Général, malgré le panache auquel je suis évidemment sensible. Car Monnet « fait quelque chose » et de Gaulle « est quelqu’un » (je ne parle évidemment que de la période 1958-1969). De Gaulle a certes laissé les institutions et la force de frappe. Eût-il mis sa formidable énergie au service d’autres constructions, et d’abord celle de l’Europe, où en serions-nous aujourd’hui ? Mais, si l’on suit Jean Monnet jusqu’au bout, il ne faut jamais se poser ce genre de question.