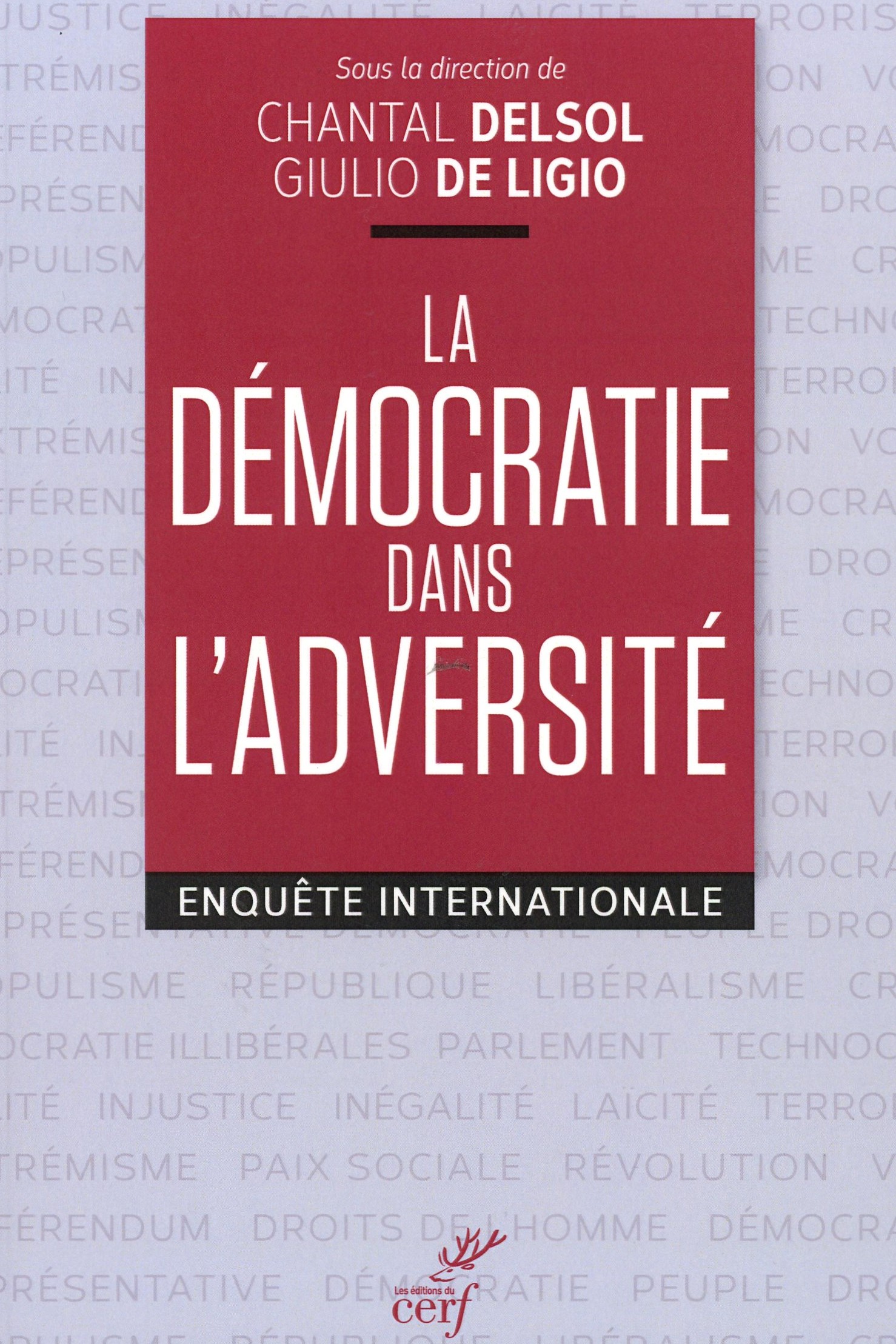
Relations internationales
Textes
texte paru dans l'ouvrage "La démocratie dans l'adversité", 2019
La démocratie est le plus mauvais de tous les régimes politiques, à l’exception de tous les autres : la cause était entendue. Pendant les quatre décennies de la guerre froide, l’« Occident » – concrètement les Etats rassemblés dans l’Alliance Atlantique et le Japon – a prétendu incarner ses « valeurs » ; et d’ailleurs le ressort principal de cette guerre restée virtuelle fut l’affrontement de deux idéologies : du côté occidental la démocratie qualifiée aujourd’hui de « libérale » ; du côté « oriental », autour des frères ennemis russes et chinois, la démocratie « populaire », forme dégénérée et à la limite totalitaire de ce qu’on appellerait aujourd’hui démocratie « illibérale ». Les Soviétiques ont perdu la bataille idéologique en raison de l’inefficacité de leur régime politique. La République Populaire de Chine (RPC) a survécu parce que, jusqu’à présent, elle a réussi à s’adapter. Les deux formes de « démocratie » se réclament du Siècle des Lumières, disons caricaturalement Voltaire d’un côté, Rousseau de l’autre. Priorité à l’individu dans le premier cas, au « peuple » pris en masse dans le second. Deux versants de la Révolution française. Trente ans ou presque après la chute du mur de Berlin, le camp occidental s’est étendu formellement (élargissement de l’Alliance Atlantique et de la Communauté devenue Union européenne), mais son unité idéologique s’est fragmentée. S’il n’y a plus de camp oriental structuré, on assiste à une progression de la forme illibérale de régimes qui se considèrent toujours démocratiques, même si l’héritage de « valeurs asiatiques » a pu prendre le pas sur celui des Lumières. La Russie tourne ostensiblement le dos à l’Europe, et la Chine toujours « populaire » arbore fièrement ses succès et ses ambitions. Le camp occidental s’est affaibli en s’étendant. Le camp oriental s’est paradoxalement renforcé en s’évanouissant. Les Etats-Unis sont plus dominants que jamais, et semblent avoir choisi la voie de la puissance à l’état brut, dans le cadre cependant d’une Constitution exemplaire – un système subtil de check and balances qui reste encore le principal marqueur de l’identité américaine. Mais, un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, personne ne saurait plus parler sérieusement d’un quelconque leadership américain dans ce qu’est devenu le camp occidental, et a fortiori dans le monde. De tout cela résulte une situation internationale préoccupante, qu’il ne s’agit pas dans ce qui suit d’analyser dans son ensemble, mais principalement sous l’aspect idéologique. Je formulerai à cet égard cinq remarques.
La première est que, n’en déplaise aux prophètes de la fin des territoires et de la puissance, les confrontations qui s’annoncent pour les années et décennies à venir seront dominées par des rapports de force dans l’acception la plus classique du terme. Ils ont commencé à s’organiser autour de la montée de la Chine, dont le but est de voler la primauté aux Etats-Unis. L’aspect proprement idéologique est à cet égard second par rapport au critère d’efficacité. Le Parti Communiste Chinois (PCC) réprime vigoureusement toute forme de contre-pouvoirs potentiels à l’intérieur – en particulier sectes et religions – mais ses dirigeants savent qu’en fin de compte sa légitimité dépendra de sa capacité à résoudre « harmonieusement » dans la longue durée (l’harmonie est un concept fondamental dans la tradition politique de l’Empire du Milieu) les problèmes économiques et sociaux du pays. Non sans raisons, ils pensent que les démocraties libérales secrètent les ferments de leur propre affaiblissement, parce qu’elles peinent de plus en plus à mettre les meilleurs au pouvoir et paraissent incapables d’élaborer et a fortiori d’exécuter les stratégies nécessaires pour s’adapter à un monde dont le rythme de changement est sans précédent dans l’histoire de l’humanité ; parce qu’au nom de la liberté sans retenue elles pratiquent implicitement le culte de l’autodestruction ; parce que, si l’on considère comme Walter Bagehot que la dignité (the dignified) et l’efficacité (the efficient) sont deux vertus cardinales en politique, les démocraties libérales n’ont trop souvent ni l’une ni l’autre. On objectera à juste titre qu’historiquement les Etats-Unis n’entrent pas dans ce schéma. L’explication est d’ordre culturel. L’efficacité et la réussite individuelle par le mérite sont au cœur des valeurs américaines, et la Constitution porte la marque du sacré, donc du dignified. Mais si, sur le plan des principes, la démocratie américaine est évidemment libérale, les Américains n’en sont pas moins patriotes (pour ne pas dire nationalistes). Chacun connaît les premiers mots de la loi fondamentale « We the people of the United States… ». Ce « We the people » est incarné, et nul n’y voit une contradiction avec l’apologie des valeurs individuelles ou avec la reconnaissance pragmatique des réalités communautaires, ce qui n’est pas le cas dans la culture française. Le pragmatisme est une caractéristique majeure de la culture américaine, qui explique largement une capacité d’adaptation dont rien n’indique actuellement qu’elle soit menacée.
Ma deuxième remarque porte sur l’idée moderne de démocratie. Le cœur en est la séparation des pouvoirs (Montesquieu) et l’élection. Sur le premier point, ici encore, il convient de distinguer entre les aspects formels d’une orientation institutionnelle et des réalités marquées par la culture des peuples. Par exemple, la limite de la séparation de l’exécutif et du judiciaire est un thème complexe dans l’histoire de la République française, et le débat n’est pas clos, ni celui des rapports entre le législatif et l’exécutif. La réalité de la séparation des pouvoirs parait beaucoup plus nette dans la tradition anglo-saxonne, y compris dans d’anciennes colonies de la Couronne, comme Singapour, que pourtant on classe à juste titre dans la catégorie des démocraties illibérales. Quant à l’élection, il y a également loin du principe aux réalités, qui sont très diverses. Le principe est que le mandat du pouvoir exécutif est toujours à durée déterminée. Mais pareille formule laisse bien des questions ouvertes. Dans tout pays, il n’y a pas une seule, mais une multiplicité de modalités du pouvoir exécutif, qui chacune a sa logique. Il n’y a pas davantage une, mais une multiplicité de modalités pour les élections démocratiques (suffrage universel direct, indirect ; majorités qualifiées ou non etc.). Sans parler des débats suscités par l’influence du financement des campagnes électorales, celle des fake news de toute provenance etc. Même genre de remarque pour la périodicité des élections. A la limite, on peut imaginer le principe d’une votation plus ou moins continue sur tous les aspects de la vie en société, dont un pays au moins s’inspire : la Suisse. Tout cela nous renvoie à l’extrême diversité des configurations sociologiques sous-jacentes aux superstructures juridiques. Derrière le principe de l’élection, il y a l’idée de la souveraineté du « peuple », qui pourrait faire et défaire les puissants au gré de ses humeurs, sans égard au lien qui existe dans la longue durée entre efficacité et légitimité ; sans égard en particulier à ceux qui sont morts ou à ceux qui ne sont pas encore nés, et qui pourtant comptent dans ce qu’on appelle un peuple. C’est justement ce lien intertemporel qui joue le rôle central dans l’idée monarchique, auquel le fondateur de la Cinquième République était attaché, et qui un peu partout connait un regain d’attention depuis la chute du système communiste. Le nom de l’historien Ernst Kantorowicz reste attaché à la distinction entre les deux corps du roi : le corps réel voué au dépérissement de la chair ; le corps mystique d’essence éternelle, comme le veut aussi la formule : « Le roi est mort, vive le roi ». La forme extrême d’une monarchie constitutionnelle se manifeste dans la Couronne Britannique et plus encore dans l’institution impériale au Japon. Le comble du dignified s’exprime dans l’absence de tout pouvoir dans l’ordre de l’efficient. Comme si le plus grand des pouvoirs, celui de maintenir à travers le temps une unité politique dans son identité, impliquait l’absence de tout moyen d’action dans l’ordre de l’immédiat. Comme si toute unité politique avait besoin de plus qu’une simple république. Dans un pays comme le Maroc, les pouvoirs du monarque ont toujours été contenus dans le cadre d’un système complexe de rapports de vassalité, et le roi Mohammed VI a fait un pas significatif vers une forme constitutionnelle au lendemain du mal nommé « printemps arabe ». Mais il est clair aux yeux de tous les observateurs que dans l’avenir prévisible, la stabilité du pays repose largement sur la monarchie.
J’en viens à ma troisième remarque : l’idée démocratique ne se limite pas à des principes institutionnels comme la séparation des pouvoirs et l’élection ; elle repose aussi sur un corpus de valeurs, de la Magna Carta de 1215 en Angleterre à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 – dont il convient de rappeler qu’il s’en fallut de peu qu’elle ne fût intitulée « déclaration internationale des droits de l’homme ». La substitution de l’adjectif « universel » à « international » est beaucoup plus qu’une nuance. Quoiqu’il en soit, reconnaissons qu’il peut y avoir loin de l’affirmation des principes dans un texte à la réalité. Même dans le cas de démocraties aussi reconnues que les Etats-Unis, la France ou Israël. Les démocraties libérales tendent à fixer aux droits des citoyens la seule limite du respect des lois, dont l’ensemble constitue un corpus d’interdits. Mais à la différence des dix commandements de la Bible, la conception de la démocratie libérale ne permet pas de fixer une liste de devoirs (comme deux des dix commandements : observe le jour de Sabbat ; honore ton père et ta mère). Le citoyen n’est pas directement sommé de se montrer patriote ou de respecter l’Etat, et même si l’on voit bien actuellement dans les démocraties de l’Europe occidentale une tendance à légiférer sur le politiquement correct et à restreindre la liberté de parole sur les sujets historiques, toute personne qui oserait demander qu’on légifère aussi sur les devoirs du citoyen serait immédiatement qualifiée de fasciste. Or, dans la conception de la démocratie illibérale, il y a bien une souche autour de l’idée que les citoyens ont des devoirs – pas seulement des droits – et que ces devoirs sont relatifs à un peuple dont l’identité est ancrée dans l’histoire. Cette question est cruciale dans le débat qui oppose aujourd’hui l’Europe centrale et l’Europe occidentale à propos de l’immigration. Elle a déjà provoqué beaucoup de dégâts, à commencer par l’affaiblissement de l’Allemagne à un moment où l’Europe avait besoin de sa force. Le débat a pris une tournure idéologique qui pourrait mettre en péril la construction européenne. Si la distinction principale entre démocratie libérale et illibérale est bien de l’ordre des droits et des devoirs des citoyens individuels par rapport à la collectivité qu’ils constituent dans leur ensemble, considérée comme une unité à la limite atemporelle, toute la difficulté est de tracer clairement la ligne de démarcation entre ces deux conceptions.
Ces considérations me conduisent à ma quatrième remarque. Disserter sur la politique d’un point de vue philosophique est un exercice passionnant et nécessaire, au même titre par exemple que l’économie théorique, mathématique à la limite. Aujourd’hui encore, les esprits attirés par l’abstraction continuent de débattre sur la distinction chez Rousseau entre la volonté générale et la volonté de tous, restée obscure dans le Contrat Social. Mais en politique comme en économie, il faut suivre le conseil de Schumpeter qui, dans son History of Economic Analysis, dénonçait les dangers des applications « irresponsables » de la théorie aux problèmes pratiques et soulignait l’importance de posséder ce qu’il appelait un « sens de l’histoire ». Ainsi était-il irresponsable pour les Occidentaux d’agir après 1989-1991 comme si la Russie pouvait et a fortiori devait devenir une démocratie libérale, après les trois générations de marxisme-léninisme qui avaient succédé à la dynastie des Romanov, et comme si les pays d’Europe centrale à peine libérés allaient effacer des générations marquées par le fascisme et le communisme, ou faire renaître instantanément les institutions (comme la justice) qui en avaient été marquées. Sans doute l’élargissement accéléré de l’Union européenne fut-il le moins mauvais choix après la chute de l’URSS, malgré l’affaiblissement qui en fut la conséquence inévitable. L’erreur à éviter aujourd’hui, sur le plan européen mais aussi plus généralement sur le plan international, est de provoquer une nouvelle guerre idéologique au nom de conceptions abstraites de la démocratie. L’Union européenne ne souffre pas principalement d’un déficit démocratique, mais d’un déficit d’efficacité, dont le danger est d’autant plus grand que nous savons ne plus pouvoir compter sur les Etats-Unis face aux multiples menaces qui pèsent sur chacune de nos nations et sur l’ensemble fragile que nous constituons tous ensemble. Sur le plan institutionnel, l’enjeu immédiat est de corriger pragmatiquement l’architecture de l’Union tout en respectant la diversité des cultures nationales. Le but est de la rendre plus efficace dans l’ordre économique, monétaire, social, sécuritaire ; en renforçant ou réduisant la voilure selon les cas, en finesse, et en saisissant les moments propices. Pour réussir, chaque pays doit comprendre ce qu’il aurait à perdre en cas d’échec.
Ma cinquième remarque me ramène au début de ce bref exposé. Depuis quelques années déjà, je décris le monde comme hétérogène, global, multipolaire et complexe[1]. L’hétérogénéité dont il s’agit est pluridimensionnelle et porte en particulier sur les cultures et idéologies politiques. La gestion de l’interdépendance – c’est-à-dire la gouvernance – deviendra impossible si l’affrontement de ces idéologies dégénère, notamment en Europe. A toutes les échelles, les Etats doivent donc faire preuve de retenue sur ce plan. Ce n’est pas toujours facile, surtout dans un pays comme la France où les « intellectuels » n’ont jamais cessé de se considérer comme un phare de l’univers. Surtout, avides de succès électoraux, les hommes politiques sont prompts à l’escalade. Il ne s’agit pas pour les démocraties libérales d’enfreindre le droit d’expression de la presse ou des associations – certaines ne le font que trop avec le « politiquement correct » et les lois mémorielles – ni au sein de l’Union européenne, de rester passif face à la transgression de règles établies en commun. Mais dans une situation internationale aussi fragile que le monde actuel, le risque est grand de marginaliser des Etats dont le tort principal est d’être différents. Il ne faut jamais cesser, non pas seulement de se « parler » (comme on dit trop facilement « il faut parler avec la Russie »), mais de négocier sur les intérêts tangibles. Si un Etat viole les codes ou est perçu comme réellement menaçant, la réaction doit être aussi collective que possible et s’organiser clairement dans le cadre du droit international, que trop souvent les Occidentaux eux-mêmes n’ont pas respecté depuis 1989. Ayant dit cela, force est de reconnaitre la difficulté supplémentaire de l’absence de leader, que ce soit à l’échelle de la planète entière, de l’Alliance Atlantique, ou de l’Union européenne à un moment où le « moteur » franco-allemand est en panne.
En fait, on ne saurait parler rigoureusement du système international contemporain. Celui de la guerre froide s’est décomposé avec la chute de l’empire soviétique. Le monde est alors entré dans une forme de chaos que traduisent bien les flottements terminologiques persistants quand il s’agit de caractériser un nouvel « ordre ». Les quatre adjectifs énoncés ci-dessus permettent au mieux à l’analyste de réduire l’incertitude sur le degré de désordre. Nous vivons une longue transition de phase comme diraient les physiciens, et le propre d’une transition de phase est de déboucher tôt ou tard sur un nouvel ordre, imprévisible ex-ante. En favorisant aujourd’hui une guerre proprement idéologique surtout en Europe, on se tromperait de combat, en provoquant ce que l’on redoute.
Je trouve ma conclusion dans les Mémoires d’un siècle de René Pomeau[2], un spécialiste mondialement reconnu de Voltaire, mort en l’an 2000. Voici le dernier paragraphe de son livre : « Quant à l’humanité, dans sa dimension planétaire, le millénaire qui va s’ouvrir ne lui épargnera pas, je crains, les terribles épreuves, guerres, massacres, destructions de toutes sortes. Je terminerai cependant par un mot d’espérance, fondé sur la nature même de l’homme. Je l’emprunte à la conclusion de ce défilé historique d’horreurs, que Voltaire intitula Essai sur les mœurs et l’esprit des nations : “Au milieu de tant de saccagements, nous voyons un amour de l’ordre qui anime en secret le génie humain, et qui a prévenu sa ruine totale.” Que ce « genre humain » dispose désormais du moyen de son suicide, par l’arme thermonucléaire, et que depuis un demi-siècle il n’en ait pas fait usage, donne raison au philosophe. Le constat inspire aussi quelque confiance dans la sagesse à venir des nations. » Sous réserve de parvenir à décélérer des forces centrifuges qui ne cessent de s’amplifier.
Thierry de Montbrial
[1] Thierry de Montbrial. Vivre le temps des troubles, Albin Michel, Paris, 2017, pp. 153 et sq.
[2] Publié chez Fayard en 1999.
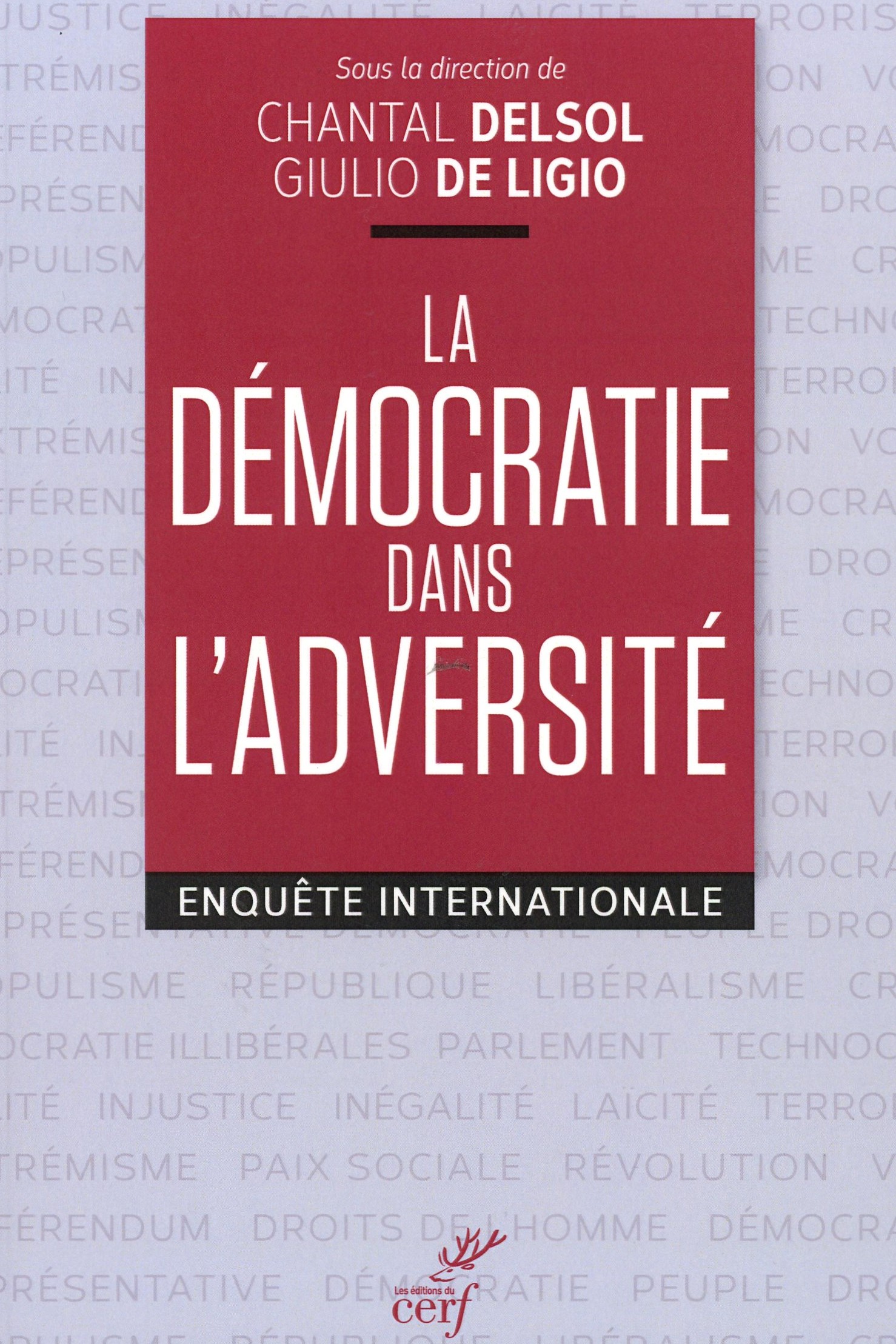
“La démocratie dans l’adversité”, sous la direction de Chantal Delsol et Giulio De Ligio
Ce sont cent intellectuels de France et des quatre coins du monde que Chantal Delsol et Giulio De Ligio ont réunis ici pour une enquête sans précédent sur l’état planétaire de la démocratie.
À l’heure des isolationnismes, des autocraties et des populismes, qu’en est-il de la théorie et de la pratique de ce qui semblait hier encore le bien politique absolu, et le premier critère progressiste de l’ère moderne ?
Embrassant de Washington à Beijing, de Dublin à Bucarest, sans oublier Bruxelles et Paris, mais aussi l’Amérique du Sud ; détaillant les concepts et les idéologies ; décrivant les institutions et les pouvoirs, cette somme, savante, libre et engagée, répond à cette question cruciale.
Face à la tentation illibérale, un véritable ouvrage collectif de débat et un appel à la raison des peuples.
Avec les contributions de : Daniel Andler, Martin Andler, Luis Barrón, Stéphane Bauzon, Daniel A. Bell, Jean Birnbaum, Mathieu Bock-Côté, Maté Botos, Bernard Bourdin, Ionel Buse, Giuseppe Busiello, Gerardo Caetano, Alessandro Campi, Monique Canto-Sperber, Gerard Casey, Marek Cichocki, Jean-Marc Coicaud, Vincent Coussedière, Olivier Dard, Marcin Darmas, Giulio De Ligio, Olivier Delacrétaz, Gil Delannoi, Chantal Delsol, Gaëlle Demelemestre, Mark Dooley, Alessandro Ferrara, Sylvain Fort, Domingo Gonzalez, Philippe d’Iribarne, Julius Krein, Blandine Kriegel, Stephen Launay, Carole Leal Curiel, Jean-Thomas Lesueur, Frédéric Louzeau, Jean-François Mattei, Jean-François Mayer, Olivier Meuwly, Sergiu Miscoiu, Jerónimo Molina, Horst Möller, Thierry de Montbrial, Dalmacio Negro Pavón, Damiano Palano, Gladden Pappin, Richard H. Pildes, Cristian Pîrvulescu, Grégor Puppinck, Michaël Rabier, Jenny Raflik, Myriam Revault d’Allonnes, Olivier Rey, Jacques Sapir, Stefano Semplici, Georges-Henri Soutou, Wolfgang Streeck, Antony Todorov, David Uzal, Adrian Vermeule, Jorge Verstrynge, Stéphane Vibert, Michel Wieviorka, Melissa S. Williams, Yves Charles Zarka.
Quand le premier quart du XXIè siècle touche à sa fin
08 décembre 2025
MédiasUn effondrement de l'Ukraine n’est pas à exclure
04 décembre 2025
Relations internationalesL’Union européenne face à un déclin inévitable ?
28 novembre 2025
Relations internationales50 ans de la création du G7
17 novembre 2025
